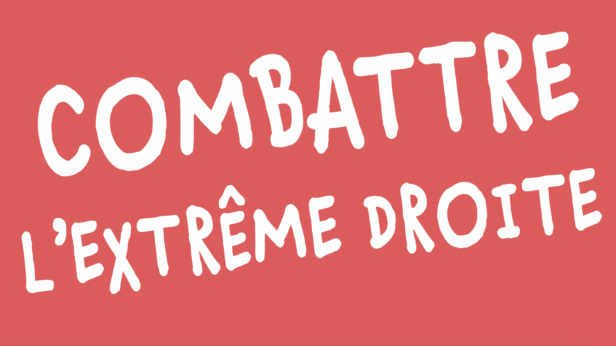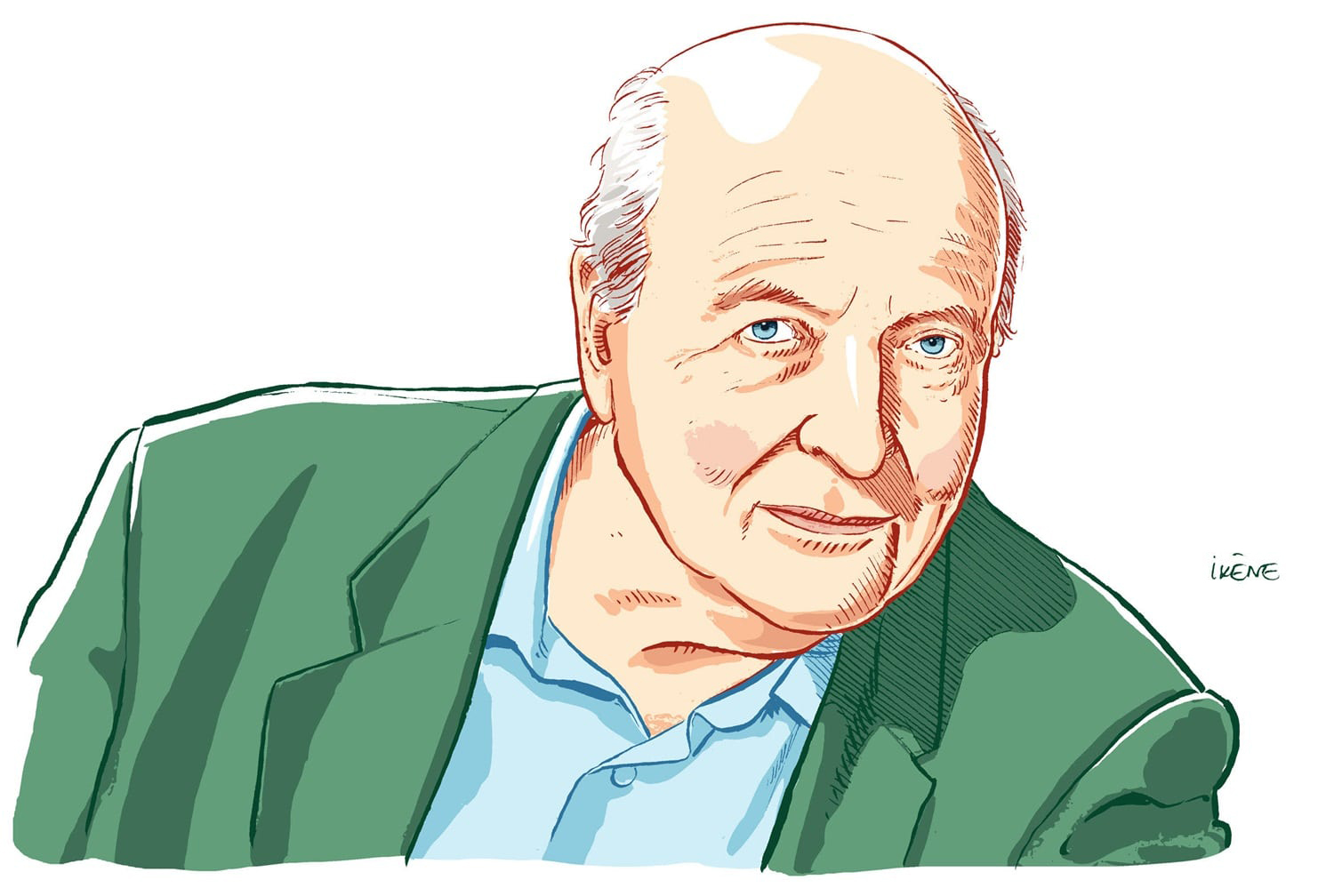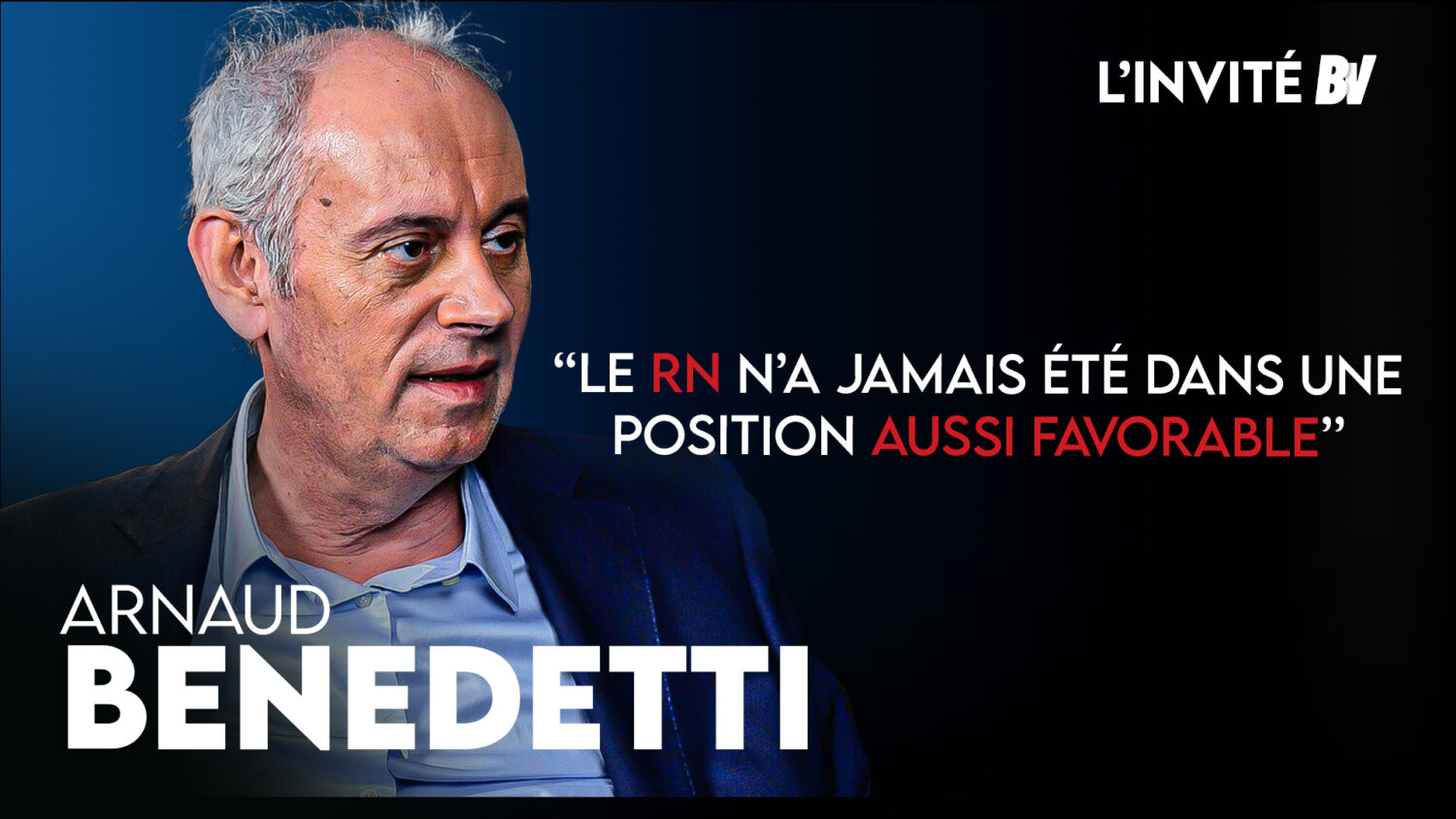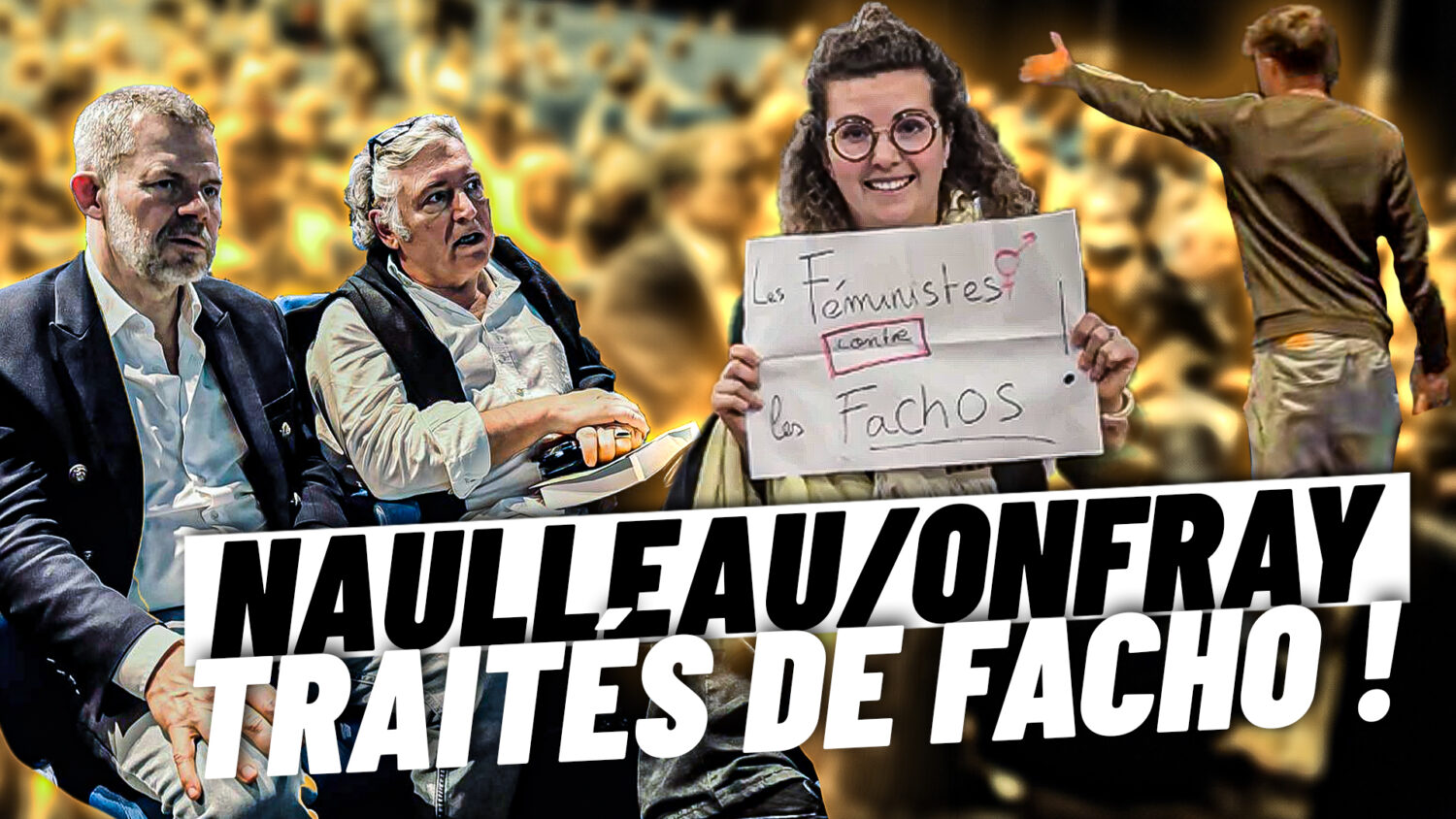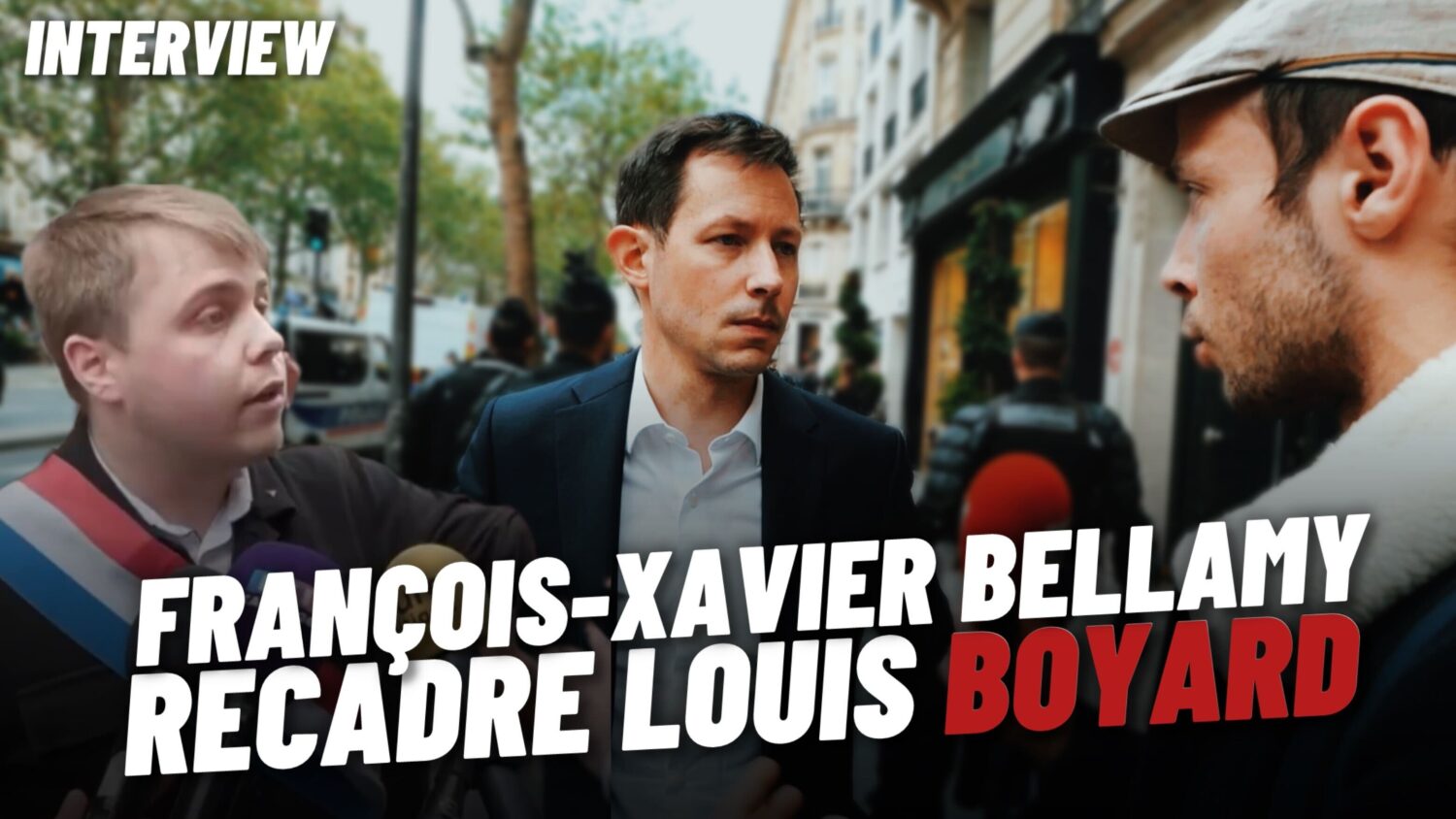La Nouvelle-Calédonie est en proie à une véritable guerre civile, depuis quelques jours.
Le saviez-vous :
- Nouvelle-Calédonie : le dégel électoral provoque une flambée du racisme anti-Blanc
- [EDITO] Incarville : la France sous la loi des gangs
- La vie d’artiste sous perfusion publique : les jeunes en rêvent !
- [POINT DE VUE] Le conflit ukrainien aurait pu cesser il y a deux ans… le dire était complotiste !
- Squatté et dépouillé par des OQTF, c’est ça, le « vivre ensemble » ?
- Le Conseil d’État et la Justice au chevet de SOS Méditerranée
- Cannes 2024 : un festival de bien-pensance
- Au Soudan, un nettoyage ethnique contre les non-Arabes, dans l’indifférence générale