Pour le gouvernement, la traite des vieux est moins coûteuse que leurs retraites
À l’heure où cet article sera publié, combien de nos vieux auront battu le pavé, à Paris et en province, pour exprimer leur ire face à la hausse de la CSG (qui touchera tous ceux dont la pension est supérieure à 1.200 euros par mois) récemment décidée par le gouvernement ? Les chiffres varieront immanquablement entre les estimations syndicales et celles rapportées par la police.
Mais qu’importe, finalement. D’abord, la poignée de manifestants qui défilera dans les rues en scandant des slogans prémâchés n’impressionnera personne sous les ors feutrés des ministères ; ensuite, en admettant que leurs revendications parviennent aux oreilles d’un obscur sous-dircab ministériel ayant reçu, in extremis, l’ordre de recevoir une délégation à la composition hautement encadrée, à quoi cela aura-t-il servi, au total ? Ressusciter un pâle frisson révolutionnaire chez les uns, enterrer les récriminations – en attendant les prochaines sur l’air bien connu du « Je vous ai compris » – pour les autres.
Car la vérité oblige à dire que tout le monde s’en fout pas mal, de savoir si monsieur et madame Dupont – lui, ancien ouvrier-verrier chez une entreprise célèbre, désormais rachetée par un fonds de pension américain, elle, ancienne préposée de La Poste – tirent la langue pour boucler leur budget en fin de mois, si madame Michu, diabétique, avec ses moins de 800 euros mensuels, fait régulièrement la queue devant le Secours populaire, si monsieur Bidule, 70 ans, ancien déménageur, perclus d’arthrose déformant, tente d’améliorer l’ordinaire en proposant de menus services au noir, si madame Machin, veuve octogénaire, n’ayant jamais – ou peu s’en faut – travaillé, se retrouve quasiment abandonnée, ne pouvant même pas compter sur sa seule fille travaillant à l’étranger, si…, si…, si…
L’on pourrait prolonger, ad nauseam, cette funeste antienne de nos centaines de vieux qui bouffent journellement de la vache enragée, rare bidoche de subsistance que leur permet leur bourse désespérément plate et leur bouche édentée n’ayant pu encore trouver le confort d’une prothèse idoine que leur impécuniosité leur interdit. Comme cette ancienne ouvrière des tisseries du nord de la France qui enrage : "Son invalidité reconnue, l'ouvrière a fini sa carrière professionnelle à mi-temps. Et elle y a perdu. “Mes quatre dernières années n'ont pas été comptabilisées. Si j'avais su que le montant de ma pension serait calculé en fonction de mon invalidité, j'aurais refusé le statut, explique-t-elle. J'aurais traîné la patte, mais au moins j'aurais eu 1.100 euros. Ce n'est pas beaucoup plus, mais ça joue”" (France Info, 28 septembre). Malade et spoliée. À l’injustice de la vie s’ajoute celle, ignominieuse, d’un système de protection sociale à bout de souffle. La double peine !
Jamais, pourtant, l’on avait entendu partout répéter les mots, si insupportablement creux, de « solidarité », de passerelle intergénérationnelle, de « lien social », autant de syntagmes galvaudés qui finissent, telles des baleines crevées, par s’échouer sur les berges sinistres de la méga-machine techno-capitaliste. Ces larmes de crocodile accompagnent cyniquement les violons de la modernité qui nous jouent les mélopées hideuses de cette nouvelle Ballade de Narayama 2.0. Les anciens sont devenus la variable d’ajustement comptable d’une société inhumaine qui a choisi de s’autoréguler en les éliminant sans le dire, sous des dehors "soft" et "care". Bref, foin de retraite, place à la traite !
Telle est la « Nouvelle société » désirée par Macron et ses épigones attaliens de l’oligarchie.
Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR
L'intervention média
Les plus lus de la semaine
LES PLUS LUS DE LA SEMAINE
Les plus lus du mois
LES PLUS LUS DU MOIS
- Gabrielle Cluzel - 49 141 vues



















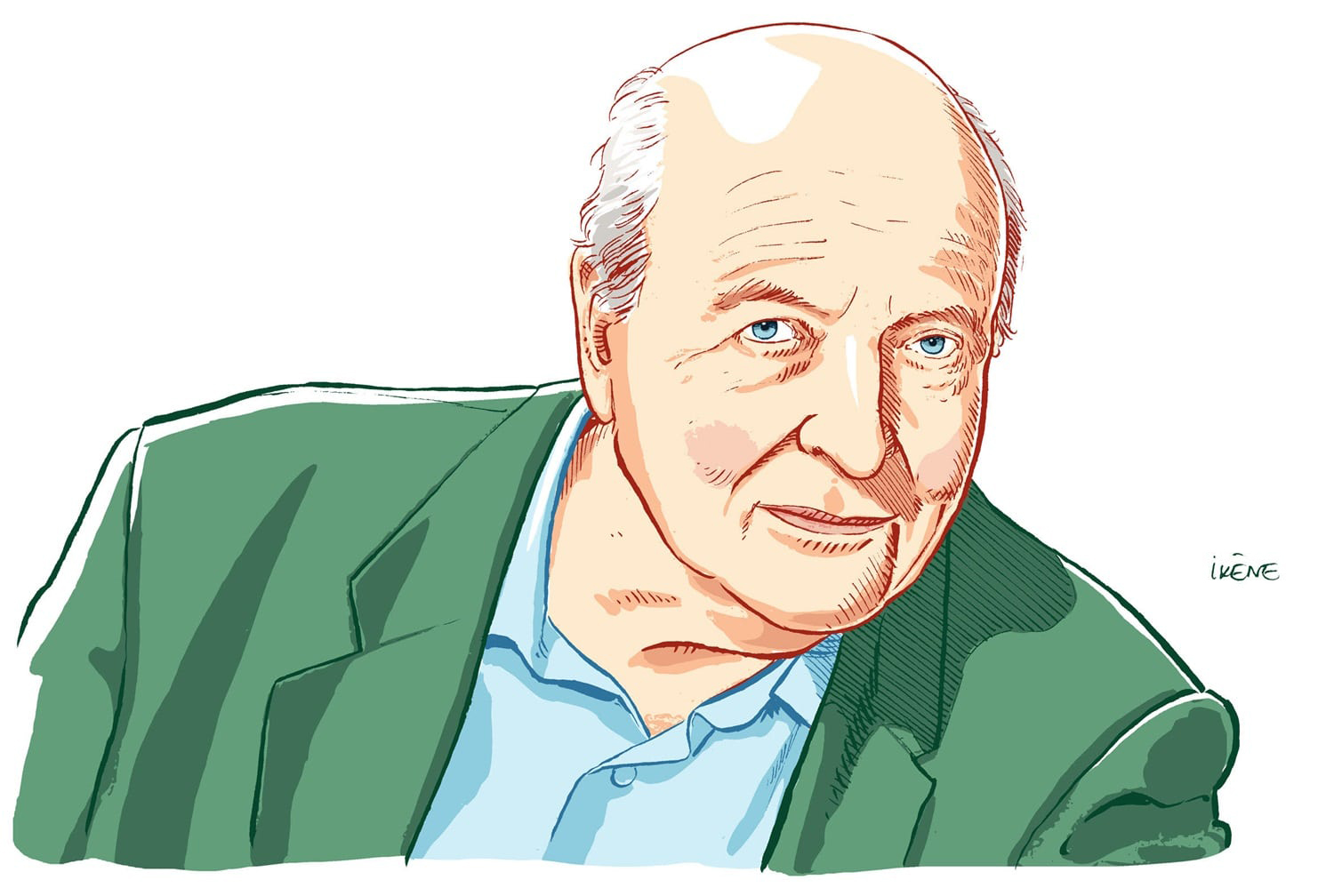


















BVoltaire.fr vous offre la possibilité de réagir à ses articles (excepté les brèves) sur une période de 5 jours. Toutefois, nous vous demandons de respecter certaines règles :