Black Blocs : la violence comme un des beaux-arts
Chacun le sait désormais : Le « Schwarzer Block », d’abord apparu à Berlin-Ouest pendant l'hiver de 1980 contre les policiers qui vidaient les squats, est devenu "Black Bloc" après les événements de Seattle, dix ans plus tard.
Regroupements éphémères d’individus, reliés par les réseaux sociaux, porté par une espèce de romantisme révolutionnaire, c’est un précipité d’anarchistes, d’écologistes, de communistes revanchards ou de militants sexuels qui ont tous en commun de récuser la démocratie, ce qui ne les empêche pourtant pas de condamner le fascisme ! On les retrouve en juillet 2001 lors du G8 à Gênes, le 4 avril 2009 au sommet de l'OTAN à Strasbourg.
À leur avantage, l’attention médiatique qu’ils engendrent. Les manifestations paisibles intéressent moins les journalistes. Le mouvement est indissociable des réseaux sociaux : censure inopérante, mobilité, communication en temps réel. Ils permettent des actions spontanées là où des occasions apparaissent, ils se font et se défont à l’image des regroupements tout en offrant une identité. Par les réseaux sociaux, les activistes deviennent ainsi membres d’une communauté pourtant volatile par définition.
Devant la 23e chambre correctionnelle, le profil de ces activistes était édifiant. Aucun n’était en rupture avec la société. Un consultant au revenu mensuel de 4.200 €, une directrice de production dans le cinéma, un cuisinier, des étudiants en sciences, en histoire ou en psychologie, un cadreur… Bref, une jeunesse issue de milieu sociaux privilégiés. Aux trois catégories traditionnelles des manifestants (militants, sympathisants et indignés) vient s’ajouter, avec le Black Bloc, celle des esthètes de la violence. Sous une revendication bidon, mais qui se réclame de la gauche progressiste pour se garantir la sympathie des médias, il s’agit d’une catharsis, d’un défoulement collectif comme compensation dans nos sociétés émollientes à un avenir tracé et sans surprise d’appartenance à la moyenne classe bourgeoise. L’aventure permet au casseur d’exister pleinement dans un moment éphémère mais paroxystique, de s’apparenter à une communauté qui vit une geste héroïque et, enfin, d’être magnifié dans les médias.
De surcroît, elle est sans risque : on moleste un peu, mais on ne tue pas, on casse ou on brûle, avec la relaxe la plupart du temps si, par malheur, on se fait prendre. Rien à voir avec les luttes armée des groupes terroristes tueurs d’extrême gauche des années 1970. Sous une autre forme, c’est la même impulsion qui anime les cadres sup lorsqu’ils se déguisent en Hells Angels le week-end pour rouler en Harley. Ce qui n’empêche pas certains sociologues d’expliquer sans rire que c’est une violence dirigée contre les symboles du capitalisme. Il serait sûrement plus juste d’y discerner une sorte de performance artistique. Cet esthétisme de la violence était déjà le thème du livre et du film Orange mécanique.
Quant aux résultats, les effets contre-productifs sont tels que c’est à se demander si le curriculum caché de ces crétins en mal d’existence n’est pas, au contraire, de servir le patronat, le capitalisme et cette bourgeoisie qu’ils affirment abhorrer mais à laquelle ils appartiennent pleinement. Car les véritables dindons de la farce, ce sont les vrais laissés-pour-compte. Ce sont les petits, les sans-grade, aux fins de mois difficiles, qui n’ont pas eu la chance de pouvoir faire des études ou de pouvoir compter sur une famille aisée et qui, ingénument, s’imaginent être dans le même camp.
Thématiques :
Black BlocsPour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR
Un vert manteau de mosquées

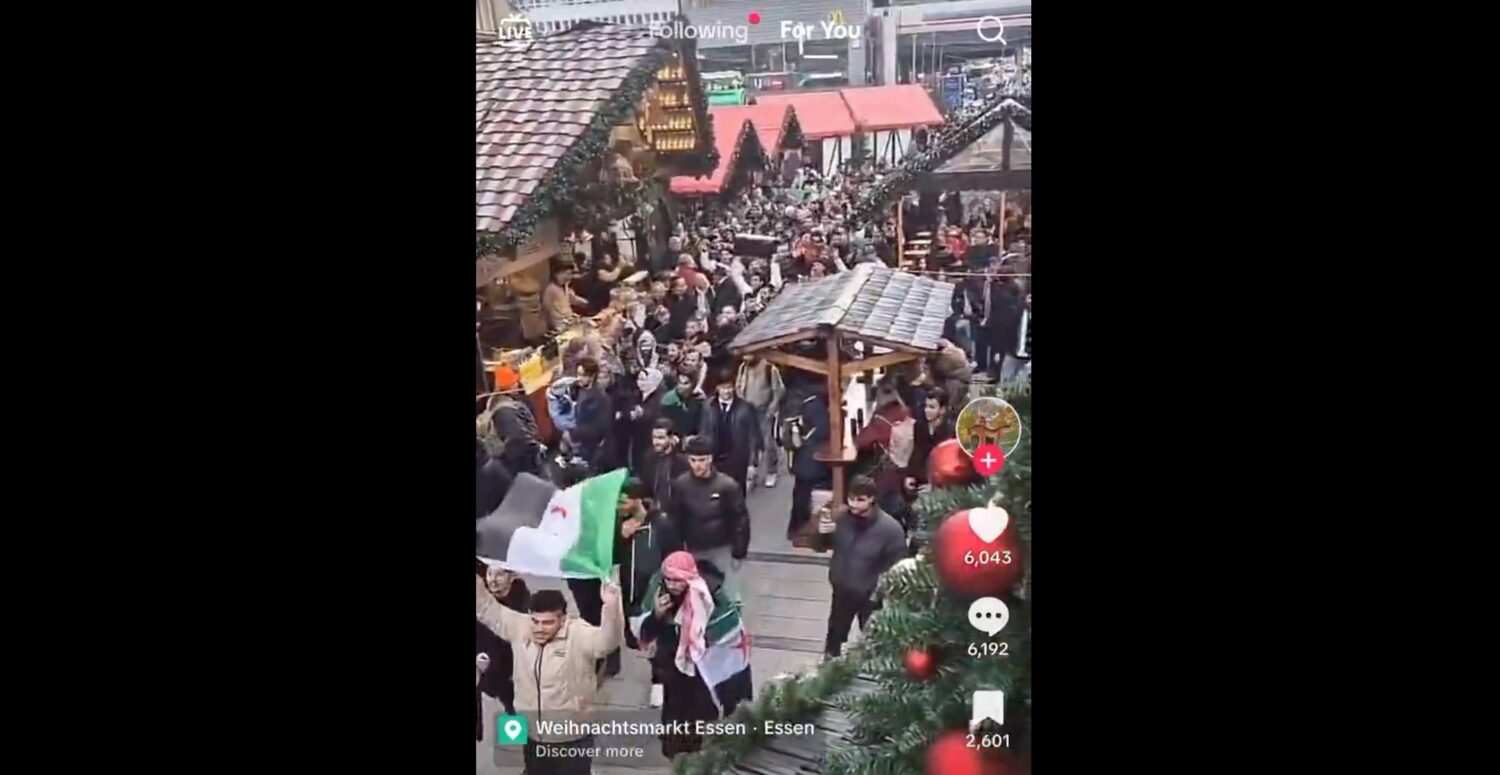




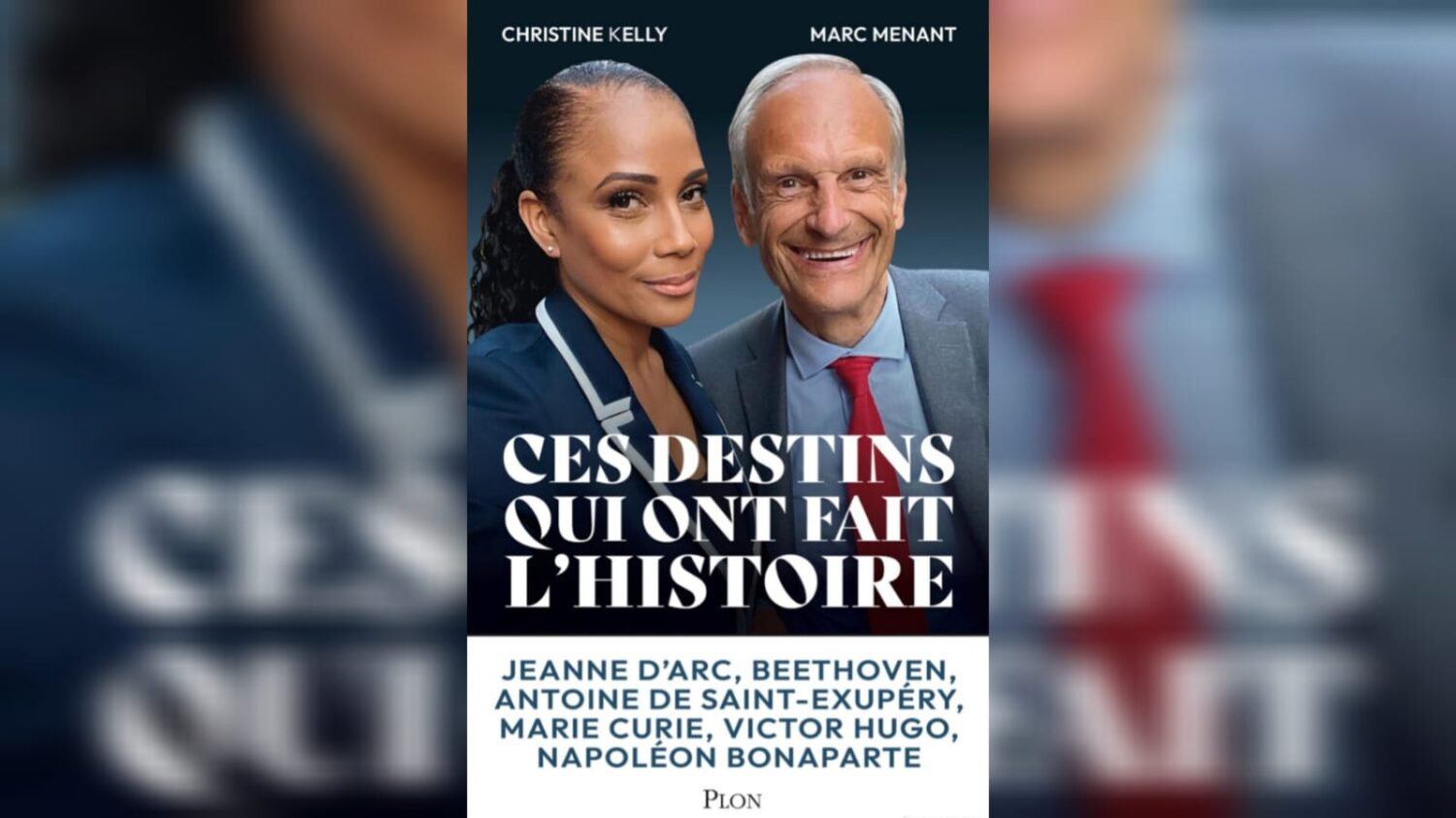




























BVoltaire.fr vous offre la possibilité de réagir à ses articles (excepté les brèves) sur une période de 5 jours. Toutefois, nous vous demandons de respecter certaines règles :