Crise du Covid-19, défaite de Trump : la fin du populisme ?

Dès le lendemain des résultats des élections américaines, Enrico Letta, ancien président du Conseil italien, professeur à Sciences Po et président de l’Institut Jacques-Delors, exultait : selon lui, la défaite de Donald Trump marquait un coup d’arrêt au populisme, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, et plus particulièrement en Italie. « Il a perdu Matteo Salvini, il ne construira plus rien à l’avenir. Tous les souverainistes italiens ont perdu avec la défaite de Donald Trump. Ils ont perdu le mégaphone pour le populisme de la Maison-Blanche », écrivait-il dans L’Obs.
Certes, la défaite de Trump, et plus particulièrement la rébellion de Davy Crockett aux marches du Capitole, plus farcesque que fasciste, ne vont pas aider ceux que l’on nomme « populistes » à conquérir ou conserver le pouvoir. Mais pratiquer ainsi le maniement de l’insulte – car le mot « populiste » est employé comme tel dans les cercles intellectuels et médiatiques comme par la plupart des dirigeants européens - pour désigner les rebelles, les « déplorables », les rétifs, les « demeurés de l’histoire » (Chantal Delsol) ne réglera pas la question.
Pourquoi ? Dans son essai remarquable sur le populisme, Chantal Delsol tente, au-delà de la signification insultante, de cerner le populisme, elle en retrace la généalogie mais, surtout, en explique la substance. « Les courants dits populistes critiquent l’individualisme moderne et défendent les valeurs communautaires de la famille, de l’entreprise, de la vie civique. Ils défendent le travail comme valeur » tandis qu’ils « déplorent l’effacement des solidarités dans la société postmoderne, l’égoïsme découlant de la dissolution de la famille ».
En France, on peut dire qu’Emmanuel Macron en est l’antithèse, et sa gestion de la crise du coronavirus en a été le paroxysme : la stratégie archaïque du confinement a particulièrement corrodé les liens familiaux et sociaux, a plongé nombre d’entrepreneurs dans les affres de la dépression, économique et psychologique, en les privant de la liberté essentielle de travailler, a sacrifié la jeunesse, cet âge d’or social, au profit du « tout sanitaire ». Et l’on apprend, aujourd’hui, que la natalité française n’a jamais été aussi basse que depuis 1945.
Les populistes, en réalité, se rattachent donc à une certaine tradition conservatrice, dont le souverainisme n’est d’ailleurs qu’un aspect. Or, comme l’écrit Alexandre Devecchio dans Le Figaro, « la crise du coronavirus, en révélant les failles de notre économie mondialisée, confirme une partie du diagnostic des populistes et légitime leur vision protectionniste. Les concepts d’État-nation, de contrôle des frontières, de souveraineté politique et économique, de relocalisation de la production, traditionnellement défendus par les “populistes”, sont en train de revenir en grâce aux yeux de l’opinion. »
Tout cela ajouté au gouffre qui sépare les « élites » au pouvoir du peuple qui en subit les décisions - les répercussions de l’affaire Duhamel en sont la parfaite illustration - tend à montrer que le populisme, en tant que force qui veut redonner sa juste place au politique et réhabiliter l’antique politeia, n’est pas mort. C’est sans doute la solution pour affronter, en toute liberté, en toute indépendance, les défis gigantesques posés par l’après-coronavirus.
Ou pas.
Depuis un an, les restrictions de libertés auxquelles sont soumis les Français sont inouïes. Alliées à cette angoisse diffuse et omniprésente par laquelle le gouvernement assoit son pouvoir, à défaut de son autorité, ces atteintes à la liberté ont singulièrement rétréci la vie de nos concitoyens. Épuisés, anxieux, appauvris, ces derniers ne vont-ils pas devenir ce peuple au dos courbé qui n’arrive plus à réagir ?
Le plus grand danger n’est pas sanitaire : il est celui de la résignation d’un peuple tout entier.
Thématiques :
PopulismePour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR
Un vert manteau de mosquées



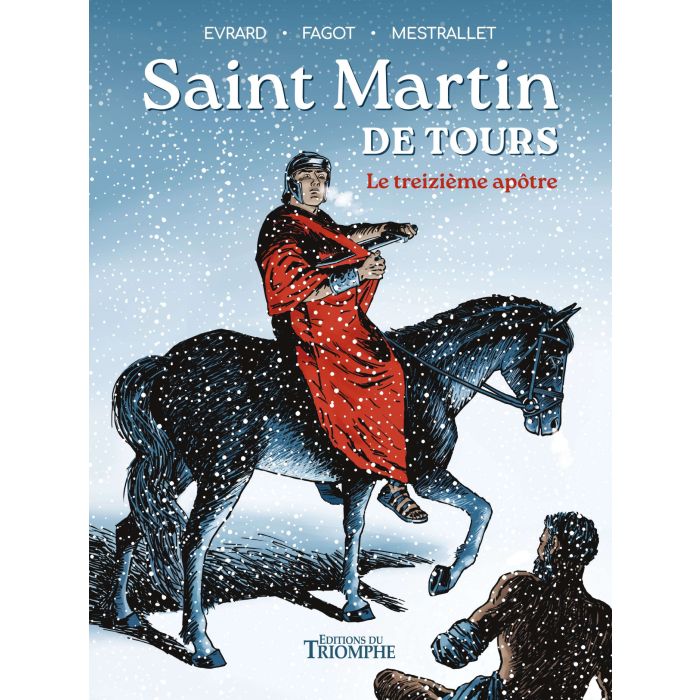


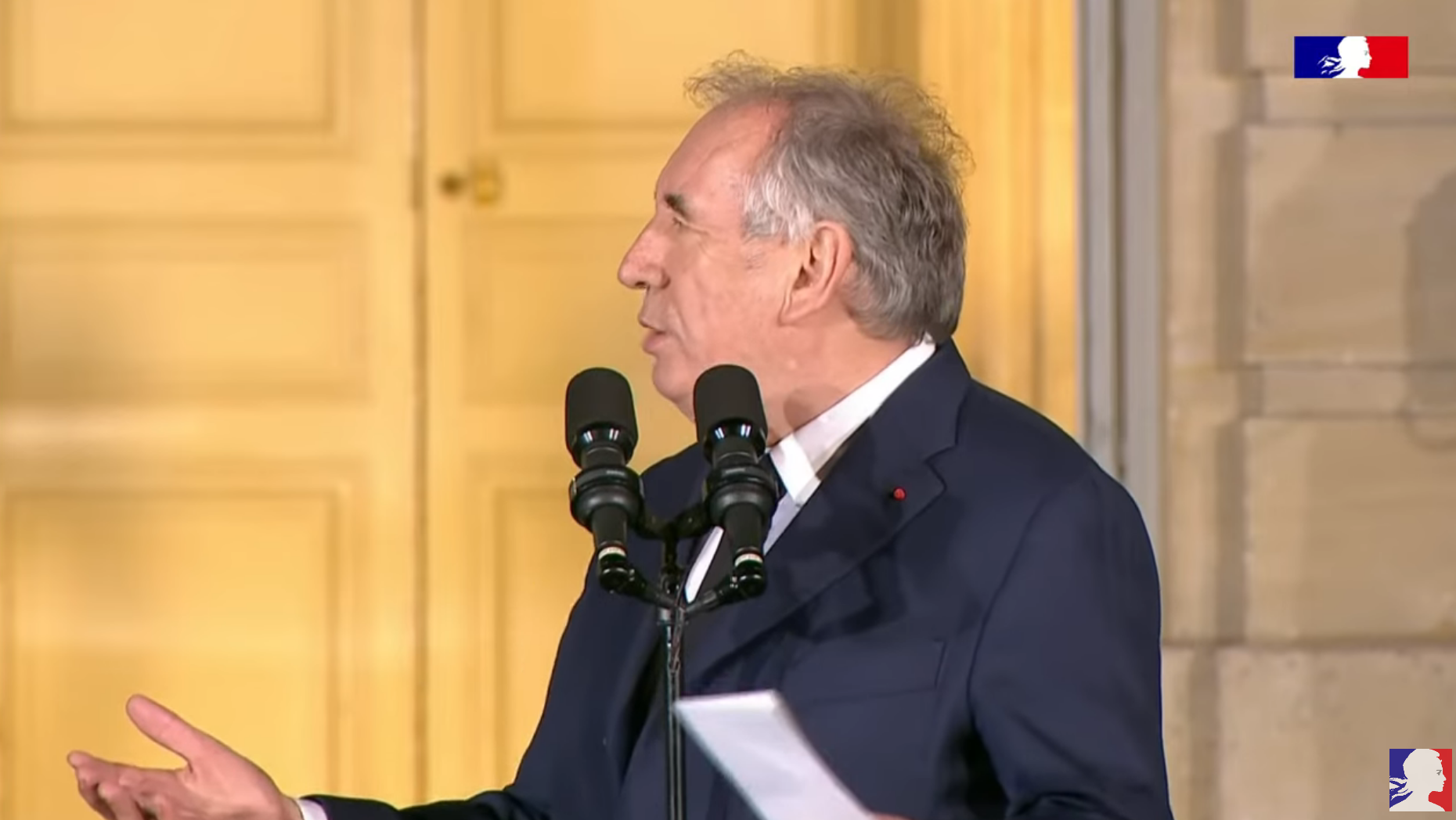











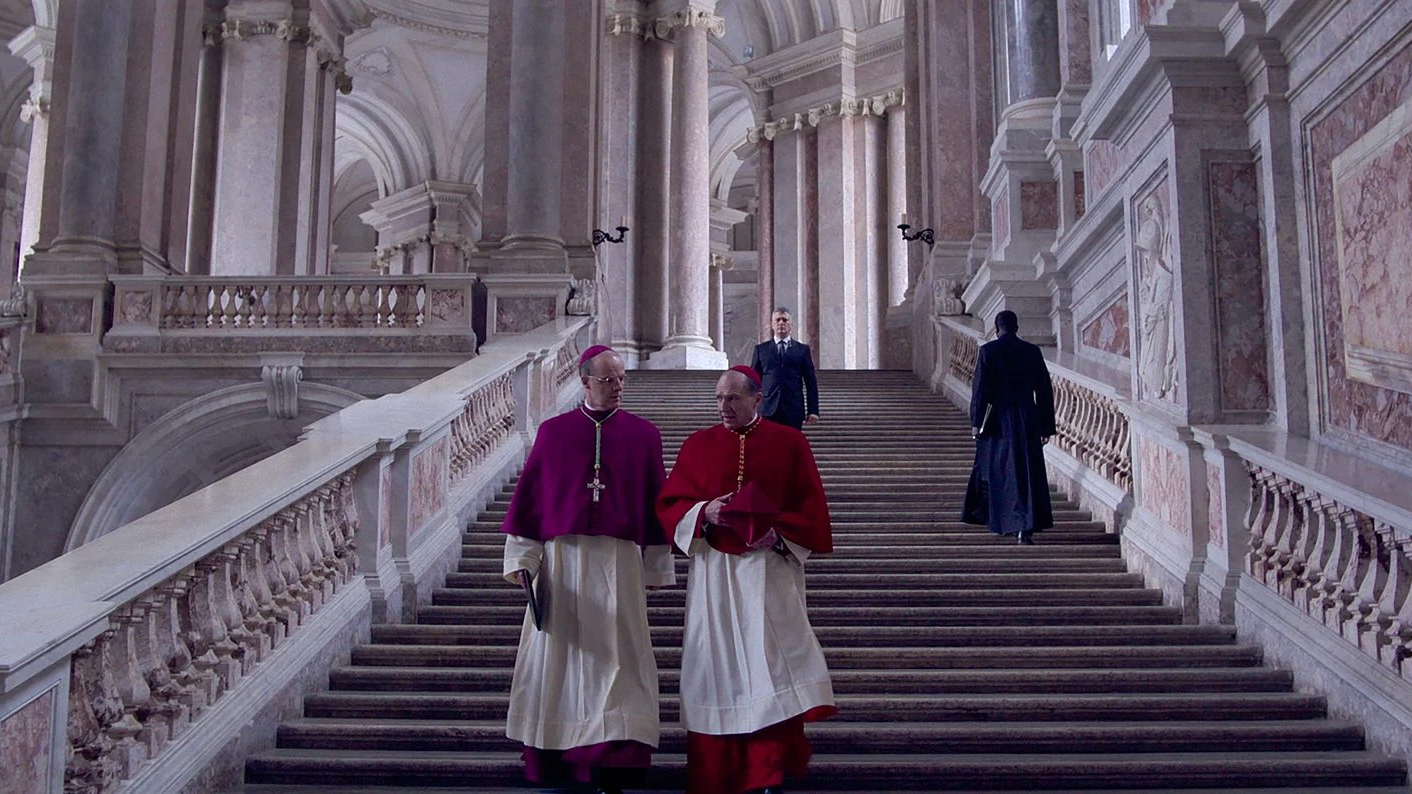



















BVoltaire.fr vous offre la possibilité de réagir à ses articles (excepté les brèves) sur une période de 5 jours. Toutefois, nous vous demandons de respecter certaines règles :