DVD : Le Sang du vampire, d’Henry Cass

Quand on pense au cinéma d’épouvante gothique britannique, c’est évidemment la mythique maison Hammer qui vient à l’esprit. En effet, plus qu’un simple studio, la Hammer fut une institution qui, avec les Beatles, faisait beaucoup pour l’équilibre de la balance commerciale d’Albion. Bref, dans le Swinging London, on frissonnait anglais.
À la Hammer, Peter Cushing (baron Frankenstein) et Christopher Lee (comte Dracula) doivent aussi leur renommée tant aristocratique qu’internationale. Sinon, George Lucas ne les aurait pas tous deux embauchés dans La Guerre des étoiles, et jamais Peter Jackson n’aurait songé au prince vampire pour incarner le mage Saroumane dans Le Seigneur des anneaux.
Pourtant, dans les sixties, il n’y a pas que la Hammer pour porter haut la cinéphilie locale ; d’autres honorables firmes, d’envergure certes plus modeste, tiennent également leur rang, telle la compagnie Tempean, fondée par deux artisans ne doutant de rien : Monty Berman et Robert Baker. Lesquels, en 1960, produisent l’extraordinaire L’Impasse aux violences, film consacré aux méthodes douteuses de William Hare et William Burke, voyous des bas-fonds ayant fait fortune en fournissant les médecins d’alors en cadavres fraîchement déterrés.
Deux ans plutôt, avec Le Sang du vampire, ils avaient déjà tous deux creusé le sillon de cette « science sans conscience » ayant vocation à devenir « ruine de l’âme » en confiant au réalisateur Henry Cass le film qui est le sujet de ces lignes. Malgré un titre un brin trompeur, il n’y a guère de vampire à l’horizon, même s’il est évidemment beaucoup question de sang, avec la démesure et l’irresponsabilité des apprentis sorciers mises à l’honneur avec quelques décennies d’avance sur notre époque « d’homme augmenté ».
La preuve en est ce docteur Callistratus, directeur d’un hôpital psychiatrique et incarné par Donald Wolfit, immense acteur shakespearien d’alors et grimé en Bela Lugosi, historique interprète du vampire des Carpates, prêt à tout pour assurer sa propre survie. Il se fait donc transférer le sang des miséreux et de ces pauvres hères donnés pour fous, dont il a la charge, juste histoire d’assurer bien-être et survie. Un peu comme, aujourd’hui, de riches oisifs s’en vont acheter dans le tiers-monde ces enfants que la nature les empêche d’engendrer.
Derrière ces interrogations dont les auteurs de ce film n’étaient forcément pas conscients, ignorants qu’ils étaient de cette règle cauchemardesque voulant que la fiction finisse tôt ou tard par précéder la réalité, il y a là une œuvre n’ayant guère pris de rides. Logique : il est rare de voir le bon artisanat se démoder. La mise en scène est donc à l’ancienne, le serviteur difforme ne manque pas à l’appel, les robes et les dames y sont plus que belles ; l’une d’elles est même très en avance sur son époque, puisque n’hésitant pas à mouiller le corsage pour aider à dénouer l’intrigue, et il ne manque pas un seul chandelier dans ce décor victorien, alors que la violence s’y trouve même étonnamment audacieuse pour l’époque.
Au final, un petit classique, jusque-là seulement révéré par un cénacle d’admirateurs mais qui, désormais, grâce aux magiciens d’Artus films, est à nouveau disponible pour un plus grand public. Et comme chez ces courageux petits éditeurs, c’est Pâques et Noël tous les jours, l’objet étant accompagné d’un passionnant essai signé d’Alain Petit, jadis imam caché du « Cinéma de quartier« », émission jadis diffusée sur Canal+ et présentée par Jean-Pierre Dionnet, chantre du cinéma populaire européen. En un mot comme en cent, les cinéphiles sont à la fête !

Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR
Un vert manteau de mosquées





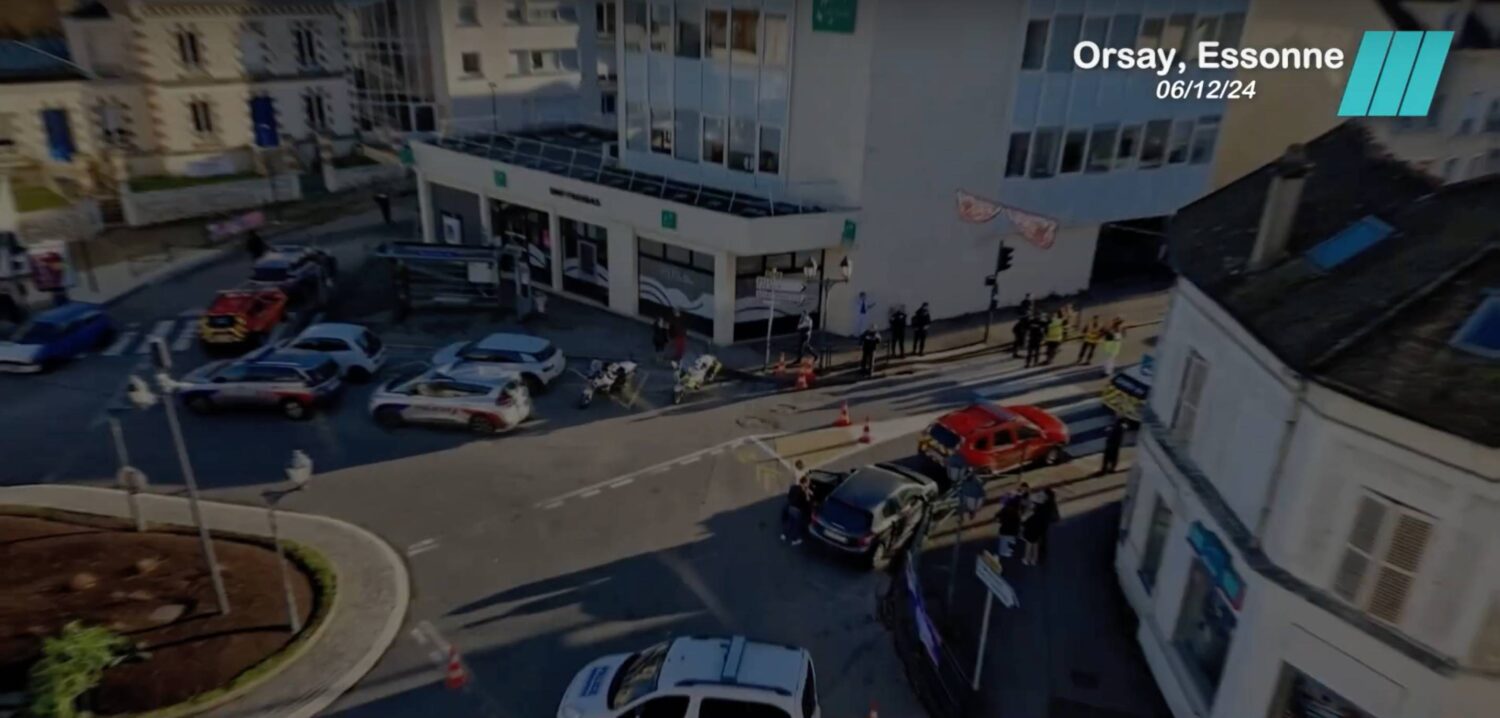
































BVoltaire.fr vous offre la possibilité de réagir à ses articles (excepté les brèves) sur une période de 5 jours. Toutefois, nous vous demandons de respecter certaines règles :