Conte de Noël : Tombé du ciel, de G. Lenotre

L’esprit de Noël est encore présent. Le temps d’une lecture, de retrouver son âme d’enfant.
Aujourd’hui, Tombé du ciel, de G. Lenotre (1855-1935), tiré de Légendes de Noël, choisi par Gabrielle Cluzel.
La comtesse de Cherizet comptait bien quatre-vingts ans lorsque je l’entrevis, étant encore un très jeune enfant. Elle était, à la fois, active et silencieuse, recueillie et enjouée : elle portait, dans toute son allure, cette sérénité indéfinissable des vieilles gens auxquelles il est arrivé de grands bonheurs et qui sont certains de rester, jusqu’à leurs derniers jours, les enfants gâtés de la Providence.
Autour d’elle vivait une bande de gamins turbulents, adorés et respectueux, ses petits-fils, dont j’étais le compagnon de jeux et d’études, et je me rappelle qu’un jour d’hiver, nous étions tous groupés, au coin du feu, près de l’aïeule. C’était la veille de Noël. La grand’mère, qui paraissait n’écouter pas, jugea opportun le moment d’intervenir :
« Il faut toujours mettre ses souliers dans la cheminée, dit-elle d’un ton qui n’admettait pas de réplique.
— Mais, grand’mère…
— À tout âge, mes petits, vous m’entendez, à tout âge ce qu’on désire tombe du ciel. Moi, j’ai reçu du petit Jésus un mari et une dot.
— Un mari !
— Une dot !
— Par la cheminée !
— Oui, par la cheminée. »
Elle posa son ouvrage sur ses genoux et commença une histoire. Elle nous conta combien son enfance avait été triste : elle avait perdu ses parents pendant la Révolution ; la mère morte en prison ; le père fusillé à Quiberon. Recueillie par une vieille parente émigrée, elle avait ainsi passé toute sa jeunesse à l’étranger ; elle s’était retrouvée seule à Paris, au temps de la Restauration, sans appui, sans ressources. Il ne lui restait que le vieil hôtel familial, abandonné depuis vingt ans, dévasté, bon à abattre et dont la valeur suffirait à peine à payer la modeste dot, nécessaire à la jeune fille pour être reçue dans un couvent où elle pourrait finir ses jours. Elle n’avait, il est vrai, qu’une vocation résignée ; mais que devait-elle espérer de la vie ? Déjà l’hôtel qu’elle habitait était vendu ; les démolisseurs attendaient qu’elle l’eût quitté ; les meubles, depuis quelques jours, étaient partis pour l’encan. Elle ne s’était réservé qu’une chambre au premier étage, sommairement garnie d’un lit et de quelques chaises.
La dernière journée qu’elle vécut dans cette noble maison, où elle était née, fut particulièrement pénible. C’était le 24 décembre 1815 ; le lendemain, fête de Noël, elle devait se rendre, dès la première heure, au monastère de la Visitation, rue Saint-Jacques.
Elle errait seule dans les grandes salles démeublées. Une femme de ménage, qui l’avait servie dans les derniers temps, venait, pour la nuit, coucher dans l’ancienne loge du suisse.
« Oui, oui, je m’en souviens bien de cette soirée-là, contait la grand’mère, avant de m’endormir, je voulus revoir une dernière fois cette maison où j’étais née, où mes parents avaient vécu. Une bougie à la main, je parcourais les hautes pièces sonores, pleines d’ombre et de froid, dont les tentures pendaient comme de gigantesques toiles d’araignée. Au dehors, la rue était silencieuse ; c’était une triste époque.
« Quelques jours auparavant avait été fusillé le maréchal Ney, partout, dans Paris, on traquait les fidèles de Napoléon. On ne parlait que de conspirations, de complots, de poursuites, de représailles, et, la nuit venue, le seul bruit qui troublait le silence lourd de la rue était celui du pas rythmé des patrouilles grises faisant leur ronde.
« Bien morose et mélancolique, je fermai enfin les portes et revins à ma chambre, – la chambre où s’était passée ma petite enfance heureuse. Je m’apprêtai à m’étendre sur le lit – mon lit à moi, – pour la dernière fois. 11 heures venaient de sonner ; je délaçai mes brodequins, quand tout à coup, dans la nuit calme, les cloches de Saint-Thomas d’Aquin commencèrent à carillonner en volée. Alors seulement, je songeai à la messe de minuit qu’elles annonçaient et ma pensée se reporta aux Noëls d’autrefois. C’était loin, si loin !… Je me revoyais, dans cette même chambre, au temps où ma bonne mère vivait, mettant, le soir, si joyeuse, mes petits souliers dans la cheminée. Cet âtre, aujourd’hui noir et froid, je le revoyais aux matins radieux des Noëls de jadis, encombré de paquets blancs coquettement enrubannés, de friandises artistement disposées sur de beaux papiers à collerettes, de poupées roses et blondes, de livres aux reliures rutilantes… Oui, c’était loin ! Je restais là, songeuse, les pieds dans des babouches, mes brodequins à la main, et voilà que, timidement, presque honteuse, je m’approchai de l’âtre et je les disposai sur le foyer : une idée folle, le désir ingénu, ridicule, d’éprouver une dernière fois l’impression d’enfance que jamais, jamais plus, je n’aurais la possibilité de ressentir.
« Ah ! qu’ils faisaient triste mine, mes pauvres souliers, sur ce marbre fendu. ils avaient l’air si mélancoliques, si sûrs que, cette nuit-là, il ne leur tomberait rien du ciel !
J’allais me mettre à pleurer, quand un épouvantable fracas me fit sauter, éperdue, à l’extrémité de ma chambre : une détonation de tonnerre, un vacarme semblable à celui d’un tombereau de pavés, versé de haut, sur le parquet. Il me sembla que la maison s’éventrait du haut en bas ; un nuage de poussière âcre remplit la pièce, que je vis aussitôt encombrée d’un tas de plâtras, de moellons noircis, de briques en morceaux, de blocs de suie. Évidemment la cheminée, sur le toit, venait de s’abattre. Et je reprenais mon sang-froid quand, m’approchant, la bougie à la main, pour juger du dégât, j’aperçus deux pieds, deux pieds d’homme, chaussés de bottes boueuses, qui, suspendus dans la cheminée, s’agitaient, désespérément, comme pour chercher un point d’appui qu’ils ne rencontraient pas.
Je vis, glacée de peur, les pieds, tâtonnant, descendre peu à peu, toucher les plâtras amoncelés dans l’âtre, éprouver la fermeté de ce sol, s’y poser… Puis j’aperçus des jambes, les pans d’une redingote ; un homme rampa à reculons, sortit dans la chambre et se dressa devant moi, les mains écorchées, le visage noirci. Son premier mouvement fut de s’essuyer en passant sur son front sa manche déchirée. Moi je regardais, le sang figé, cette apparition terrifiante. L’homme s’ébroua, se frotta les yeux, distingua la bougie, me vit, recula d’un pas et, joignant les mains :
« — La vie, par grâce, sauvez-moi la vie ! »
« Je ne pouvais pas répondre. Il alla jusqu’à la fenêtre, guetta les bruits de la rue, se retourna vers moi et balbutia, encore tout haletant de sa chute :
« — Madame, mon sort est dans vos mains. Je suis poursuivi,… je suis malheureux… »
« Il écouta encore, l’oreille tendue vers la rue.
« — Pour Dieu ! Répondez-moi un mot. Qui habite cet hôtel ?
— Moi.
— Seule ?
— Seule. »
« Il me dévisagea anxieusement.
« — Oh ! mademoiselle, une heure, une heure de répit seulement : laissez-moi passer une heure ici, – cette heure-là me sauve. Je suis le comte de Cherizet, un officier de l’Empereur. J’ai conspiré, ou, du moins, on m’accuse. Oui, j’ai conspiré, je vous dis la vérité, pour sauver Ney. Avant-hier, on est venu m’arrêter, j’ai fui… Vous êtes certaine que personne d’autre que vous n’habite cette maison ?
— Personne.
— Voilà deux nuits que j’erre par les rues ; je pensais, ce soir, gagner un refuge sûr ; j’ai traversé Paris. À l’angle de la rue Taranne, une patrouille… J’ai couru ; mais j’étais dépisté. J’ai sauté un mur, atteint un tuyau de gouttière ; j’ai monté sur un toit. Je comptais me dissimuler, attendre que les policiers fussent loin ; mais j’avais été vu. J’avisai une cheminée, j’imaginai de me cacher dedans et je m’y laissai couler, espérant remonter facilement. Et, en effet, mes pieds rencontrèrent dans le conduit très large un relief dans la maçonnerie, une saillie que je jugeai solide et où je pensais me maintenir assez longtemps ; mais la cheminée, sans doute, est de construction ancienne, la saillie de plâtre s’effrita sous mon poids, céda brusquement et je tombai… »
« Il resta quelques instants silencieux, cherchant à vaincre son émotion, et il ne cessait de me regarder, de ses grands yeux suppliants et inquiets :
« — Je suis un homme d’honneur, mademoiselle ; mon dévouement à l’Empereur est mon seul crime. Quel que soit le parti auquel vous apparteniez… »
« Je fis un geste pour lui signifier que cela importait peu.
« — Oui, répéta-t-il, mon seul crime.
— Restez. »
« Il chancela, s’appuya contre la cloison et, d’une voix faible, murmura :
« — Merci. »
« Tout de suite, il se reprit, fit quelques pas dans la chambre, poussa un soupir :
« — Je n’en puis plus. »
« Je lui présentai la chaise ; il s’y laissa tomber.
« — Par pitié, un peu d’eau, » demanda-t-il.
« Il passa un linge mouillé sur ses tempes, sur son visage et sur ses mains. Je le regardai faire ; c’était un homme d’une trentaine d’années, à la figure très énergique et très douce, mais très triste et pâle aussi. Je pris courage et lui adressai la parole :
« — Avez-vous faim ? »
« Il eut un haussement d’épaules découragé.
« — Voilà, répondit-il, voilà quarante heures que je n’ai rien pris ; je tombe d’inanition… Excusez-moi. »
« Je sortis de la chambre. J’avais laissé dans la pièce voisine, sans y toucher, le souper que m’avait préparé Tiennette. J’apportai le plateau dans ma chambre, je le disposai sur un guéridon que je poussai près de mon proscrit, et j’étalai devant lui une serviette blanche. Il y avait du pain, des marrons, des œufs durs, un flacon de vin vieux retrouvé par Tiennette au fond d’un caveau. Le comte avait repris tout son sang-froid. J’allumai une seconde bougie, et ce luxe inusité donnait à ma chambre un air de fête. À l’église voisine, les cloches se reprirent à sonner allègrement, égrenant dans la nuit leurs voix grondantes ou grêles avec une solennité joyeuse. Mon hôte parut étonné : tous les bruits du dehors l’angoissaient.
« — La messe de minuit, fis-je pour le rassurer.
— Ah ! »
« Et comme je l’invitais, du geste, à entamer la collation :
« — Alors, dit-il en souriant, vous me conviez au réveillon ? »
« Et, de fait, nous réveillonnâmes ensemble. Je n’avais plus peur du tout ; l’aventure me semblait toute simple, et, de le voir manger avec un appétit plein d’entrain, cela me donnait une faim ! Les émotions m’avaient creusée et, sur son invite gracieuse, je m’assis en face de lui… Ah ! mes petits, le bon souper ! On causa, d’abord avec quelque gêne, de choses vagues, puis peu à peu la conversation prit le ton des demi-confidences. Les choses ont bien changé depuis que ceci s’est passé ; les gens ni les mœurs ne sont plus les mêmes. À mesure qu’il parlait et qu’il mangeait, il devenait tout autre ; il s’exprimait avec une grande distinction, d’une voix respectueuse, assourdie, presque tendre… Non, certes, ces choses-là n’arrivent plus. »
« J’avais mon plan, continua-t-elle. Quand le comte fut bien réconforté, reposé, et manifesta l’intention de partir :
« — Suivez-moi sans bruit », lui dis-je.
« J’ouvris la fenêtre qui communiquait au balcon s’étendant sur toute la façade de l’hôtel. À l’extrémité de ce balcon, comme c’était d’usage dans les vieilles demeures, se trouvait un escalier de fer en spirale qui descendait au jardin. Je le conduisis par là jusqu’à une petite porte donnant accès à un dédale de ruelles étroites. J’ouvris les verrous de la porte, je fis quelques pas dans la ruelle, très déserte et très sombre, je reconnus que personne n’y était aux aguets. Je revins au comte.
« — Allons, adieu, » lui dis-je.
« Il me regarda d’un air soumis, un peu attristé peut-être.
« — Adieu ? répéta-t-il d’un ton interrogatif.
« — Oui, adieu. J’entre demain au couvent. »
« Il s’inclina profondément. Comme j’étendais la main pour lui indiquer sa route, il la saisit, y posa un baiser si respectueux, si discret, pourtant si tendre et si ému, que moi-même, je me sentais un peu troublée… Il s’éloigna brusquement ; j’entendis le bruit de ses pas se perdre dans la ruelle, je restai encore là, un moment, à guetter ; puis je fermai la porte, traversai le jardin et rentrai dans ma chambre, où je ne fermai pas l’œil de toute la nuit.
« Le lendemain matin, avant l’aube, Tiennette entra dans ma chambre pour allumer le feu, suivant l’habitude, et m’aider à mes préparatifs de départ : je devais être à la Visitation pour l’heure de la grand’messe. J’entendis la brave femme pousser un grand cri.
« — Seigneur ! Jésus, mon Dieu ! qu’est-ce que ce déboulis-là ? En voilà un désastre !… Ce n’est pas Dieu possible que tout cet écroulement se soit abîmé sans que vous l’entendiez ! »
« Je balbutiai comme sommeillant encore :
« — Sans doute, j’ai entendu ; mais pas grand bruit ; un coup de vent, peut-être, sur une cheminée lézardée. »
« Mais Tiennette continuait à se lamenter et à geindre sur la poussière et la suie du parquet. Tout en bougonnant, elle avait pris un balai, et cherchait à repousser dans l’âtre les plâtras.
« — Et les souliers de mademoiselle qui sont pris là-dessous. Mais qui est-ce qui a donc fourré vos souliers là, mademoiselle ? »
« — Et dans quel état ! Ils ne sont plus mettables ; en voilà un qui est plein de suie ; et celui-là, mon Dieu, tout cassé, sous une pierre… Oh ! quelle pierre ! Mais qu’est-ce que c’est donc ? Comme c’est lourd… que c’est lourd !… »
« Un coffre, qu’on dirait… Et sur les souliers de mademoiselle, il y en a un qui est tout écrasé. »
« Intriguée, je passai un peignoir, j’allai à elle. C’était bien un coffret, tombé de la cheminée avec les plâtras ; sans doute il avait été muré dans ce massif qui s’était écroulé sous le poids du comte et c’était sa chute qui avait entraîné celle du fugitif.
« Tiennette s’extasiait :
« — Ça a été mis là, voyez-vous, du temps de la Révolution. Les vieilles maisons, c’est plein de trésors cachés… Oh ! mademoiselle, si c’était de l’or ! »
« Nos efforts réunis parvenaient à peine à remuer le coffret. Et puis, comment l’ouvrir ? Pas de clef ; la serrure, d’ailleurs, était obstruée de plâtre sec ; mais les goupilles des charnières étaient rouillées ; nous parvînmes à faire sauter l’une d’elles, puis l’autre ; enfin, le coffre s’ouvrit : il était rempli de piles de louis, entassées et alignées ; je regardais, stupéfaite, cet amoncellement de pièces à l’effigie des deux derniers rois.
« Tiennette, ébahie, comptait, poussant des exclamations :
« — C’est votre père, mademoiselle, c’est votre père qui a caché là cette fortune. »
Le coffre contenait cent cinquante rouleaux de cent louis : trois cent mille francs ! Moi, je demeurai, agenouillée près de Tiennette, les bras ballants, toute sotte et comme honteuse de voir tant d’or. Je restai là jusqu’à ce que les cloches, joyeuses, s’ébranlant de nouveau, carillonnèrent en volée la messe de l’aurore. Alors, je fus prise d’une émotion subite : je pleurai, je pleurai sans pouvoir m’arrêter, tandis que Tiennette sanglotait aussi, disant :
« — Ah ! mademoiselle, le petit Jésus… pour sûr, c’est le petit Jésus ! »
« Et jamais, tant qu’elle vécut, on ne put ôter de l’esprit de la brave servante que, cette nuit-là, le petit Jésus était venu m’apporter une dot, pour que je n’entre pas au couvent.
« Et, de fait, je ne passai qu’un mois, par déférence, à la Visitation. Le bruit du « miracle » s’était répandu. Mme la duchesse d’Angoulême voulut me l’entendre raconter. La triste et bonne princesse m’attacha à sa maison et je pris domicile près d’elle aux Tuileries.
« Un an s’était écoulé ; on se retrouvait à la veille de Noël et, suivant l’étiquette de la cour, nous avions, ce soir du 24 décembre 1816, accompagné Madame chez son oncle, le roi Louis XVIII. On y passa la soirée. Sa Majesté, qui adorait les histoires, se tourna soudain vers moi :
« — Et vous, mademoiselle, fit-il un peu ironique, ne m’a-t-on pas dit qu’une fortune était tombée du ciel, un soir de Noël, dans vos souliers ?… Allons, c’est le jour, contez-nous ça. »
« Devant l’ordre du roi, il fallait m’exécuter. Je me mis à parler, sans trop savoir, d’abord, ce que je disais. Jamais je n’avais nommé le comte de Cherizet ; mais en ce moment-là, trop troublée pour faire preuve d’imagination, je racontai l’histoire telle qu’elle était advenue. Quel danger, d’ailleurs ? Un an s’était passé ; les passions politiques étaient amorties. Pourtant, par prudence, je ne fis mention que d’un inconnu, dont j’avais toujours ignoré le nom et la situation sociale. Tous les yeux étaient fixés sur moi, je me sentais rougir. Le roi, malicieusement, m’arrêtait à chaque invraisemblance, me pressait de questions, et quand j’eus fini :
« — Et ce bel inconnu, interrogea-t-il en clignant de l’œil, il n’a pas dit son nom ? On ne l’a pas revu ? Bien sûr ? C’était peut-être un voleur, » ajouta-t-il.
« Alors, un peu piquée, je pris le parti de tout dire :
« — On ne l’a pas revu, non, sire, répliquai-je en faisant ma révérence ; mais ce n’était pas un voleur. Son nom était le comte de Cherizet.
« — Le comte de Cherizet ! »
« Il resta songeur.
« Durant toute la soirée sa préoccupation fut manifeste. Il s’entretint longuement, à voix basse, avec M. le duc Decazes, qui était, à cette époque, ministre de la police.
« Le roi semblait exiger du ministre une décision que celui-ci avait quelque peine à accorder.
« Le lendemain, à 10 heures, quand la cour entra chez le roi pour l’accompagner jusqu’à la chapelle, où devait être chantée la grand’messe de Noël, le cabinet de Sa Majesté était encombré comme aux jours de fête.
Déjà les officiers prenaient leur rang pour la marche à travers les galeries, quand le roi fit un signe de la main.
« — Attendez, » ordonna-t-il.
« Je sentis son regard fixé sur moi.
« — Messieurs, dit-il aux gentilshommes massés autour de lui, écartez-vous un peu pour que mademoiselle voie ce qui lui tombe, cette fois, du ciel, pour son Noël. »
« Les courtisans obéirent. Je levai les yeux, et, debout, en face de moi, j’aperçus… Oh ! cette fois, malgré la majesté du lieu, je ne pus retenir un cri :
« — Le comte !… Le comte de Cherizet !… »
« — Oui, mademoiselle, fit le roi, souriant, M. le comte de Cherizet qui, arrêté il y a un an, au sortir de votre hôtel, était, jusque hier soir, gardé au secret à la prison de l’Abbaye et que le bonhomme Noël est allé prendre là, cette nuit, pour le laisser tomber dans ma cheminée avec, en poche, un brevet de colonel… dans ma garde, monsieur, » ajouta-t-il en tendant la main au comte, qui s’en saisit et la baisa tout ému. »
La vieille dame, les larmes aux yeux, arrêta là son récit.
Elle attira vers elle ses petits-enfants, qui écoutaient, bouche bée, la belle histoire :
« C’était votre grand-père, mes petits. »

Thématiques :
NoëlPour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR
- Jean Kast - 1 686 vues
L'intervention média
Les plus lus de la semaine
LES PLUS LUS DE LA SEMAINE
Les plus lus du mois
LES PLUS LUS DU MOIS
- Gabrielle Cluzel - 49 618 vues







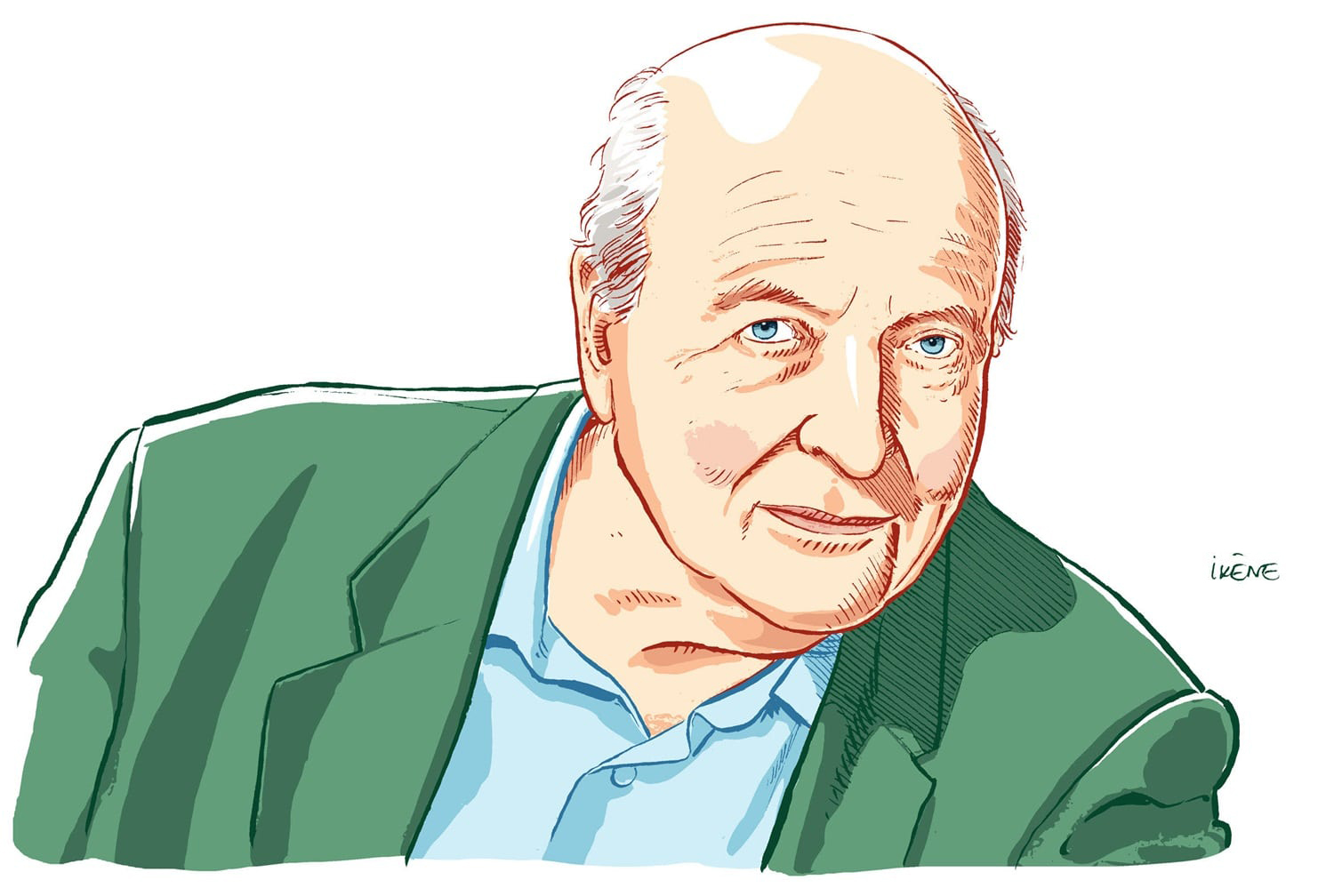




























BVoltaire.fr vous offre la possibilité de réagir à ses articles (excepté les brèves) sur une période de 5 jours. Toutefois, nous vous demandons de respecter certaines règles :