Pourquoi la « politique des identités » menace les États-Unis

Biden, Sleepy Joe, selon la taxinomie trumpienne, demeure le candidat de l’Establishment, tandis que Crazy Bernie construit son mouvement basé sur la « politique des identités » qui continuera coûte que coûte à s’opposer aux résultats des élections, primaires ou présidentielle, tant que leur propre candidat ne sera pas élu. Les démocrates, et plus particulièrement les partisans de Sanders, n’ont pas admis la victoire de Donald Trump ni n’admettent que le peuple de l’Amérique profonde s’apprête à réélire le républicain au grand dam des nantis de New York et de Los Angeles.
L’altérité radicale dont on est soi-même porteur, selon la grille de lecture intersectionnelle, est censée structurer une vision du monde qui interdit tout dialogue d’égal à égal. L’objectif n’est plus de persuader les autres. La politique est réduite à une lutte entre des communautés pour l’attribution des ressources.
David Horowitz, intellectuel américain, rappelle que le « marxisme culturel » à l’œuvre dans le parti démocrate divise la population en groupes raciaux, ethniques et en genres, hiérarchisés selon une prétendue oppression. Leur attaque de la loi fédérale, de la défense des frontières et de l’idée d’assimilation au sein de la culture américaine ne peut être considérée que comme une attaque de la nation elle-même.
Les perspectives de ce « nouveau totalitarisme de gauche » reposent sur trois piliers. Le premier est celui de l’abandon de l’idée libérale selon laquelle l’autorité du gouvernement doit être limitée. Le second pilier est l’idée selon laquelle tout n’est que construction sociale, y compris le genre et la « race » (à New York, municipalité contrôlée par la gauche, il y a 31 sexes désignés comme identités par le lobby LGBT, et des amendes pour qui ne les reconnaît pas). Le troisième de ces piliers est l’objectivation, l’identité de groupe subsume l’acteur responsable. Si les femmes sont « sous-représentées » dans les postes d’ingénieur chez Google, ça ne peut pas être à cause des choix individuels faits par des femmes mais d'une conspiration patriarcale, invisible, le sexisme.
Le mot « sexisme », nous dit Horowitz, est un barbarisme inventé par les gauchistes des années soixante pour s’approprier l’autorité morale du mouvement pour les droits civiques à travers une fausse association sémantique au mot « racisme ». Or, la condition d’esclave des Noirs américains durant trois siècles constitue une souffrance d’une autre nature – et pas seulement de degré.
Avant qu’il y ait le « sexisme », il y avait des adjectifs pour décrire de mauvais comportements touchant les relations entre les hommes et les femmes : inapproprié, grossier, rustre, préjudiciable, offensant, violent et criminel, comme dans le cas du viol - pour n’en nommer que quelques-uns. Ces nuances sont effacées par la prétendue « oppression » généralisée des femmes par les hommes. Idéologie qui fut l’une des principales causes de l’échec de Hillary Clinton.
À l’idéologie classique d’émancipation de l’individu s’est substituée une « politique des identités » qui envahit aussi le champ politique et médiatique français, comme vient de le montrer la mutinerie des enfants gâtés du cinéma français lors la cérémonie des César. Leur arme n’est pas l’argument mais la culpabilisation : ceux qui tentent de les contrer sont racistes, sexistes, parce que, paradoxalement, ils refusent de se définir eux-mêmes à partir d’une grille d’analyse ethno-raciale ou sexuelle. Le champ social ainsi réduit à un système de domination transforme l’adversaire politique en ennemi à abattre.
Une démocratie libérale, dit l’universitaire américain Joshua Mitchell, suppose une éthique de la discussion dans laquelle les participants délibèrent du bien commun en ayant revêtu leurs caractéristiques ethniques, sexuelles ou religieuses d’un « voile d’ignorance », selon l’expression du philosophe John Rawls.
Thématiques :
élections américainesPour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR











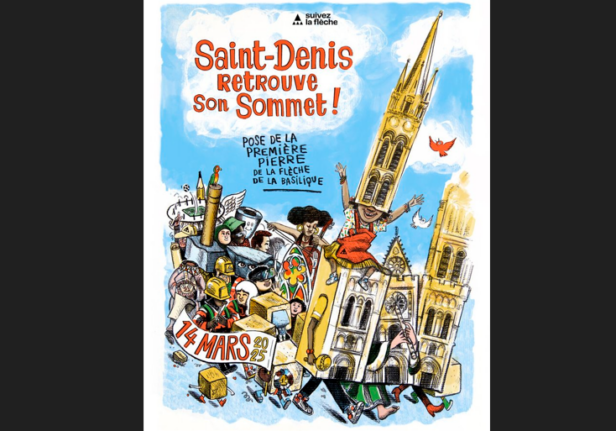







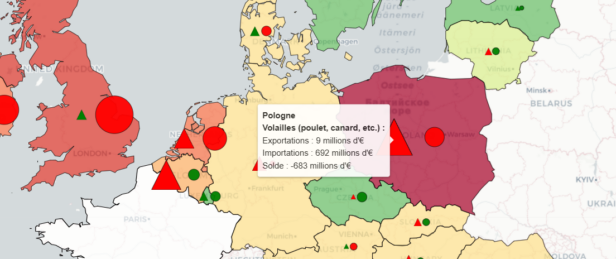















BVoltaire.fr vous offre la possibilité de réagir à ses articles (excepté les brèves) sur une période de 5 jours. Toutefois, nous vous demandons de respecter certaines règles :