Mort de Vanille : réponse à Philippe Bilger
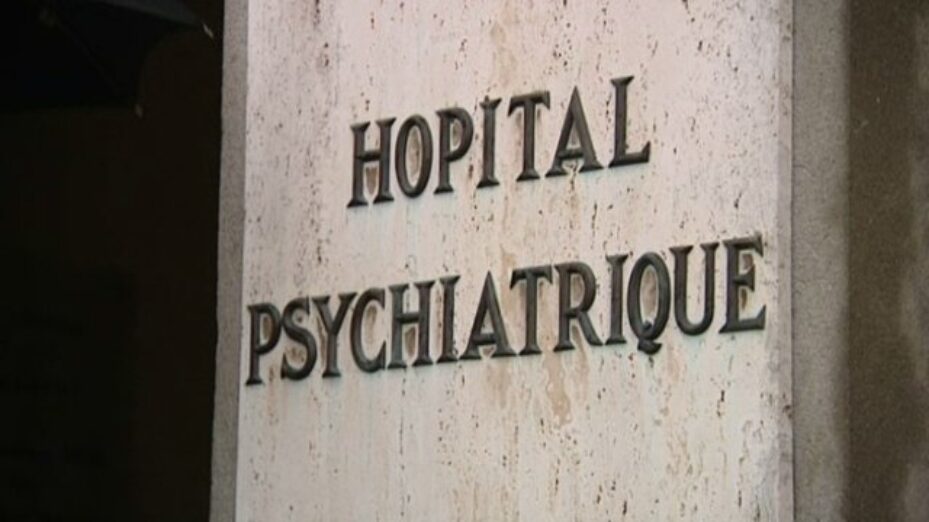
Je ferai simplement part de mon expérience personnelle.
Ma première épouse souffrait de troubles psychiatriques qui se sont déclarés à la mort brutale de son père dans un accident de voiture alors qu’elle entretenait des rapports conflictuels avec sa mère. Bref, un contexte psychiatrique que l’on pourrait qualifier de « classique » si l’on était freudien ; là n’est pas le sujet.
Le mal-être psychique de mon épouse se traduisait par des périodes de profondes dépressions qui ont fini par nécessiter des séjours quasi permanents en établissements spécialisés.
Mon épouse était suivie par les meilleurs spécialistes de la psychiatrie parisienne, je dis bien « de la psychiatrie » et non de la neurologie ; là a été probablement mon erreur.
Après de nombreuses tentatives de suicide, mon épouse a fini par mettre fin à ses jours, le 21 août 1988, au service des urgences d’un grand hôpital parisien, à 4 h du matin. Avant de partir, elle m’a pris la main en me disant « Tu ne me quittes pas ». Elle avait 38 ans, moi 35. Nous étions ensemble depuis 13 ans.
Au cours de ces années, j’ai vu évoluer sa « maladie » de façon inexorable, à tel point que « les psys », ne sachant à l’évidence plus quoi faire, en étaient réduits « à la faire enfermer » pour la protéger d’elle-même. Pas gai, même quand il s’agit de « prisons de luxe ».
Malgré mes insistances, mon épouse (même dans les périodes fort heureusement parfois très longues où tout semblait aller bien) a toujours refusé que nous ayons des enfants. Elle me disait qu’elle se savait malade et incapable de prendre une telle responsabilité. Avec le recul du temps, c’était faire preuve d’une lucidité remarquable.
J’ai cru la « guérison » venue quand, après avoir repris des études, mon épouse a obtenu un diplôme qui devait lui permettre de « revenir dans la vie sociale », mais hélas, à la suite de ce que je considère comme une faute de son psy, elle a rebasculé dans « les vieux démons » et est arrivé ce qui devait arriver.
Ce que l’on ne peut imaginer quand on ne l’a pas vécu, c’est la terrible souffrance des gens qui sont victimes de telles maladies car cette souffrance ne peut s’exprimer que par la violence : contre soi-même, et c’est le suicide, ou contre les autres, et ce sont des gestes « fous » comme celui commis par cette pauvre femme.
Vous savez, cher Philippe, en tuant son enfant, cette femme a probablement cru qu’elle se tuait elle-même.
Et pour répondre à votre questionnement, ma conclusion personnelle, c’est que nous sommes particulièrement nuls, en France, pour traiter ce genre de pathologies, comme nous sommes parfaitement nuls pour nous occuper des handicapés.
La conception purement psychiatrique de ces maladies (peut-être les choses ont-elles changé depuis) ne mène strictement à rien : c’est « la camisole chimique » dans les hôpitaux pour celles et ceux qui n’ont pas les moyens de la médecine privée « de luxe », c’est « la prison dorée » pour celles et ceux qui peuvent se le permettre.
En tout cas, il est clair qu’on ne sait toujours pas comment faire guérir de ces maladies.
Et j’avoue avoir frémi en entendant que cette pauvre femme avait été arrêtée et mise en prison « comme un droit commun ».
J’entends des « journalistes » dire péremptoirement que cette femme tient des propos incohérents, mais c’est le propre du délire.
La prison, ce n’est pas sa place, c’est un scandale. Elle est suffisamment prisonnière d’elle-même comme cela, inutile « d’en rajouter ».
Il est clair, aussi, qu’en pareil cas, laisser un enfant seul avec une mère (ou un père) souffrant de tels troubles, c’est tout simplement complètement idiot et irresponsable.
Il y a certainement bon nombre de protocoles à revoir…
Le droit n’est-il pas, d’abord, fait pour prévenir et protéger avant de punir ?
Thématiques :
PsychiatriePour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR
L'intervention média
Les plus lus de la semaine
LES PLUS LUS DE LA SEMAINE
Les plus lus du mois
LES PLUS LUS DU MOIS
- Gabrielle Cluzel - 49 396 vues


















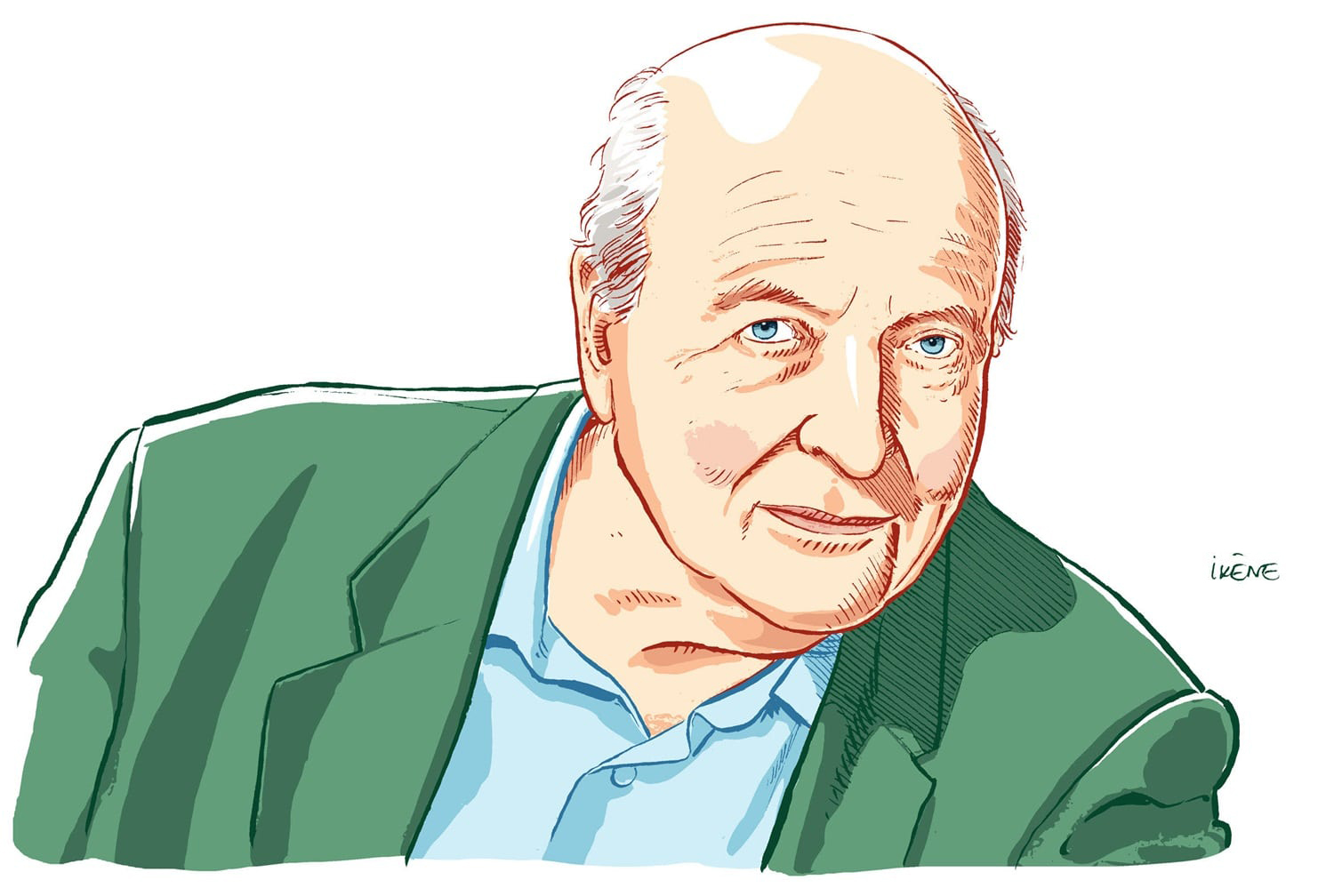


















BVoltaire.fr vous offre la possibilité de réagir à ses articles (excepté les brèves) sur une période de 5 jours. Toutefois, nous vous demandons de respecter certaines règles :