[LE ROMAN DE L’ÉTÉ] Opération Asgard – Marche forcée

Pour retrouver l'épisode précédent, c'est ici.
C'est l'été et, comme chaque été, c'est le moment de changer un peu d'air, de prendre un peu plus de temps pour lire. BV vous propose, cette année, une plongée haletante dans la clandestinité durant la Seconde Guerre mondiale. L'auteur et l'illustrateur, Saint Calbre et La Raudière, nous racontent l’histoire d’un jeune étudiant d’Oxford, Duncan McCorquodale, issu d’une vieille famille écossaise, qui, en 1940, va être recruté par le Special Operations Executive (le fameux SOE), créé par Churchill cette même année 1940 lorsque toute l'Europe, sauf la Grande-Bretagne, s'effondrait face à Hitler. L’histoire, donc, d’un jeune patriote dont le « bon sang ne saurait mentir », comme naguère on avait encore le droit de dire. Il va se lancer, corps, âme et intelligence, dans la nuit jusqu’à devenir semblable à elle, pour reprendre l’expression de l'Iliade d’Homère. Car c’est dans la nuit qu’agissait le SOE ! Nos deux auteurs, Saint Calbre et La Raudière, tous deux saint-cyriens, « ont servi dans les armées », nous dit laconiquement et, pour tout dire, un peu mystérieusement, la quatrième de couv’ de ce roman publié aux Éditions Via Romana. On n’en sait et on n'en saura pas plus. Au fond, c’est très bien ainsi : « semblables à la nuit », comme leur jeune héros…
Opération Asgard est le premier tome d’une série qui va suivre notre héros sur plusieurs décennies : de la Seconde Guerre mondiale, en passant par la guerre froide, jusqu’à la chute du mur. Le second tome paraîtra cet automne.
Publié par BV avec l'aimable autorisation des Éditions Via Romana.
Chapitre 11 (suite)
Marche forcée
Une demi-heure passa. Avec un brin d’humour, Duncan se dit qu’une bonne partie du métier d’agent clandestin devait se passer à prendre des trains à la campagne, dans un quelconque pays d’Europe, en regardant défiler les arbres. De temps à autre, il tentait de lire et d’annoter les Odes d’Horace, dont il avait pris un exemplaire au manoir sur les conseils de son père. Pour être tout à fait honnête, le vénérable ouvrage lui tombait des mains. Il ne pensait, en vérité, qu’à réussir cette nouvelle étape de sa formation qui lui permettrait de sortir à tout jamais de la grisaille ordinaire, pour manier, comme dans l’Iliade, un carquois de flèches d’or dans la solitude de la nuit. On lui avait bien fait comprendre, lors de son passage à Londres, que tout échec au stage signifiait un nouveau dispatching, c’est-à-dire, selon toute vraisemblance, un emploi administratif quelque part à Baker Street.
Le train s’engagea sur le viaduc de Glenfinnan. On apercevait la petite gare en contrebas, lovée dans une anse comme pour s’y protéger du vent. La locomotive descendit à pleine vitesse, commença à ralentir, puis, dans le grincement des essieux, se stabilisa devant le quai. Duncan attrapa sa valise, glissa son exemplaire d’Horace dans la poche de sa veste et descendit.
Il fut surpris de trouver sur le quai de la gare, habituellement peu fréquentée, une dizaine de femmes et d’hommes qui, eux aussi, semblaient attendre quelqu’un ou quelque chose. C’étaient les mêmes gestes anodins, le même regard en éveil, la même attitude de flâneur un peu gauche, le même air à la fois décidé et encore juvénile. Il reconnaissait la silhouette qui était aussi la sienne, celle d’un jeune agent en formation.
Un sergent-major de l’armée de terre en tenue de service courant fit son entrée dans le hall. Il avait le teint de brique et la courte moustache des vieux sous-officiers anglais, mais son allure n’avait rien de particulièrement martial. Ce fut avec une sorte de nonchalance courtoise qu’il lança à la cantonade :
— Si certains d’entre vous ont été invités à la campagne, je les prie de bien vouloir me suivre.
Les stagiaires s’entre-regardèrent, prirent leurs bagages et lui emboîtèrent le pas. Un camion de l’armée stationnait devant le bâtiment. La bâche, relevée, découvrait deux bancs, dos à dos, destinés au transport de personnel.
— Voulez-vous bien charger vos valises dans le fond du camion, s’il vous plaît, continua le sergent-major avec la même décontraction et la même voix neutre.
Duncan compta machinalement le nombre de ses camarades. Ils étaient exactement douze, dont trois femmes, que les hommes aidèrent à pousser leurs bagages au fond du camion. Le sergent-major ne bougeait pas et se contentait d’observer. Quand les préparatifs furent achevés, il prononça négligemment – mais ses yeux démentaient son apparente indolence :
— Bien, il est neuf heures moins dix. Nous avons rendez-vous au château d’Arisaig, tout droit dans la direction de mon bras, par cette petite route, pour midi. Vous avez un peu plus de seize miles à parcourir pour arriver ensemble. Les valises vous attendront dans la cour.
Les douze agents en restèrent pantois. Seize miles, soit près de vingt-cinq kilomètres, à parcourir en trois heures… au maximum ! Et en tenue civile, encore !
Le conducteur mit en marche. Le sergent-major s’était hissé à la place du mort, dans la cabine du camion. Couvrant le bruit du moteur avec la même voix impassible, il tira une montre à gousset de la poche de sa vareuse, consulta l’heure et prononça distinctement, avec un brin de malice :
— Je ne saurais trop vous suggérer d’accélérer le pas, mesdames et messieurs.
Puis il claqua la portière.
Avant même que le camion ne partît, la plupart des stagiaires s’étaient élancés. Les plus inexpérimentés étaient partis à vive allure ; deux des femmes avaient ôté leurs chaussures à talons et commençaient à courir sur le bitume. La troisième, dont Duncan avait noté l’élégance et la minceur, avait cassé les talons de ses chaussures contre un mur pour pouvoir courir à plat. Les semelles du temps de guerre, faites de bois, étaient bien assez lourdes comme cela.
Duncan respira profondément et dénoua sa cravate. Seize miles en moins de trois heures, c’était, à la vérité, largement faisable. Il fallait toutefois arriver ensemble – et ne pas présumer de ses forces. Lui revint en mémoire cette phrase d’Horace que, dans son demi-sommeil, il avait soulignée au crayon : Celui-là seul est maître de lui-même, qui chaque soir peut se dire : « J’ai vécu. » Combien de ses compatriotes auraient vécu une véritable journée, ce soir ? Bien peu, sans doute. La Providence lui offrait, en quelque sorte, l’occasion de se fabriquer des souvenirs heureux. « Je n’ai pas changé de route, se dit-il, amusé. Je suis simplement en train de prendre le rapide pour Arisaig. »
C’est en souriant qu’il prit sa première foulée. Là-bas, au bout de la longue route, c’était le château, la suite du parcours, la prochaine étape.
À suivre...
Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR
Un vert manteau de mosquées







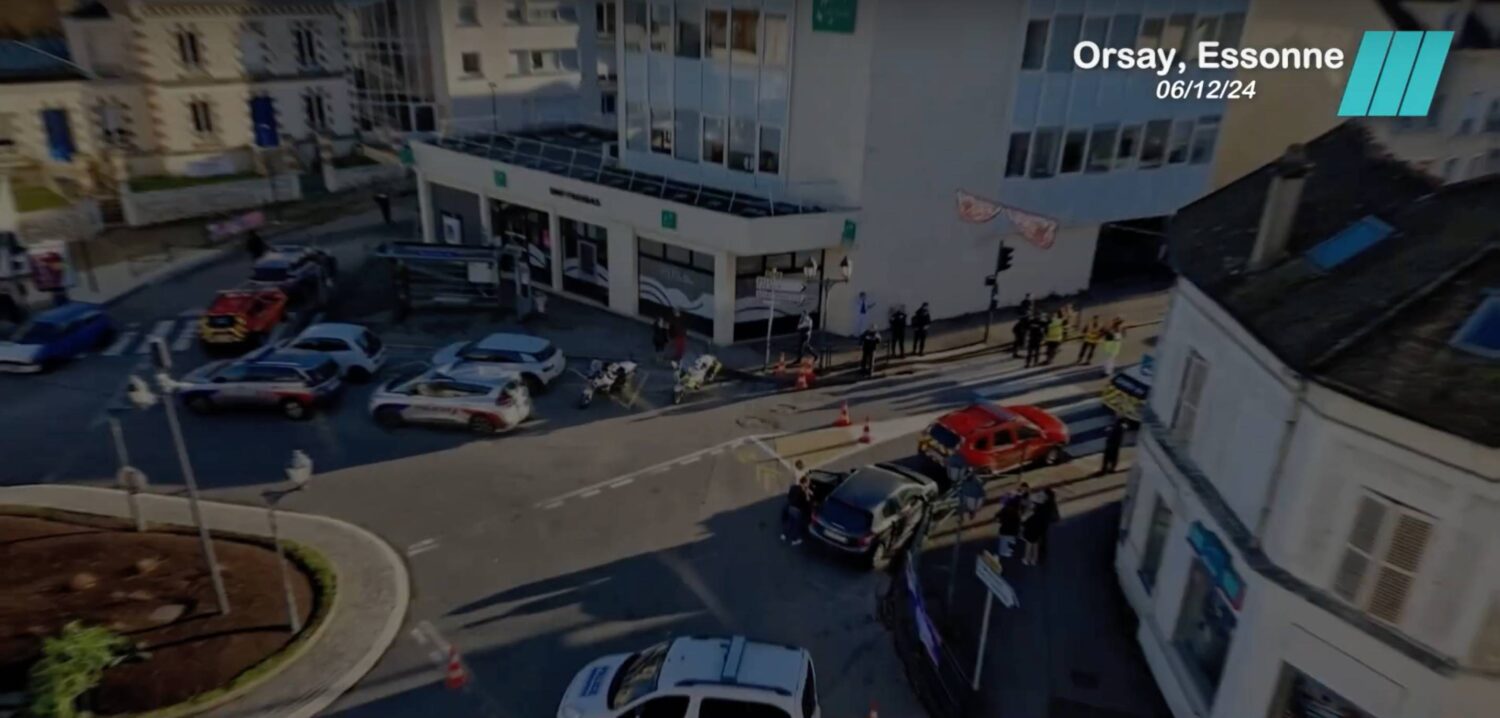

































Un commentaire
Le bonheur dans l’épreuve ou le moyen de tromper la routine. Mais le sentiment d’être « manipulé » ne contrevient-il pas quelque peu à cet idéal ?