Entre la Corse et Paris : le dialogue de sourds ?
À en croire les gazettes, l’arrivée d’Emmanuel Macron et de son gouvernement d’experts à l’Élysée signifiait la fin de la politique et le triomphe de la fameuse « bonne gouvernance », celle pratiquée par le non moins célèbre « cercle de la raison ». La preuve par ce dialogue de sourds, digne du professeur Tournesol et du capitaine Haddock, entre le Premier ministre Édouard Philippe, puis le président du Sénat, Gérard Larcher, et les élus corses Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni, respectivement présidents du conseil exécutif et de l’Assemblée de l’Île de Beauté.
Pour ce dernier, sa "conviction est faite et l’État refuse de reconnaître et de prendre en compte la dimension politique de la question corse". Et d’en appeler à "une grande manifestation populaire", ce qui ne mange jamais de pain, fût-il à base de farine de châtaigne. Entre autres revendications, le duo exige donc la création d’un statut de résident pour l’accès à la propriété, l’officialisation de la langue locale, l’amnistie des prisonniers politiques, un statut fiscal dérogatoire et, le plus important : la reconnaissance du peuple corse.
Voilà qui, à l’évidence, nous ramène à la politique, avec un grand « P », SVP, sachant que tout est « politique » dans cette feuille de route. Que la Corse cesse d’être en proie à la spéculation immobilière et que les jeunes puissent continuer d’habiter sur la terre les ayant vu naître, c’est politique. Que la langue historique des Corses ne devienne pas langue morte, c’est politique. Que la fiscalité soit adaptée aux réalités économiques et géographiques de l’île, c’est politique. Que les militants emprisonnés pour leurs seules opinions, même si parfois exprimées de manière virulente, soient libérés, ou au moins rapprochés de leurs familles, c’est politique. Que le peuple corse soit reconnu en tant que tel, quoi de plus éminemment politique ?
L’incompréhension de ces réalités dont fait preuve Paris (le « Continent », comme dit là-bas) relève elle aussi de la politique. Celle de l’État jacobin, pour qui n’existent que des « citoyens » indifférenciés que seule fédérerait le concept flou « d’identité républicaine » et non point des Français, faits de chair et de sang et, plus encore, d’une histoire, d’un passé et de traditions.
Nos rois, semble-t-il, étaient autrement plus malins, qui entendaient présider aux destinées « des peuples de France » et non point d’un peuple imaginaire, issu des Lumières et non point de la terre. Dans ce vaste ensemble, les communautés étaient respectées, parce qu’on savait qu’elles existaient. Le peuple breton existe. Les peuples savoyards, antillais, niçois ou auvergnats existent tout autant. Quoique prétendent les tenants d’un laïcisme de combat, les communautés religieuses existent pareillement. La communauté catholique n’est pas que vue de l’esprit ; pas plus que ses homologues protestante, juive ou musulmane. Gouverner ne relève-t-il pas, avant tout, de l’art de composer avec le réel plutôt que de le nier ?
De même, l’identité d’un peuple ne saurait être unique : les identités se superposent. On peut être à la fois de son sang et de son village. De son club de football et de son parti politique. De son quartier et de sa province. De sa religion, aussi. Une identité n’exclut pas forcément les autres : on peut se sentir totalement corse et parfaitement français. À condition, toutefois, que l’identité française, telle qu’exprimée au plus haut sommet de l’État, ne se résume pas à de seules incantations abstraites. Le pouvoir, c’est aussi l’incarnation, même tempérée par le régicide, tel que constaté jadis.
Pour obéir, les peuples ont aussi besoin de respecter. Et pour être respecté, encore faut-il se montrer respectable. À l’Élysée et dans les assemblées républicaines, on est loin du compte. Et pas que du seul point de vue politique, s’entend.
Thématiques :
Corse
Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR
Un vert manteau de mosquées

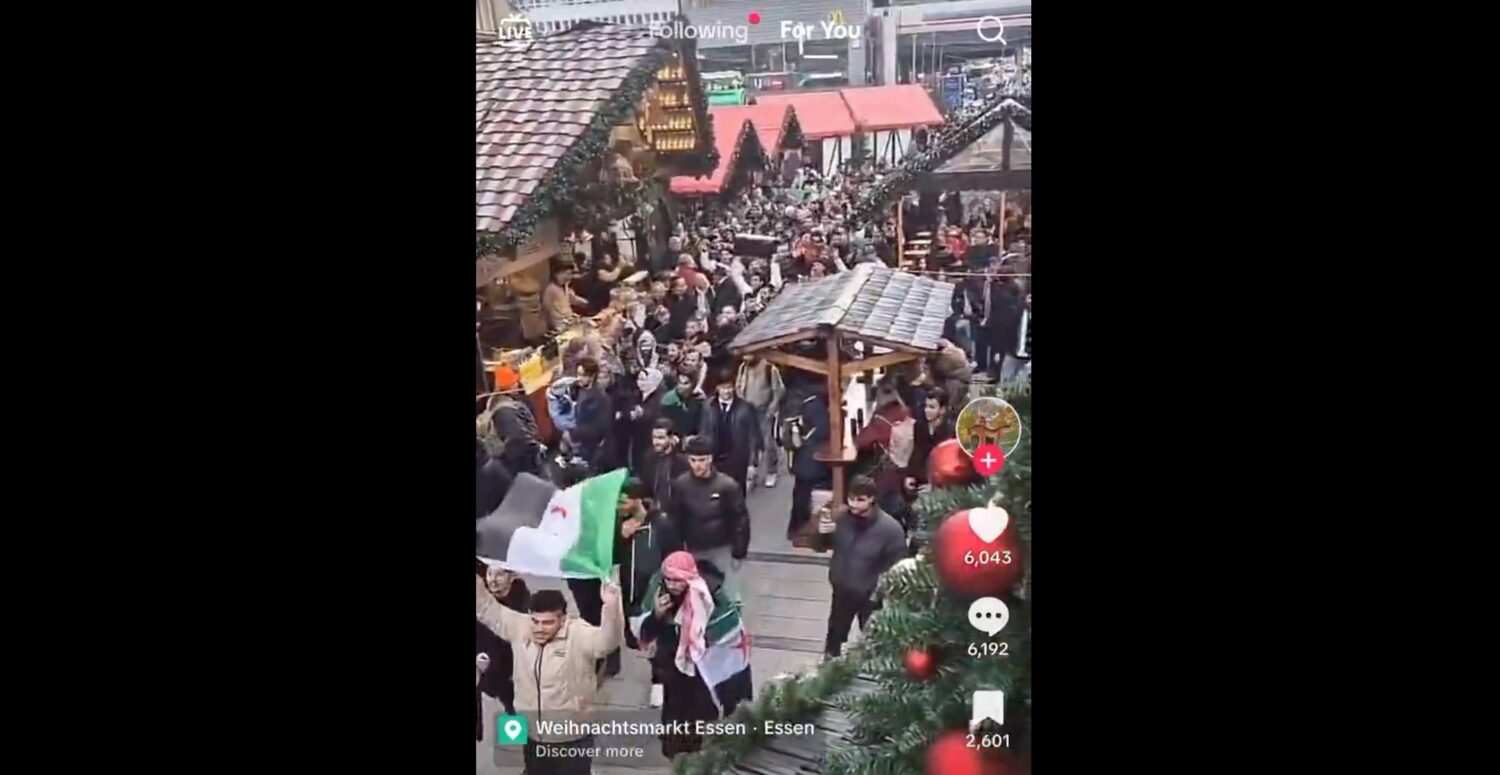




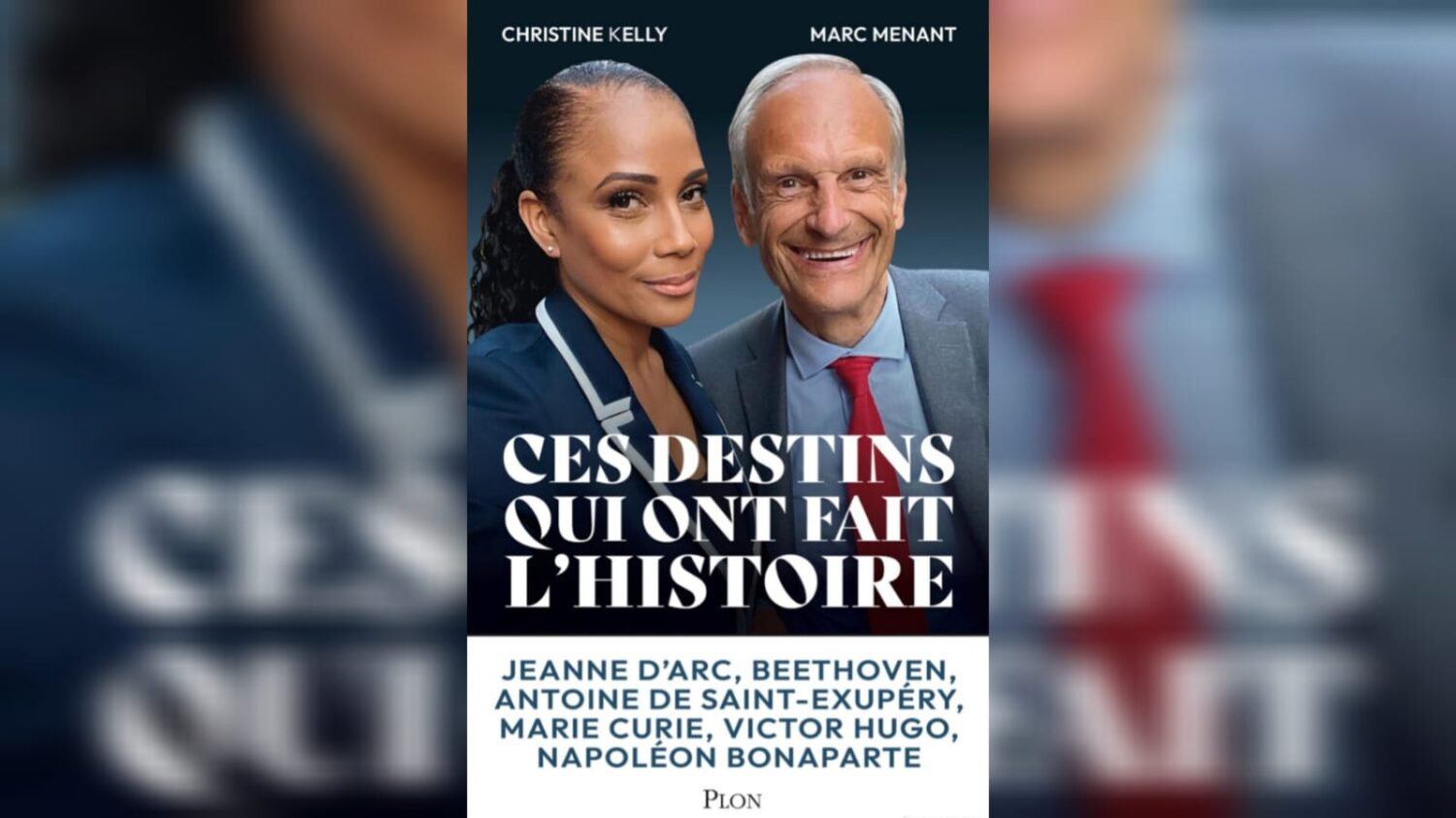




























BVoltaire.fr vous offre la possibilité de réagir à ses articles (excepté les brèves) sur une période de 5 jours. Toutefois, nous vous demandons de respecter certaines règles :