22 avril 1370 : fondation de la Bastille, symbole de la monarchie et de sa chute

Le 22 avril 1370, sous le règne du roi de France Charles V, la première pierre de la Bastille fut posée sur le sol de Paris. Édifiée pour défendre la cité de sainte Geneviève contre les menaces extérieures, cette forteresse deviendra, au fil des siècles, un symbole du pouvoir absolu et de l’arbitraire monarchique. Sa chute, le 14 juillet 1789, marquera alors l’entrée fracassante du peuple français dans son Histoire révolutionnaire. L'édifice étant démoli, la place qui porte son nom reste une étape incontournable des manifestations de gauche, avec les non moins symboliques République et Nation.
Une forteresse pour protéger Paris
À la fin du XIVe siècle, Paris est une cité vulnérable, face aux incursions anglaises lors de cette terrible guerre de Cent Ans qui ravage la France. Charles V, monté sur le trône en 1364, entreprend alors de renforcer les défenses de sa capitale. Déjà, en 1356, des travaux avaient été engagés pour doter Paris d’une nouvelle enceinte fortifiée, plus vaste que celle édifiée par Philippe Auguste. Pour en sécuriser l’accès oriental, le roi ordonne ainsi l’édification d’une forteresse à la porte Saint-Antoine, point stratégique sur la route de Vincennes.
C’est ainsi que, le 22 avril 1370, le prévôt de Paris, Hugues Aubriot, pose solennellement la première pierre d’une tour appelée à devenir la Bastille. Initialement nommée Chastel Saint-Antoine, elle n’est pensée que comme un bastion défensif, mais sa construction prend rapidement de l’ampleur. L’ouvrage devient un véritable château fort, composé de huit tours hautes de 24 mètres, reliées par d’épais remparts et cernées par un large fossé. Elle incarne alors la volonté du pouvoir royal de protéger Paris mais aussi de surveiller sa propre population.
De bastion royal à prison d’État
Au fil des siècles, la Bastille ne tarde pas à revêtir une fonction plus politique que défensive. Si elle est utilisée ponctuellement pour défendre Paris, notamment lors des soulèvements populaires ou des guerres civiles comme la Fronde, c’est surtout comme prison d’État qu’elle entre dans l’imaginaire collectif dès le règne de « l’universelle araignée » Louis XI.
Sous le règne de Louis XIII, et plus encore sous celui de Louis XIV, la fonction carcérale de la Bastille prend de l’ampleur. S’y trouvent ainsi enfermés, souvent sans procès, les opposants au pouvoir royal, les écrivains trop audacieux, les nobles compromis dans des affaires délicates et bien d'autres victimes des célèbres lettres de cachet, ces ordres d’incarcération signés du roi, sans justification ni recours.
Parmi les figures célèbres qu’elle a hébergées, on compte Nicolas Fouquet, le flamboyant surintendant des finances disgracié par Louis XIV, Voltaire, incarcéré pour ses écrits satiriques, le mystérieux homme au masque de fer et même le marquis de Sade. Mais la plupart des détenus restent anonymes, embastillés dans l’ombre pour des raisons souvent obscures pour le peuple. Pour beaucoup, la Bastille devient ainsi le symbole de l’arbitraire, du silence et de l’injustice.
Un symbole abattu par le peuple
À la veille de la Révolution française, la Bastille arrive au terme de son histoire. Elle ne compte alors plus que sept prisonniers : quatre faussaires, deux aliénés et un noble. Louis XVI envisage, d’ailleurs, de faire raser ce bâtiment encombrant, jugé coûteux et obsolète. Mais dans l’esprit du peuple, elle demeure l’incarnation du despotisme royal.
Lorsque, le 14 juillet 1789, le peuple parisien se soulève, ce dernier s’empare des armes stockées à l’hôtel des Invalides, mais il lui manque une chose cruciale : la poudre. Tous les regards se tournent alors vers la Bastille qui, dit-on, en est gorgée. Assiégé par les révolutionnaires, le gouverneur de Launay, après quelques heures de résistance, finit par capituler. Il est malheureusement massacré à sa sortie de la forteresse, lynché par une foule en furie mais victorieuse de s’être emparée de l’impossible, de la Bastille.
En effet, il ne s’agit pas de la simple prise d’un bâtiment peu stratégique mais, en réalité, de la victoire du peuple sur la monarchie. Les pierres de la forteresse seront démantelées, dispersées, parfois vendues partout comme un souvenir de ce jour mémorable. Le site de la forteresse devient une grande place publique faisant oublier qu’autrefois se dressait là cet imposant édifice. Le 14 juillet, devenu fête nationale, continuera également de célébrer chaque année cet acte majeur de la chute de ce monument qui devait protéger Paris et qui, avec sa disparition, aura donné naissance à la Révolution française.

Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR






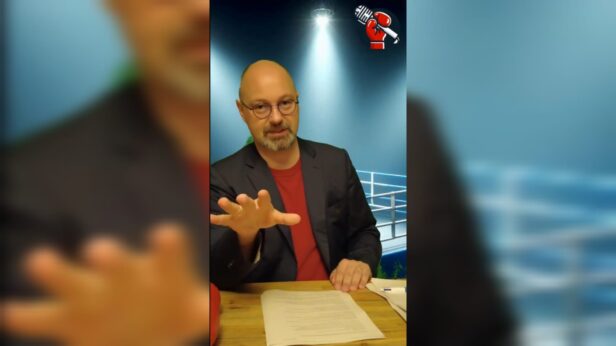













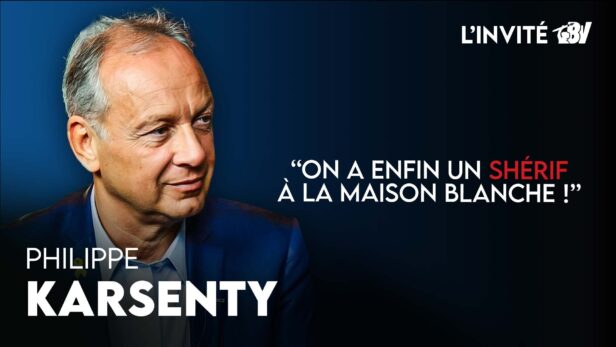






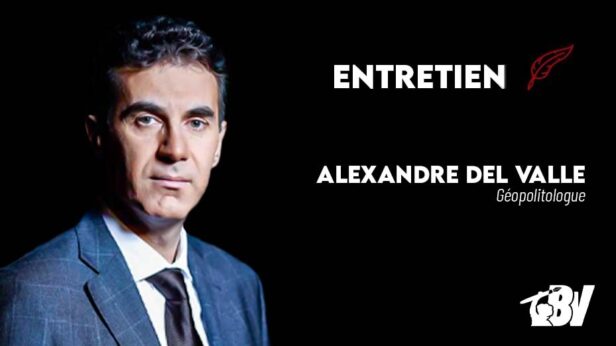

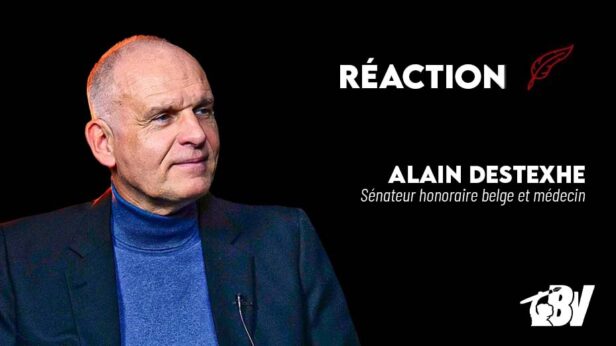







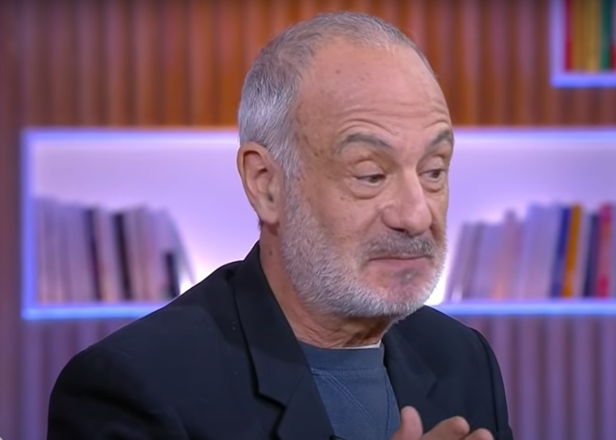

3 commentaires
» Il est malheureusement massacré à sa sortie de la forteresse, lynché par une foule en furie ». Il est volontairement massacré par une foule en furie dont ce sera le premier crime, mais non le dernier, hélas.
Une triste époque ou la gauche des parvenu a voulu et pris la place du roi. Les présidents de gauches vivent tous plus richement que la royauté de l’époque et le premier fût le plus hypocrite de tous : mitterrand
La Bastille, avant sa chute, abritait trois pelés et deux tondus, tous de haute naissance. C’était le Trois Étoiles des fils de famille qui avaient fauté. Sade, en effet, y a été en villégiature, accompagné de son fidèle valet qui lui faisait le ménage. Peu après il fut commissaire du peuple. Le peuple, ou plutôt la foule, qui monta à l’assaut de la forteresse fit plus de morts dans ses rangs qu’il n’y avait de prisonniers. Nous fêtons la prise de la Bastille comme un symbole national. Cette couardise nous honore.