Le nouveau monde (suite) : épuration accélérée du vocabulaire

S’ils compliquent la tâche de M. Darmanin, ceux qui ont tabassé un habitant du XVIIe arrondissement au motif qu’il ne portait pas de masque ne facilitent pas non plus la mienne aujourd’hui… Il semble, en effet, qu’en plus des coups et des faux en écriture, ils aient insulté leur victime, la traitant de « sale nègre ». Or, c’est justement de ce mot que je voulais vous entretenir aujourd’hui.
Un mot qu’il faudrait, maintenant, éviter de prononcer, étant au mieux autorisé à l’écrire sous cette forme : « n*** », voire en désignant le sujet par « le mot en n ».
Voilà l’affaire qui agite le Canada depuis des semaines. L’incident remonte au 23 septembre dernier. Une enseignante de l’université d’Ottawa délivre, ce jour-là, un cours en anglais sur la théorie queer. Une thématique qui préoccupe beaucoup les Canadiens. Elle y explique comment la communauté gay s’est réappropriée ce terme, à l’origine insultant. Cela s’appelle la « resignification subversive », dit-elle. Et d’expliciter son propos en soulignant qu’aux États-Unis, la communauté noire a récupéré de la même façon le terme « nigger ».
Elle ne le sait pas, mais elle vient de commettre l’irréparable.
Une étudiante lui écrit le soir-même : le mot la fait souffrir. L’enseignante s’en excuse et propose un débat sur le mot honni : « Vaut-il mieux ne pas le prononcer parce qu’il est sensible ? Le silence ne mène-t-il pas à l’oubli et au statu quo ? » Trop tard. La bombe a déjà explosé.
Le 1er octobre, l’offensée publie un tweet dans lequel elle récuse à une personne blanche le droit de prononcer le mot « nègre », porte plainte et publie, dans la foulée, les coordonnées personnelles de l’enseignante. On devine la suite : insultes, menaces, etc.
Courageux, le recteur Jacques Frémont suspend l’enseignante au motif que « les membres des groupes dominants n’ont tout simplement pas la légitimité pour décider ce qui constitue une micro-agression ». Vingt-sept professeurs et bibliothécaires noirs se rangent à ses côtés. Trente-quatre signent une lettre de soutien à l’enseignante… et se font agonir d’injures, notamment traiter de « frogs », ces sales grenouilles de Français.
Car cette histoire ravive la querelle entre anglophones et francophones. Le Québec soutient l’enseignante. Le Premier ministre de la province, suivi par son gouvernement et les chefs des partis d’opposition, déclare que « les universités doivent être des endroits où on peut faire des débats, où la liberté d’expression est importante ». « Il faut toujours regarder le contexte dans lequel les mots sont utilisés. […] C’est comme si on avait une espèce de police de la censure. Il faut vraiment arrêter ça », dit-il.
Côté anglophone, on est dans la posture inverse. Ainsi le maire d’Ottawa qui déclare : « Je ne pense pas que c’est une bonne idée d’utiliser le “mot en n” (sic) en aucune circonstance. C’est une insulte à la communauté noire. Certainement, il y a toujours la liberté d'expression dans les universités, mais il y a des limites à ça. » Au sommet de l’État, le courageux Justin Trudeau est sur la même ligne, pour « le respect des autres et l’écoute des communautés ».
Comme le rappelait alors Marianne, « cette affaire s’ajoute à la liste des incidents réguliers qui émaillent les universités nord-américaines » et gagnent le Québec. Ainsi, à l’université Concordia à Montréal, une pétition d’étudiants a circulé contre une enseignante qui avait « cité en anglais le titre de l’ouvrage Nègres blancs d’Amérique de Pierre Vallières, paru en 1968 pour décrire la réalité de la classe ouvrière canadienne-française ».
Si je reviens deux mois après sur cette histoire, c’est parce qu’elle continue d’agiter le pays. Atterrée, ma famille montréalaise me dit que les sondages qui se multiplient auprès des jeunes étudiants et lycéens sur cette question révèlent qu’ils « sont à 100 % » pour la suppression du mot « nègre » du vocabulaire.

Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR



















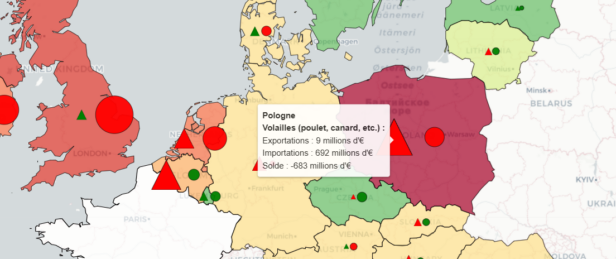












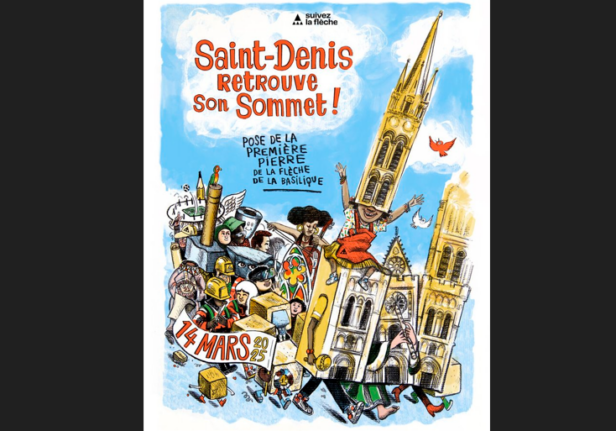



BVoltaire.fr vous offre la possibilité de réagir à ses articles (excepté les brèves) sur une période de 5 jours. Toutefois, nous vous demandons de respecter certaines règles :