Cinéma : Qu’un sang impur…, d’Abdel Raouf Dafri

Connu pour ses emportements réguliers à l’évocation des thématiques identitaires, comme en atteste son face-à-face électrique de 2013 avec Alain Finkielkraut sur le plateau de « Ce soir (ou jamais !) », Abdel Raouf Dafri, à qui l’on doit notamment les scenarii de Mesrine et d’Un prophète, nous livre aujourd’hui son premier long-métrage en tant que réalisateur.
Prenant pour cadre la guerre d’Algérie, Qu’un sang impur… nous raconte la reprise de service du lieutenant-colonel Breitner, un ancien d’Indochine qui, en dépit des horreurs qu’il a pu vivre par le passé et l’ont marqué, accepte une mission suicide dans les Aurès Nemencha : retrouver le corps du colonel Simon Delignères, l’enterrer décemment et rapporter à sa mère un objet qu’il portait au moment de mourir.
Dans son aventure, Breitner embarque avec lui une Hmong et recrute sur place deux têtes brûlées : un sergent-chef sénégalais, Senghor, condamné à mort pour avoir tué son supérieur hiérarchique qui lui intimait l’ordre de tuer des enfants, et Martillat, un jeune engagé volontaire prêt à tout pour faire honneur à son père mort en héros en Indochine. Dans la foulée, les quatre personnages intègrent parmi eux une prisonnière fellaga, spécialiste des explosifs, convaincue à tort par Breitner qu’elle sauvera ainsi sa pauvre mère retenue en otage par les Français.
D’entrée de jeu, Abdel Raouf Dafri nous expose ses ambitions : réaliser un genre de western algérien au parfum antimilitariste de bon aloi qui conjuguerait l’ambiance d’un Sergio Leone, les thématiques d’Apocalypse Now et une galerie de personnages dignes des Douze Salopards. Malheureusement pour lui, le cinéaste ne maîtrise nullement les échelles de plan de Leone, ne sait insuffler à son récit la gravité et la subtilité du film de Coppola et n’atteint jamais l’ironie de Robert Aldrich.
Si la caractérisation sommaire des personnages confère bien à leur dynamique de groupe un certain charme, Qu’un sang impur… cumule les maladresses de mise en scène dans toute sa première partie. Que ce soit dans la séquence d’ouverture, éminemment complaisante dans sa représentation de la violence (le comble, pour une œuvre antimilitariste) ou dans celle qui a pour fonction d’exposer les enjeux du récit. Des enjeux que tous, spectateurs y compris, finiront par oublier au fil de l’intrigue…
La réalisation s’améliore par la suite mais le film souffre tout du long d’un positionnement indécis, voire incohérent. Tiraillé d’un côté par la tentation du « cinéma de genre » et de l’autre par l’ambition sérieuse d’une grande fresque politique, Abdel Raouf Dafri échoue sur les deux tableaux. Le premier ne va jamais assez loin dans le côté série B, limité par le second qui, lui, ne prend jamais la peine de contextualiser les choses, d’en référer à l’Histoire, aux événements et aux mentalités réelles, et se contente de poncifs dialogués débités avec fiel et passion par un Olivier Gourmet en roue libre dans le rôle d’un gradé français devenu chef (d’opérette ?) des fellagas.
Le résultat final est une vaste bouffonnade dans laquelle le cinéaste tient à tout prix à faire cohabiter en chacun, quel que soit son bord, le bien et le mal, la morale et la torture, la bonté et le sadisme, avec l’air de ne jamais prendre parti, même si l’on sent bien malgré tout que certains sont plus pervers que les autres…
1 étoile sur 5
Pour ne rien rater
Revivez le Grand oral des candidats de droite
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR
L'intervention média
Les plus lus de la semaine
LES PLUS LUS DE LA SEMAINE
- Charles-Henri d'Elloy - 15 236 vues

















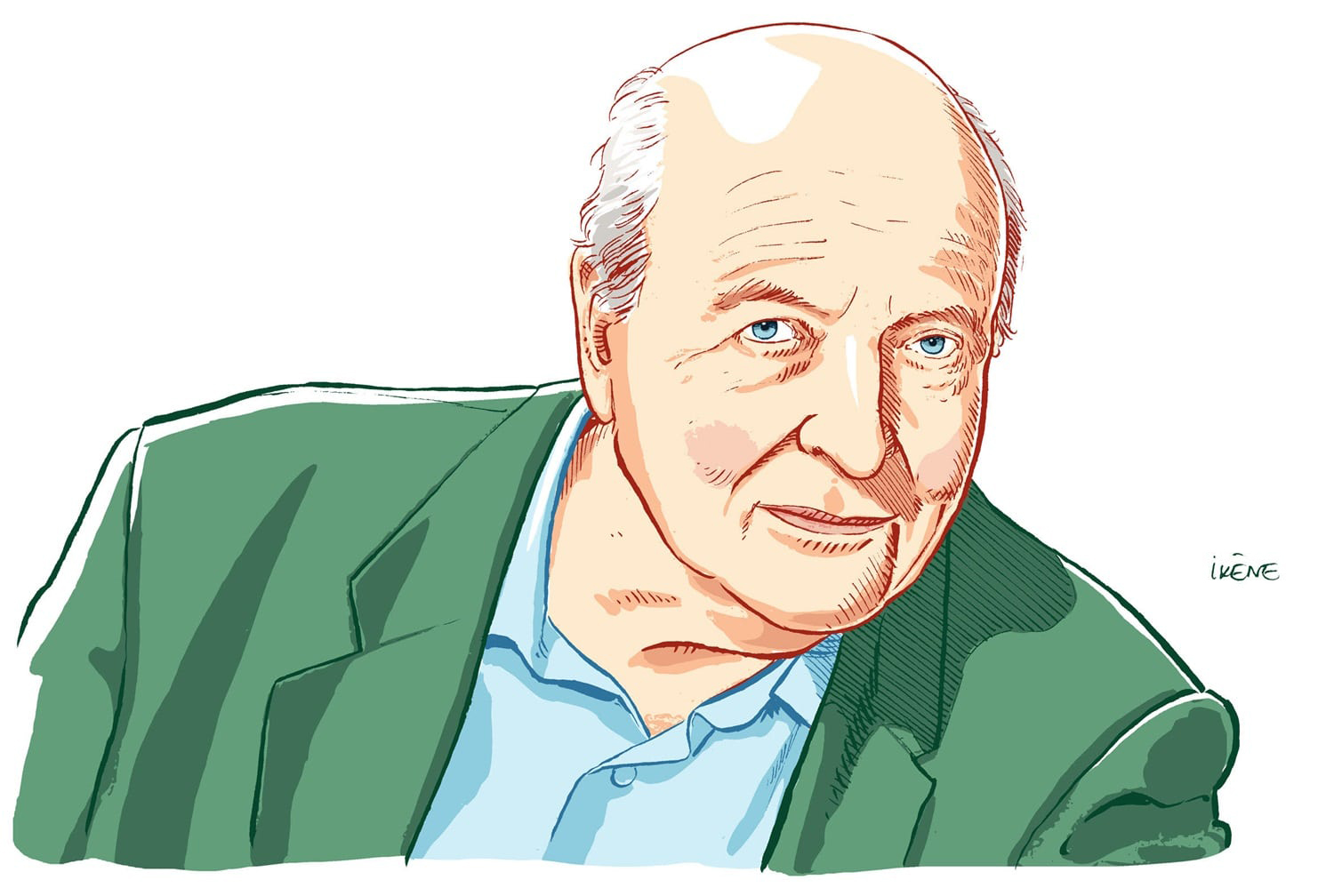



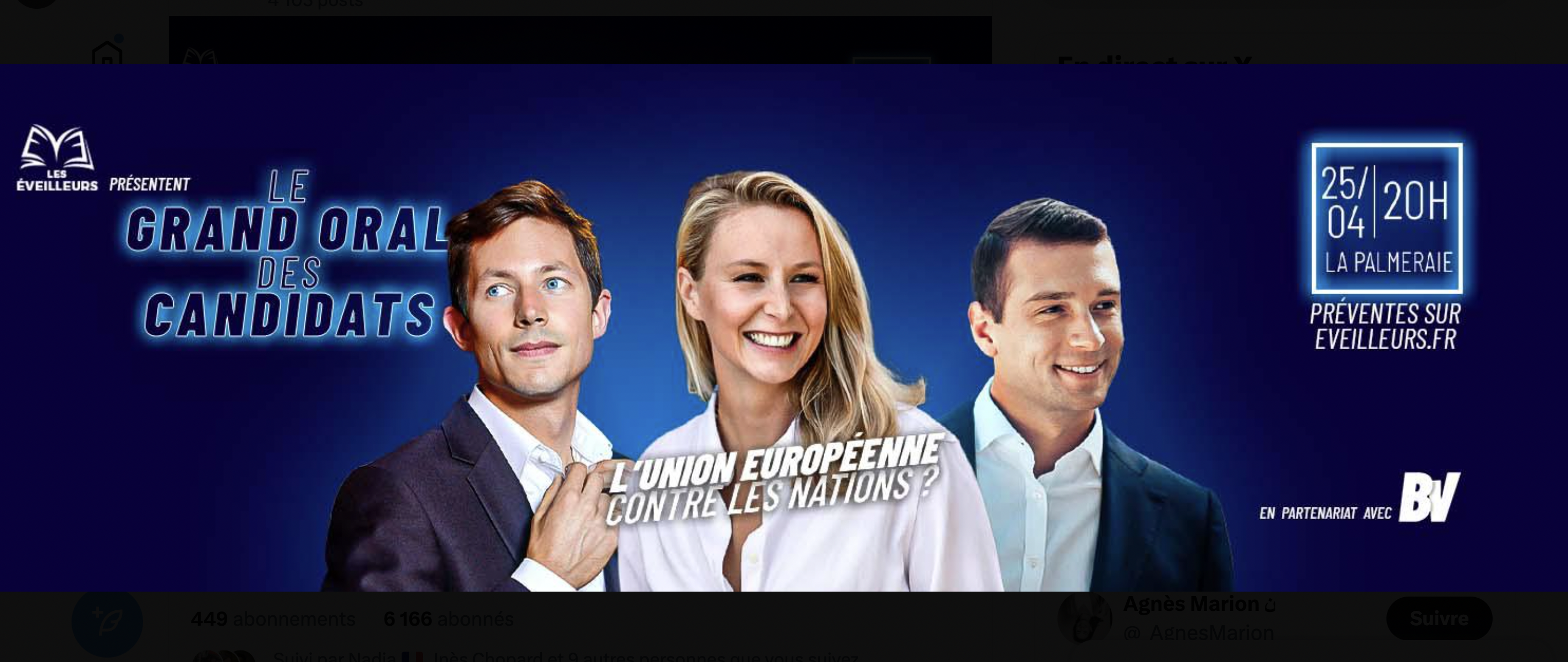





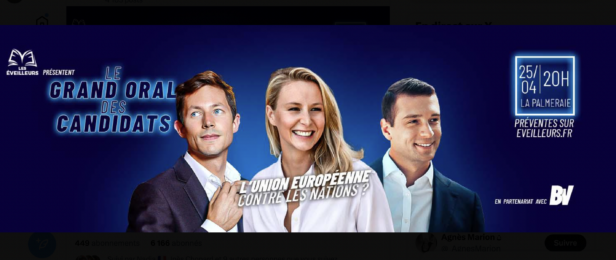






BVoltaire.fr vous offre la possibilité de réagir à ses articles (excepté les brèves) sur une période de 5 jours. Toutefois, nous vous demandons de respecter certaines règles :