Vers un monde sans travail

Quel est le sens du projet visant à réduire drastiquement le nombre de fonctionnaires au terme du mandat présidentiel d’Emmanuel Macron ? Car l’objectif est clair : supprimer 120.000 postes. Au nom d’un cahier des charges ultralibéral, la Macronie veut instituer, une bonne fois pour toutes, des emplois peu coûteux et des plus productifs possible. Le prétexte trouvé pour faire avaler la pilule aux salariés est l’application stricto sensu du temps de travail décrété, en 1997, par la gauche plurielle de Lionel Jospin et de Dominique Strauss-Kahn, et ce, au nom d’un rapport pondu par l’Inspection générale des finances, diffusé le 27 mars dernier. Tout le talent de ceux qui sont, encore aujourd’hui, les pères de Macron et Griveaux fut de faire croire que cette réforme était uniquement sociale et, en aucun cas, libérale.
En réduisant son temps de travail, le salarié pourrait davantage profiter de ses biens, dont beaucoup achetés à crédit. De plus, cette loi devait générer des emplois supplémentaires. En réalité, c’est le travail, dans son ensemble, qui s’est retrouvé rapidement dévalué : se rendre d’autant plus corvéable pour, finalement, gagner moins. À l’évidence, la gauche sociale française a été le meilleur allié de la droite (ultra)libérale. Simultanément, l’idéologie libérale a emprunté une voie qui devait l’obliger à rompre avec ses propres intérêts : la liberté et le droit de propriété (les deux premiers droits naturels mentionnés dans l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen).
Ces deux principes constituaient les bases d’un authentique libéralisme politico-économique tout en fondant, d’un même geste, le moule républicain et démocratique. Un équilibre acceptable à l’aube de la première mondialisation : la standardisation massive des outils de production ainsi que des moyens d’échanges. Seulement, la liberté devait devenir intégralement quantifiable, et le droit de propriété s’annihiler dans un temps de travail exponentiellement déterminé au rythme de production. Au bout du compte, la machine n’était pas plus la propriété du patron que celle de son ouvrier. Alors, la mort du propriétaire ne pouvait que signifier la mort du travailleur. Et quand le prolétaire meurt, les syndicats n’ont plus lieu d’être. La start-up nation n’aurait, donc, de sens que dans un open space où le principe de plaisir, utile à l’effort, devrait s’effacer au nom du principe de virtualité. Ce sont, ainsi, les propriétaires des data qui sont à même d’être les maîtres des horloges.
Le socialisme et le capitalisme ont été renvoyés dos à dos par un extrême centre chargé de mettre une dernière balle dans la tête du travailleur. À l’opposé de ce que pensait Marx, le travail n’est plus vivant, ni individuel, et encore moins subjectif. Voilà pourquoi les emplois du présent et de l’avenir se réduisent déjà à des services suspendus à la multiplication des clics à domicile, au mieux, ou à des trajets interminables (à vélo, en trottinette ou à moto), au pire. En somme, il n’est pas étonnant que la fonction publique doive s’appuyer sur une main-d’œuvre bon marché, et surtout polyvalente à souhait. Que ce soit en matière de revenus comme en matière d’allocations, c’est et ce sera 600 euros pour tous. En conclusion, l’« uberisation » n’est que l’autre nom de la précarisation : le triomphe définitif de la théorie sur l’expérience.
Thématiques :
FonctionnairesPour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR
- Jean Kast - 8 270 vues
L'intervention média
Les plus lus de la semaine
LES PLUS LUS DE LA SEMAINE
Les plus lus du mois
LES PLUS LUS DU MOIS
- Gabrielle Cluzel - 49 680 vues










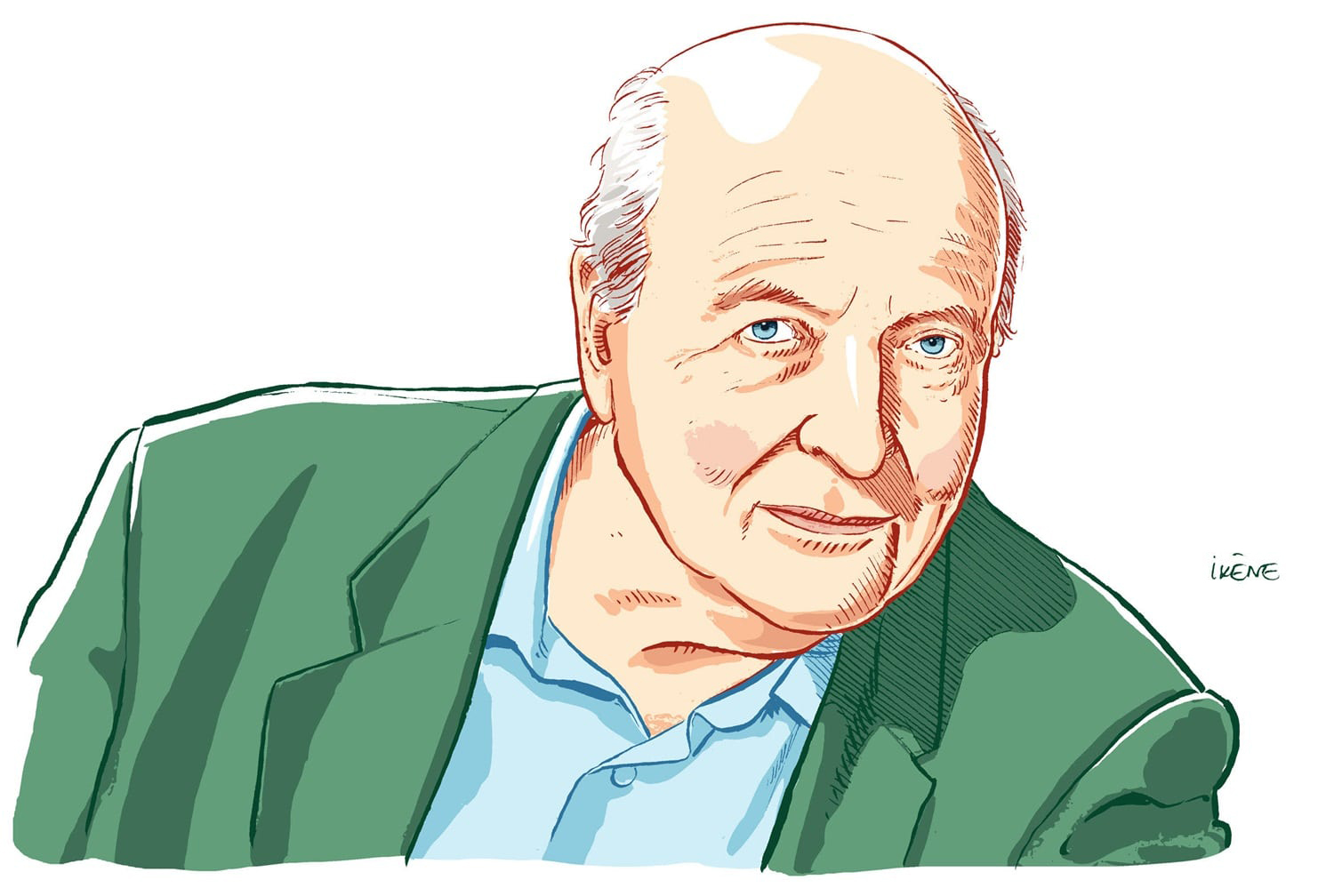




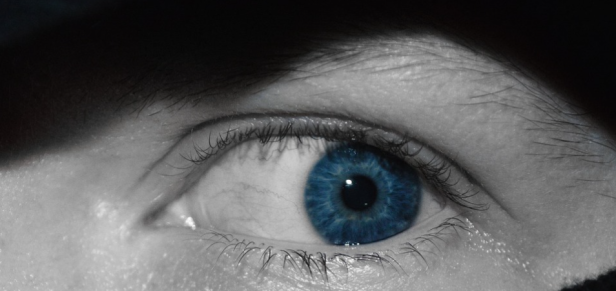



















BVoltaire.fr vous offre la possibilité de réagir à ses articles (excepté les brèves) sur une période de 5 jours. Toutefois, nous vous demandons de respecter certaines règles :