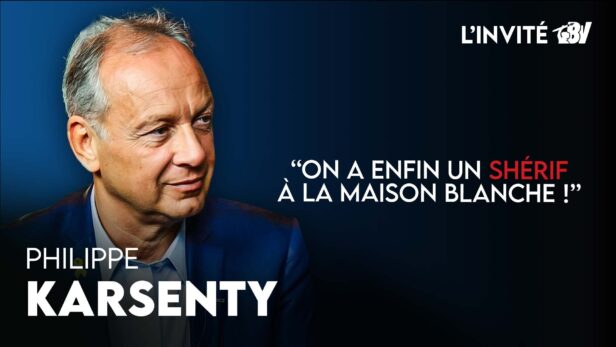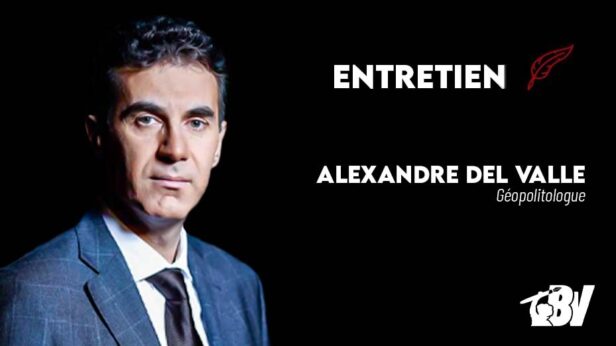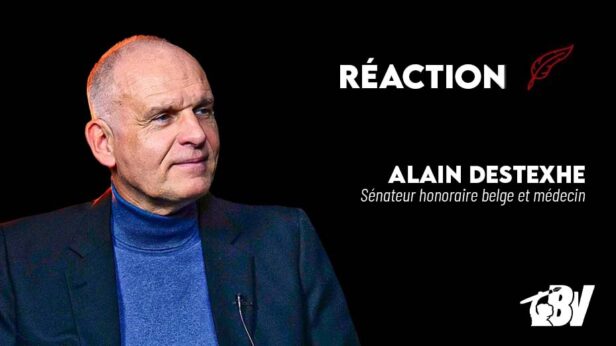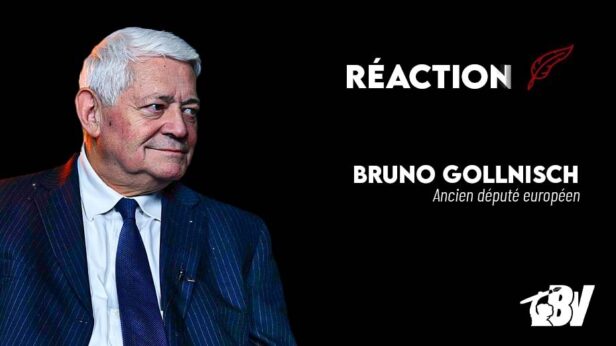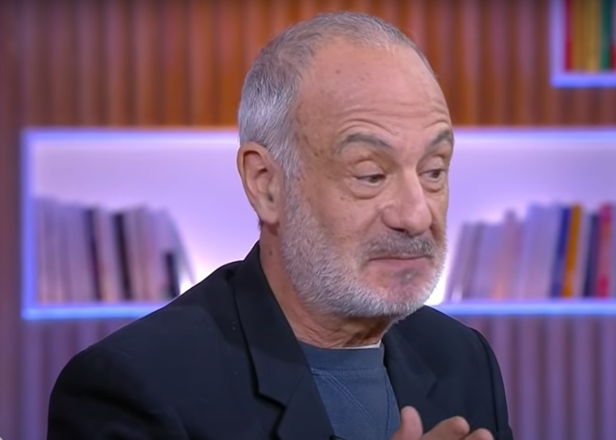6 mai 1211 : l’archevêque Humbert pose la première pierre de la cathédrale de Reims

Le 6 mai 1211, l’archevêque Aubry de Humbert posait la première pierre d’un monument appelé à devenir le cœur battant de la France monarchique : la cathédrale Notre-Dame de Reims. Huit siècles plus tard, elle fait l’objet d’une restauration majeure. Entre continuité historique et fragilité patrimoniale, elle éclaire l’avenir du patrimoine religieux français.
Une pierre fondatrice
Lorsque l’archevêque de Reims décide de poser la première pierre de sa nouvelle cathédrale, ce geste est alors loin d’être anodin. Il s’inscrit dans une volonté politique et religieuse de rebâtir rapidement l’édifice détruit par un terrible incendie vers 1210. La cathédrale de Reims n’est alors pas une église parmi d’autres : c’est le lieu du baptême de Clovis par saint Remi et, depuis Louis le Pieux, le cadre du sacre des rois de France, plus systématiquement depuis Henri Ier (né vers 1008 et mort le 4 août 1060).
L’archevêque entend édifier une cathédrale plus majestueuse encore, à la hauteur de la mission sacrée confiée à ce lieu emblématique. Le chantier s’étendra sur près de soixante ans pour l’essentiel de la construction. Néanmoins, l’édifice ne sera pas bâti dans le style carolingien comme par le passé, ni en roman mais dans un style nouveau, dit alors « français », qui s’impose peu à peu en Europe : le gothique.
Les plus beaux témoignages de cet art encore visibles à Reims sont ses trois portails monumentaux, sa rosace flamboyante ou encore sa nef élancée baignée de lumière. La façade, peuplée de plus de 2.300 statues dont le célèbre Ange au Sourire, transforme la cathédrale en un véritable livre de pierre à la gloire de Dieu, mais aussi du savoir-faire des artisans français.
Restaurer Reims en 2024
Depuis, la cathédrale n’a cessé d’affronter les assauts du temps et des hommes. Marquée par les guerres de Religion, la Révolution et surtout la Première Guerre mondiale, durant laquelle elle est lourdement bombardée dès septembre 1914, elle a plusieurs fois failli disparaître. À chaque fois, elle fut reconstruite, comme en témoigne la vaste campagne de restauration du XXe siècle, financée en partie par l’Américain John D. Rockefeller.
Aujourd’hui, encore, Reims vit au rythme des échafaudages, dans le cadre d’un vaste chantier de restauration entamé en 2009. Entre 2022 et 2024, c’est le chevet (la partie orientale de l’édifice) qui a fait l’objet de soins particuliers. Grâce à un financement de l’État via la DRAC Grand Est à hauteur de 3,6 millions d’euros, chaque pierre a été nettoyée, consolidée ou sculptée à neuf lorsque cela s’imposait. Ce chantier illustre alors une vérité essentielle : un patrimoine ne vit que si l’on s’en occupe. La cathédrale de Reims a traversé les siècles, non parce qu’elle était invulnérable, mais parce qu’elle a été aimée, soignée et transmise.
Un patrimoine religieux à l’abandon
Malheureusement, toutes les églises de France ne bénéficient pas de la même attention. Reims ou Notre-Dame de Paris masquent une réalité plus sombre. Selon l’Observatoire du patrimoine religieux (OPR), la France compte environ 42.000 églises, majoritairement communales et construites avant 1905. Leur entretien incombe donc aux communes, souvent rurales, souvent pauvres et trop souvent seules. Faute de moyens, de foi ou d’intérêt, 1.137 édifices sont aujourd’hui menacés de ruine, soit environ 150 par région, tandis que 4.000 à 5.000 sont dites en état de souffrance, c’est-à-dire affectées par des dégradations graves : murs lézardés, sols fissurés, présence de mérule ou d’humidité invasive. Selon un rapport sénatorial de 2022, l’OPR estime entre 2.000 et 5.000 le nombre d’édifices cultuels susceptibles d’être abandonnés, vendus ou détruits d’ici à 2030. Certes, de formidables initiatives comme la Mission Bern ou les campagnes de la Fondation du patrimoine permettent, chaque année, de sauver des édifices, mais ces efforts ne suffisent pas à combler un gouffre qui se creuse davantage chaque jour.
Ce désintérêt est révélateur : dans une société de plus en plus sécularisée et multiculturelle, le patrimoine chrétien est perçu non plus comme un héritage mais comme un simple vestige d’un temps passé. Pourtant, ces pierres racontent l’histoire de nos villages, l’âme de nos territoires et la foi de nos ancêtres. Elles doivent être regardées non comme un poids mais comme un trésor commun qu’il ne tient qu’à nous de préserver, à l’image de la cathédrale de Reims.

Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR