Livre : Hôtel Beauregard, de Thomas Clavel

Si, mutatis mutandis, Thomas Clavel, enseignant de son état et chroniqueur inspiré dans nos colonnes, a le talent indéniable d’un René Fallet, comprendra-t-il, néanmoins, que, par tempérament, nous lui préférions la poétique petite pension de famille Au Beau Rivage de ce dernier à son effrayant (et terriblement révoltant) Hôtel Beauregard, dystopique à souhait. Non pas que l’œuvre soit détestable (loin s’en faut), mais reconnaissons que son propos, lugubrement actuel par son prosaïsme prophylactique au bord de l’hystérie, n’engage guère à la bagatelle.
Après le coup de maître qu’a constitué son premier roman, Un traître mot, autre cauchemar orwellien, Thomas Clavel semble, avec ce deuxième opus, non moins brillant, se forger une spécialité dans le genre. À l’instar de son premier livre, Clavel part d’une situation réelle et extrapole, non point jusqu’à l’absurde, mais jusqu’aux confins de l’extrême médiocrité humaine, laquelle, est parvenue à un très haut degré de maturité. Triomphante, hautaine, fate mais d’une vacuité abyssale, elle arbore avec un solide aplomb défiant l’humanité du haut de son himalayenne stupidité son brevet de légitimité, sa rosette d’honorabilité : son démocratisme. Accouplée avec l’égalitarisme, dans un rapport de perversion incestueuse parfaitement assumée, elle se pavane...
Imaginez une jeune doctorante en biologie marine qui se trouve, du jour au lendemain, la victime honnie des réseaux sociaux. Par exhibitionnisme, par narcissisme, par orgueil ? Nenni. Un de ses amis, thésard comme elle, a eu la malencontreuse idée de « poster » une photo de groupe où elle apparaît comme la seule… à ne point arborer l’hygiénique bâillon. Stupeur et tremblement au sein de la communauté invisible - moitié virtuelle, moitié réelle - pullulant sur ces fétides réseaux asociaux où règne une abjecte déraison sociale.
À l’incitation criminelle d’une harpie ignare mais, ô combien !, « influenceuse » – qui plus est estampillée par les autorités officielles –, la pauvresse est littéralement traînée dans une indescriptible cyber-boue. Une de ses amies lui propose un temporaire exil au sein d’une antique pension hôtelière désaffectée, de style « Belle Époque », nichée en contrebas de la verdoyante colline de Cimiez, sur les hauteurs de Nice. Elle y rencontre un militant anti-masque fanatique ainsi qu’un vieil esthète qui se prend d’amitié pour la jeune femme et peint son portrait.
Nous ne dévoilerons rien du dénouement de ce roman, lequel, sous les auspices de l’antique tradition des eschyléennes tragédies grecques, prend aisément les allures d’une fable, tant l’auteur, sans s’ériger en moralisateur, se fait moraliste, discret mais sûr.
On ne sort pas indemne d’un tel livre. Toute ressemblance avec nos funestes temps n’est évidemment guère fortuite et le « Pusillaevirus » de la fiction emprunte furieusement ses traits pétochards à notre non moins paralysant coronavirus, quand le pouvoir et la police se font plus sanitairement tyranniques que jamais.
En refermant l’opus, l’on se prend à paraphraser La Harpe : plus l’esclave est veule, plus le maître est infâme.
Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR




















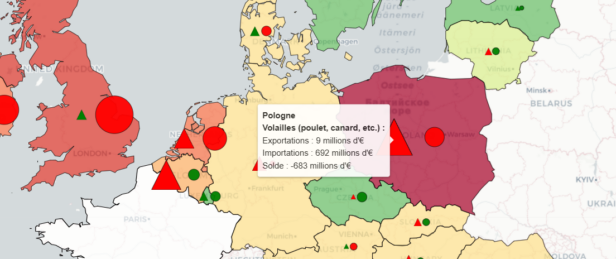












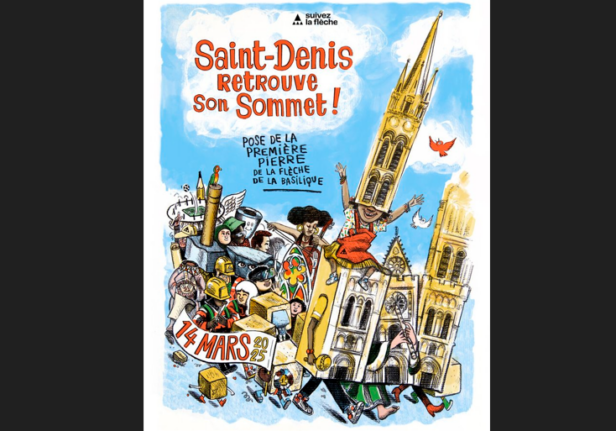



BVoltaire.fr vous offre la possibilité de réagir à ses articles (excepté les brèves) sur une période de 5 jours. Toutefois, nous vous demandons de respecter certaines règles :