Des voitures qui brûlent, des « violences inacceptables » à Paris… quand cela se passait dans nos banlieues, qui s’en est indigné ?

Depuis décembre 2018, des violences sont exercées tous les samedis contre les forces de l’ordre, les biens publics, privés, les symboles de l’État. Ces violences, condamnables, donnent lieu depuis des semaines à de nombreux commentaires, justifiés, conduisant à déplorer ces actes et leurs auteurs. Pourtant, je me refuse à rejoindre le chœur des pleureuses et des donneurs de leçons qui voudraient me voir, avec eux, condamner des « violences inacceptables ». Je reconnais l’exactitude de l’expression mais je me refuse à rejoindre les bonnes âmes qui veulent m’arracher des larmes qui, dans mon cas, ne seraient que des « larmes de crocodile ». Pourquoi condamner des violences avec autant de force, comme si elles étaient nouvelles et si elles n’étaient pas, en réalité, tolérées depuis plus de trente ans ?
Des voitures qui brûlent, des commerces qui ferment à causes des violences… Mais cela a commencé voici trente ans, dans nos banlieues ! Pourquoi devrais-je condamner aujourd’hui ce que l’on me demande de taire et d’accepter depuis trente ans ? Ah oui, les Champs-Élysées et le XVIe arrondissement, c’est géographiquement différent (mais pourtant bien en France, comme l’était ma banlieue voici trente ans). Fermer la boutique Chanel, ce n’est pas comme fermer les milliers de petits commerces (vous savez, ces moyennes surfaces continuellement volées, ces petits commerces dévalisés en toute impunité). Oui, c’est vrai, c’est plus visible. Et alors ?
Lorsque les « violences inacceptables » ont commencé en France, je n’ai vu personne venir nous voir pour dénoncer ces violences. Bien au contraire. Les voitures brûlent : les journaux sont invités à ne plus en parler afin d’éviter toute contagion. Les violences explosent : la presse est invitée à ne plus donner le nom des auteurs, ou à les franciser. Je vous parle, bien sûr, d’un temps oublié (les années 1980). Le ton était alors différent... Ne pas faire monter « qui vous savez »… Ne pas mettre le doigt sur les problèmes d’intégration… Surtout se taire, encore et toujours. Alors, nous nous sommes tus. Nous avons progressivement abandonné nos logements en banlieue pour aller plus loin, au calme, dans ce que nous allions plus tard appeler le périurbain (ou la France périphérique). Nos commerces ont fermé dans nos quartiers, laissant la place aux grandes surfaces et accélérant encore la périurbanisation.
Nous avons déménagé pour épargner à nos enfants les écoles, collèges (et parfois, mais plus difficilement, les lycées) mal fréquentés (mais surtout ne pas dire par qui… Ne pas faire monter « qui vous savez »).
Nous avons accepté de vivre loin de notre ville, utilisant la voiture (celle que conduisent les Français "qui fument des clopes et roulent au diesel"). Ce ne fut pas un choix, mais le plus souvent une nécessité.
Nous nous sommes retrouvés loin de chez nous, oubliés dans cet espace périphérique qui n’a pas attendu 2017 pour voter « qui vous savez ». Nous avons vu aussi cet espace se marginaliser par la disparition des services publics alors que, dans le même temps, les subventions pleuvaient sur notre ville et banlieue dont nous avions été chassés.
Nous avons dû lutter pour garder nos classes de primaire alors qu’ailleurs, dans notre ancienne banlieue, cette lutte n’était pas nécessaire. Notre faute, aussi : nous travaillons, nous suivons le travail de nos enfants… salauds que nous sommes. Il est tellement plus simple de ne rien faire, laisser nos enfants pourrir la classe, ne pas suivre leur travail. Là, on vous aidera ! (Note pour moi-même : et si on sabotait volontairement les évaluations nationales et si on brûlait quelques voitures, nous aussi, nous aurions droit aux classes dédoublées ? Ah non, ça, ce serait une « violence inacceptable ».)
Alors, je ne suis pas « gilet jaune » mais je comprends le mouvement né en novembre dernier. Depuis, ce mouvement n’est que l’ombre de lui-même, noyauté pas l’extrême gauche et ceux qui veulent rejouer le match perdu contre la loi Travail ou la réforme de la SNCF.
Thématiques :
Émeutes en banlieuePour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR
Un vert manteau de mosquées





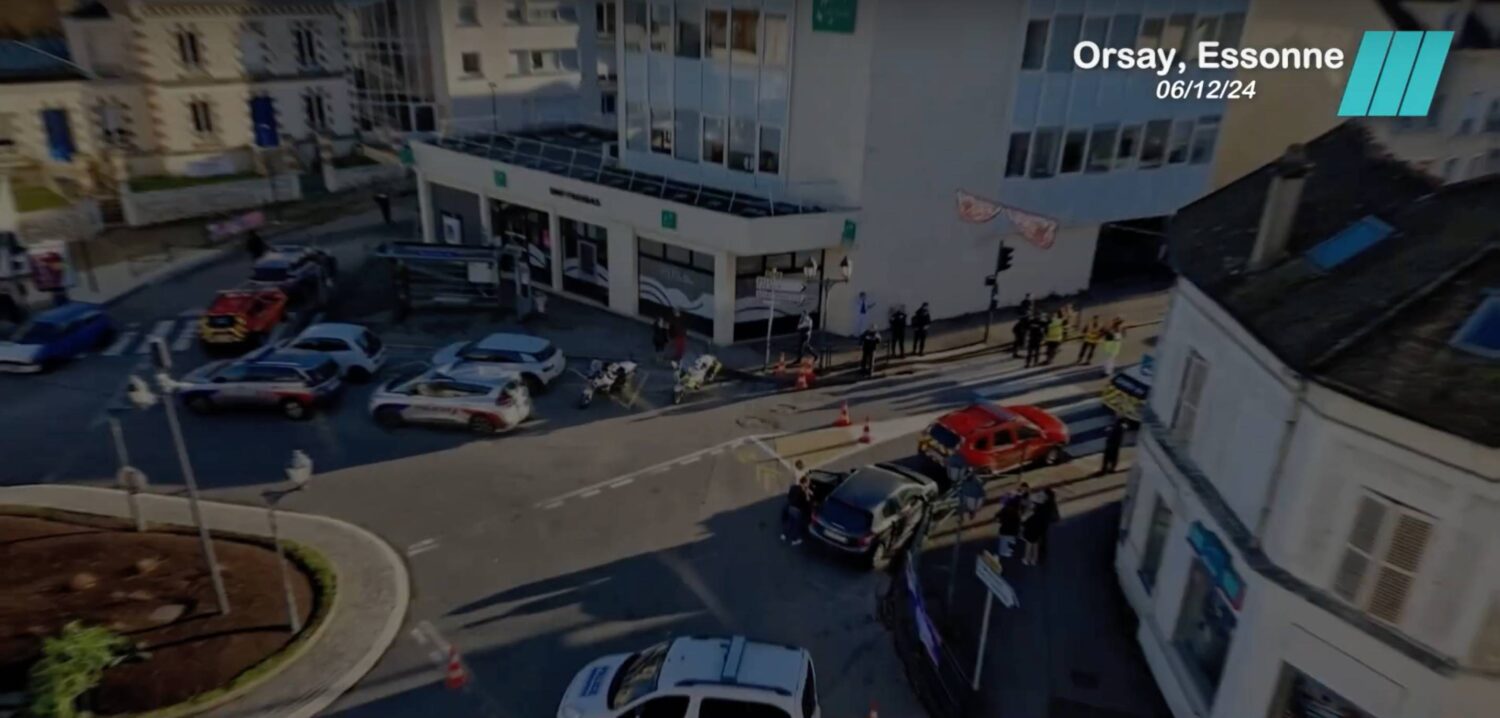






























BVoltaire.fr vous offre la possibilité de réagir à ses articles (excepté les brèves) sur une période de 5 jours. Toutefois, nous vous demandons de respecter certaines règles :