Cinéma : Alice et le Maire, un conte philosophique

Ne cherchez pas, dans le dernier long métrage de Nicolas Pariser, Alice et le Maire, les recettes du cinéma hollywoodien, sa musique envoûtante, sa pauvreté lexicale, ses effets bon marché. Là, tout n'est que dépouillement et jubilation de l'intelligence, nous dirions pétillement de l'esprit, puisque nous sommes en France. À ce titre, Alice et le Maire est une fable philosophique, à la manière de Voltaire ou de Diderot, où le sel de l'ironie relève d'un sourire sans vulgarité, sans cette lourdeur du gros burlesque, la mise en lumière d'une réalité déplaisante.
Et, à la manière du conte philosophique, le regard, celui de la gracieuse Anaïs Demoustier, qui dévoile un monde dissimulé sous son tulle tissé d'inanités sonores, est celui de l'ingénue, de la naïve, de l'innocente, démasquant, sans trop de fioriture, dès le début, ce qu'un enfant verrait spontanément, que le roi bardé d'or est, en fait, nu, complètement.
Le maire, incarné par Fabrice Luchini, est justement cette âme en peine, qu'un vêtement trop serré - celui du pouvoir - paralyse, étouffe, asphyxie.
La caméra de 35 mm, légère et vivante, accompagne, en travellings avant ou arrière, l'héroïne, de porte en porte, de pièces aseptisées en vastes salles palatiales saturées de dorures, au milieu d'un essaim de personnages, habillés du même « look » uniforme que dans les bureaux labyrinthiques de grandes multinationales, strict ou « cool », parfois pendus, quand ils jouissent de quelque responsabilité, à des portables toujours grésillants, dont l'unique vertu est de régurgiter le novlangue managérial et politiquement correct avalé durant leur formatage à Sciences Po. Un univers lisse, vide, dont la vacuité aurait conforté Pascal dans ses analyses les plus sombres. Un milieu aussi mortifère, infernal, où n'errent que des ambitions déçues, l'amertume de se sacrifier pour rien, où le prochain est l'ennemi, le camarade, le concurrent à tuer, où le « stress » ravage les cœurs. Le palais devient alors boîte obscure, peut-être celle de la caméra qui scrute, atmosphère « serrée », « pressée », voie étroite, angustiae, comme disaient les Romains, angoisse, comme si l'on avait une poire d'angoisse dans le gosier.
Inutile de voir, derrière Paul Théraneau, Gérard Collomb qui, du reste, a interdit, mesquinement, de filmer à l'intérieur de la mairie de Lyon. Le personnage de l'édile, ici, est d'une finesse, d'une honnêteté qu'on chercherait, peut-être en vain, dans le personnel politique actuel. Les lieux, les rôles, comme dans toute fable, sont de partout et d'ailleurs. Ce qui y est dénoncé, c'est la sclérose des « princes qui nous gouvernent », leur enfermement dans des stéréotypes, des certitudes langagières qui les coupent radicalement du peuple, de la nation. Certes, l'angle d'attaque est de gauche. Critique. On verrait même, dans le message final, quelque chose qui ressemble aux thèses de Jean-Claude Michéa. Ce qui compte, finalement, c'est que l'on soit déniaisé, comme après avoir lu Candide.
Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR




















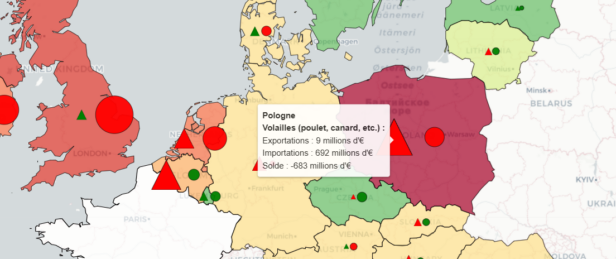












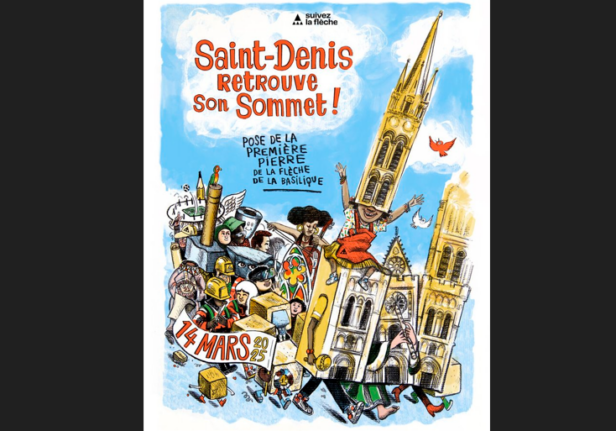



BVoltaire.fr vous offre la possibilité de réagir à ses articles (excepté les brèves) sur une période de 5 jours. Toutefois, nous vous demandons de respecter certaines règles :