Boris Johnson an I

À la gare de King’s Cross, nous nous apprêtions à prendre le train pour Cambridge quand mon fils me désigna un mur de briques. C’était celui à travers lequel disparaissait Harry Potter pour rejoindre le quai 9 3/4. J’avais acheté le Telegraph, à la une, Boris lançait : « I am the dude » (sous-entendu le gars qui le ferait.) Nous étions le 24 juillet 2019, Boris Johnson venait de rencontrer la reine pour être adoubé Premier ministre, mettant fin à la gouvernance terne de Theresa May. Le soir-même j’envoyais un papier à Boulevard Voltaire, titré à rebours des commentateurs français : Boris Johnson : Pourquoi est-il l’homme qui fera le Brexit.
Le lendemain, on apprend le « massacre politique » opéré par Boris Johnson, à son arrivée à Downing Street. Le Telegraph parle d’une « Nuit des blonds couteaux » : le nouveau Premier ministre se débarrasse de 17 ministres dans le remaniement « le plus important au Royaume-Uni depuis près de 60 ans ». À leur place, désormais, une équipe « remplie de loyaux et de Brexiters ».
Le 29 janvier, le Premier ministre britannique se réjouit à la perspective de la sortie de l’Union européenne, assurant que le Royaume-Uni peut « désormais aller de l’avant » et « mettre des années de rancœur et de division derrière lui ». Le dessinateur danois Niels Bo Bojesen le compare alors à Harry Potter traversant le platform 9 3/4, délaissant le monde des moldus, sans magie, pour celui des sorciers. Sans un regard en arrière.
Le Brexit eut lieu six mois plus tard, après trois ans d’attente. Les conservateurs, mieux élus en décembre, faillirent perdre leur chef en raison de la pandémie qui s’abattit sur la planète, son fils naquit et la plupart des gouvernements prirent des mesures prophylactiques qui enclenchèrent une crise mondiale.
Le 30 juin, Boris, gilet jaune, casque de sécurité, visite un chantier dans les Midlands, juste avant son premier grand discours post-Covid. Son message, limpide, écrit en toutes lettres sur son pupitre - « Build, build, build! » (« Construisons ! ») - signale-t-il un changement ? Non. Ce n’est pas le spend (« dépensons ») cher aux Français. D'ailleurs, pour Le Monde, c’est un bien modeste New Deal.
C’est pourquoi, pour fêter l’an I du gouvernement Johnson, nous retiendrons son discours du 2 février 2020 au Greenwich Royal Naval College. Appelant à lever les yeux au ciel, il lance : « Le Vatican a Michel-Ange, Greenwich a Thornhill, qui nous a laissé cette scène symbolique et un peu folle qui saisit l’esprit du Royaume-Uni au début du XVIIIe siècle. » Ces temps d’optimisme et d’expansion commerciale mondiale symbolisés par ces ancres, gouvernails ou sextants autour de nous invitent à « repartir à zéro, et retrouver l’esprit de ces ancêtres marins, dont les exploits ont apporté non seulement des richesses, mais une perspective globale ». C’est sous l’égide des souverains William et Mary, qui trônent au centre de la fresque, que parle le Premier ministre. Le couple régnant à partir de 1689 symbolise l’explosion du commerce mondialisé, propulsé par une nouvelle technologie navale, sans oublier la main invisible d’Adam Smith et le principe d’avantage comparatif de David Ricardo, qui enseigne que si les pays apprennent à se spécialiser et à échanger, la richesse globale et la productivité augmenteront, concluant avec Cobden que « le libre-échange est la diplomatie de Dieu – la seule façon sûre d’unir les gens dans la paix ; plus les marchandises traversent librement les frontières, moins les armées les franchissent. »
« Je ne vois aucun besoin de nous contraindre à un accord avec l'Union européenne, précise-t-il. Nous allons restaurer notre pleine souveraineté sur nos frontières, l'immigration, la concurrence, les règles encadrant les subventions, les approvisionnements, la protection des données. »
Thématiques :
Boris JohnsonPour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR
Un vert manteau de mosquées









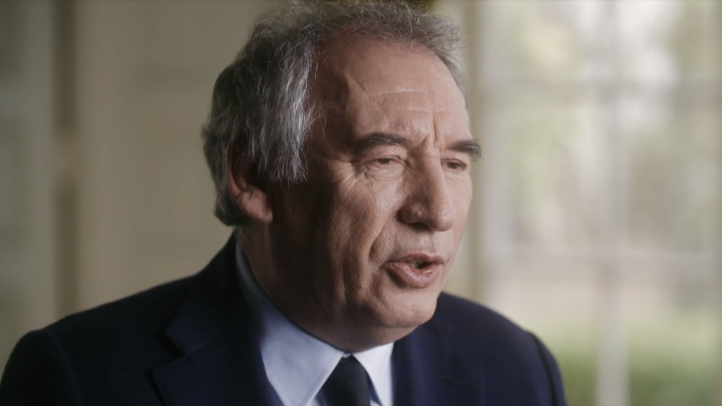

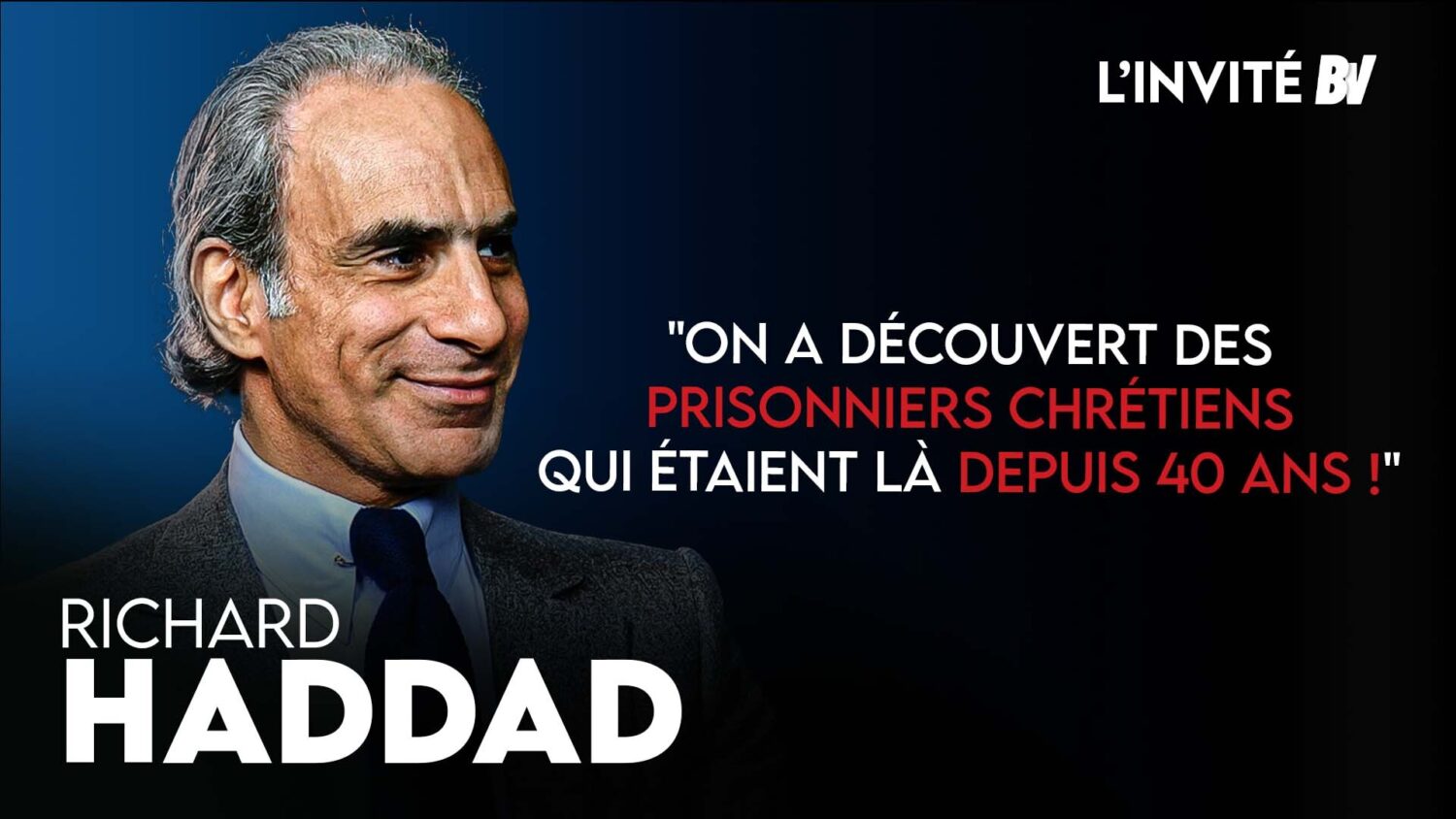


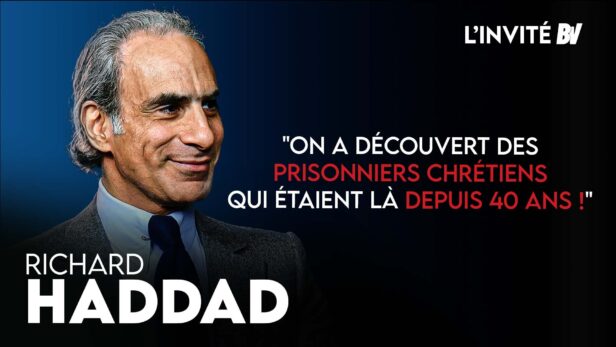






















BVoltaire.fr vous offre la possibilité de réagir à ses articles (excepté les brèves) sur une période de 5 jours. Toutefois, nous vous demandons de respecter certaines règles :