Vice, l’un des principaux journaux branchés, cesse de paraître

L’édition française de Vice, journal dont la maison mère est canadienne, devrait fermer d’ici fin mars. À l’origine, en 1994, Voice of Montreal est un mensuel gratuit. Ses ressources ? La publicité. Deux ans plus tard, il est racheté par ses journalistes et devient Vice, sobriquet des polices anglo-saxonnes spécialisées dans la drogue et les mœurs déviantes, équivalent de notre brigade mondaine de naguère.
CLAP DE FIN
Triste de l’écrire, mais c’est la fin de VICE France. Le bureau va fermer d’ici fin mars. 15 ans d’existence d’un média fabuleux qui m’aura donné ma chance il y a 10 ans. Fier d’en avoir été le rédacteur en chef pendant 5 ans, accompagné de personnes supers. ⬇️ pic.twitter.com/sWH5DiVLQ3— Paul Douard (@Paulo_Douard) February 27, 2023
En 2007, son édition française voit le jour et adopte les mêmes modes de financement et de distribution. Vice est alors le journal des métropoles, branché par excellence et réservé aux beautiful people. La preuve en est qu’il est distribué dans les lieux de « culture », galeries d’art, bars et restaurants, boutiques de fringues et cinéma. Bref, pas tout à fait le journal local qu’on lit sur le zinc du bistrot de province.
Dix ans plus tard, en 2017, la machine à paillettes commence à tanguer lorsqu’un certain Nicolas Bonard, issu d’une multinationale américaine, Discovery Communication, reprend la haute main sur ce périodique. Lui sait que les temps ont changé, que DSK, MeToo et la Ligue du LOL sont passés par là. Ce que n’ont manifestement pas compris les principaux patrons de Vice, Sébastien C. et Rodolphe B., tous deux écolos juste ce qu’il faut, antifas parce que c’est leur choix et adeptes des soirées mondaines de la capitale.
Seulement voilà, leur féminisme de bienveillance ne serait que de circonstance. D’où ces femmes commençant à se plaindre de réflexions permanentes que la plus élémentaire des pudeurs nous interdit d’ici reproduire. Un reportage du pourtant très neutre – logique, il est suisse – journal Le Temps fait le reste, provoquant le licenciement de ces deux satyres confondant sûrement carte du Tendre et celle des vins. Nicolas Bonard, le nouveau patron, ne s’y oppose pas plus que ça, sacrifiant les deux turlupins sans le moindre état d’âme.
La suite est finalement plus embêtante, surtout quand Libération met à poil le fonctionnement de ce même journal : « Publi-rédactionnels cachés, omniprésence des annonceurs. […] L’esprit punk original de la filiale française du média est perverti par la stratégie de la nouvelle direction. »
Sans l’avoir forcément voulu, cet article va au cœur du problème de la presse française : depuis que les annonceurs y font pluie et beau temps, ce sont eux qui en sont devenus les véritables patrons, surtout lorsque s’agissant d’un journal gratuit, encore plus dépendant de la publicité. Ironie suprême, on pourrait dire de même du quotidien jadis fondé par Serge July qui, lui aussi, fut « perverti » par ses annonceurs et ses financiers – la banque Rothschild, quel retournement cruel –, débouchant sur l’introduction de pages boursières et d’un alignement quasi inconditionnel vis-à-vis des USA lors de la première guerre du Golfe en 1990.
À ce titre, il y a des exceptions françaises dont on se passerait bien, dont celle voulant que des dirigeants de groupes industriels puissent en même temps détenir des groupes de presse, ce qui est interdit, même aux États-Unis. De droite ou de gauche, la mayonnaise demeure la même : peu importent leurs sensibilités politiques ou sociétales, puisqu’au second tour de l’élection présidentielle, ils appellent, plus ou moins discrètement, mais immanquablement, à voter pour Emmanuel Macron ou quiconque susceptible de faire barrage au Rassemblement national. Ce qui est parfaitement logique : quand on est proche du pouvoir, on l’est tout autant de ces marchés publics dont dépend souvent leur survie. S’il gouverne mal, le pouvoir sait se défendre.
Après, que les journaux puissent parvenir à ne vivre que de leurs seuls lecteurs, il ne s’agit pas forcément d’une utopie. La démonstration par Boulevard Voltaire ?
Thématiques :
Vice
Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR
























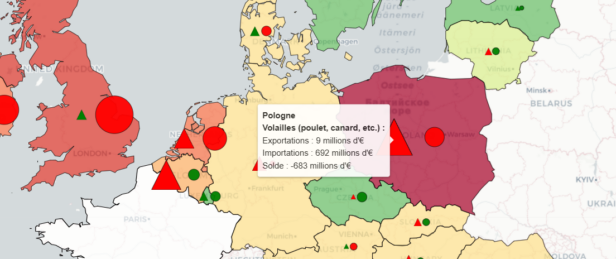











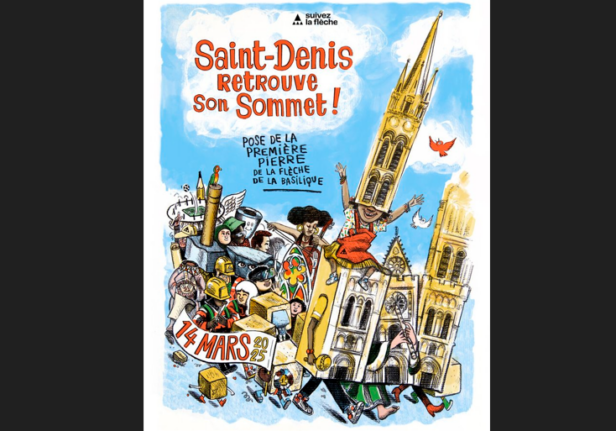



4 commentaires
Comme dit le proverbe, « c’est celui qui paye les violons qui choisit la musique ». Et je crois qu’en France, il n’y a que le Canard Enchaîné qui vive seulement de ses lecteurs.
» La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit «
Tellement vrai….
Même quand c’est gratuit, il y a toujours quelqu’un qui paie. Et, à l’exception de ce qui se passe sur les chaînes d’information publiques, c’est toujours celui qui paie qui décide. Trop habitué à accéder à du contenu gratuit, le public a oublié ou ignore tout simplement que personne ne dépense de l’argent sans en attendre un retour qui, dans le domaine de la presse, prend souvent la forme de l’influence.