La précarité menace les étudiants

Pour les 450.000 jeunes qui poussent jusqu’au master 2, leurs études durent au moins cinq ans, souvent six ou sept s’ils doivent redoubler une ou deux fois. Souvent, les facultés qu’ils fréquentent ne sont pas situées dans la ville où résident leurs parents, ce qui les oblige à prendre un logement. Certes, l’APL existe, mais elle ne couvre pas tous les frais. Il faut aussi se nourrir (heureusement, les restaurants universitaires existent), mais aussi se déplacer, acquérir des ouvrages pour les cours, voire se payer quelques loisirs. Toutes ces dépenses constituent un budget incompressible qui avoisine un demi-SMIC.
Or, 60 % des étudiants n’ont pas de bourse, et même quand ils en ont une, celle-ci ne dépasse pas 500 euros. Beaucoup de parents, y compris dans les classes moyennes, sont incapables d’aider financièrement leurs enfants, tant leur propre budget est serré. 60 % des étudiants sont contraints de prendre un travail d’appoint pour améliorer l’ordinaire, la moyenne est une douzaine d’heures par semaine ; celles-ci ont un impact sur les études en réduisant le temps que les jeunes leur consacrent.
La MGEN a fait réaliser une étude sur 1.000 étudiants âgés de 16 à 18 ans. Les résultats sont édifiants : 68 % des étudiants sauteraient de temps à autre un repas par manque de ressources, 33 % le font une fois par semaine. Leur budget nourriture journalier est, en moyenne, de 12,20 euros (le prix d’un repas du restaurant universitaire étant de 3,25 euros, inchangé depuis 2015) ; le petit déjeuner est parfois sacrifié ou réduit au minimum. Beaucoup de jeunes n’équilibrent pas correctement leur alimentation et sont parfois carencés. 25 % des étudiants ont déjà eu recours à une distribution gratuite de nourriture (Restos du cœur ou autre), contre 5 % dans la population française. Beaucoup d’étudiants ont déjà fait l’impasse sur des soins médicaux, dentaires ou autres, car incapables de les financer. Le reste à payer après une visite chez un médecin étant trop cher pour eux, surtout en Île-de-France où les dépassements d’honoraires sont la règle plus que l’exception. Une jeune fille sur trois ne voit jamais de gynécologue, au risque d’avoir une grossesse non désirée.
Toutes ces difficultés à joindre les deux bouts génèrent de l’angoisse, voire de la dépression. 30 % des étudiants seraient dans ce cas, mais ils ont rarement recours à un psychiatre. Désargentés, ils s’en remettent au soutien de leur famille et de leurs proches. Ce mal de vivre a un impact sur la consommation de drogue ou de cannabis, ce qui crée un cercle vicieux : me sentant mal, je prends des substances illicites qui accentuent ma dépression.
Or, les étudiants sont souvent mal informés de leurs droits. Ils ignorent qu’ils peuvent ne régler que ce qui n’est pas pris en charge par la Sécurité sociale. Ils comprennent mal le rôle des mutuelles.
La faillite de la MNEF, à la gestion calamiteuse, est la cause principale de ce gâchis. La Sécurité sociale ayant pris le relais, on peut espérer que ces problèmes de santé se résoudront. Le RSA étudiant serait une bonne chose, mais il coûterait 30 milliards. Or, les caisses de la France sont vides.
Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR




















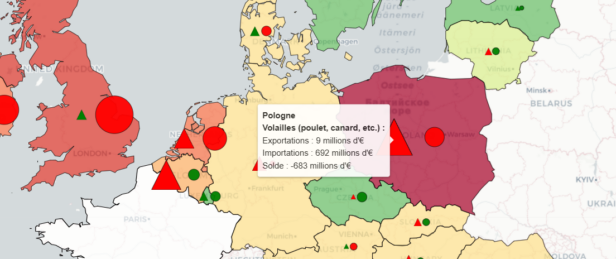












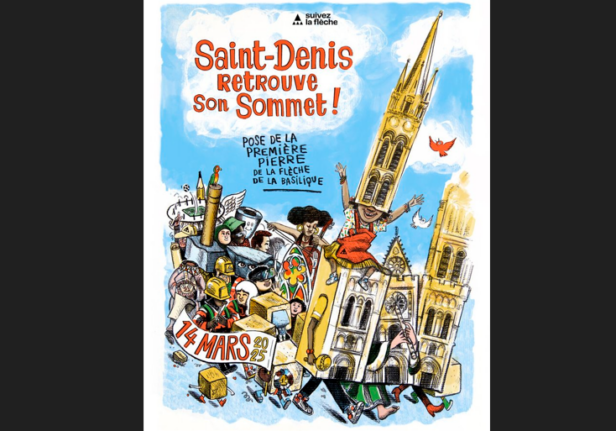



BVoltaire.fr vous offre la possibilité de réagir à ses articles (excepté les brèves) sur une période de 5 jours. Toutefois, nous vous demandons de respecter certaines règles :