Conte de Noël : L’Extase, par G. Lenotre

Qu’est-ce que l’esprit de Noël, la magie de Noël ? C’est peut-être, le temps d’une lecture, retrouver son âme d’enfant.
Boulevard Voltaire propose, pour nous y aider durant ces quelques jours, une sélection de contes de Noël.
Aujourd’hui, L'Extase, de G. Lenotre (1855-1935), tiré de Légendes de Noël, choisi par Gabrielle Cluzel.
La scène se déroule au château de Compiègne lors d’un séjour de la cour de Napoléon III, un soir d’hiver.
Après le dîner et la musique, les causeries commençaient.
L’impératrice avisa le vieux général d’Olonne qui, de la soirée, n’avait pas proféré un mot :
À vous, général, dit-elle, contez-nous une histoire.
— Moi ! Que Votre Majesté m’excuse, je n’en sais pas… ou, plutôt, je n’en sais qu’une, si lointaine, si naïve…
— Tant mieux, je n’aime que celles-là. Le nom du héros ?
— Votre Majesté me permettra de ne le divulguer qu’à la fin..., si je me tire de mon récit.
— Soit. C’est une histoire de guerre ? De révolution ?
— De guerre, oui.
— Bravo ! Ce sont les plus belles.
— Et de révolution, aussi, car celui auquel échut l’aventure était un orphelin de la façon de Robespierre : c’était un enfant nommé Jean ; son père et sa mère avaient été arrêtés une nuit dans leur château de la Somme, traînés à Paris et guillotinés. Le château même avait été envahi et pillé par les sans-culottes de Montdidier. Ces choses n’avaient pas laissé de trace dans l’esprit du petit Jean, âgé seulement de sept ou huit mois ; mais sa grand-mère maternelle, la vieille marquise d’Argueil, avait gardé de ces événements tragiques une impression ineffaçable ; elle avait fui, à demi folle d’horreur, emportant son petit-fils. D’étape en étape, reculant devant les armées victorieuses de la République, la grand-mère et l’orphelin étaient ainsi parvenus jusqu’en Autriche ; certaine d’être là à l’abri des sans-culottes, la marquise s’était fixée à quelques heures de Brünn, sur les confins de la Moravie, dans un village appelé Slibowitz.
C’est là que Jean grandit, entre son aïeule inconsolée et un saint prêtre, évadé des bagnes de la République. Il s’éleva, tant bien que mal, recueillant de la marquise les traditions de sa famille, et recevant les leçons du prêtre, qui lui apprit un peu de latin et beaucoup de cantiques. En fait d’histoire, on ne lui enseigna qu’une chose : c’est que depuis la chute du trône des Bourbons, le peuple français, jadis si policé et si élégant, s’était transformé en une horde de cannibales.
Lorsque Jean sortait de chez son précepteur, l’esprit hanté des noyades, des déportations, des tueries de Septembre, des égorgements de Lyon ou de Cambrai, il retrouvait chez sa grand-mère le même cauchemar dans le récit des visites domiciliaires, des arrestations, des guillotinades, et de la mort sanglante de son père et de sa mère…
Il en frissonnait, le soir, dans son petit lit, en écoutant causer la tremblante marquise et le maigre abbé, qui se communiquaient les nouvelles apportées par la gazette. Jean apprit ainsi que ces démons de Français, lassés de l’anarchie, s’étaient donné pour chef un ogre qu’ils avaient fait venir de Corse, et en comparaison duquel Attila, le fléau de Dieu, n’était, au dire de l’abbé, qu’un placide et paterne bonhomme. L’enfant en rêvait la nuit et en restait préoccupé tout le jour.
— C’est loin, la France, grand-mère ? demandait-il pour se rassurer.
— Très loin, mon enfant, grâce à Dieu ! gémissait la pauvre dame.
— Et vous êtes sûre que l’ogre ne viendra pas nous chercher ici ?
— Dieu ne le permettra pas, sans doute.
Je dois dire à Votre Majesté qu’avec l’âge, la curiosité, dans l’esprit du petit Jean, prenait la place de la terreur : tous les ancêtres de mon jeune héros avaient porté l’épée, et son petit cœur battait la charge dès qu’on parlait guerre, soldats et batailles rangées.
Il venait d’avoir douze ans au mois de décembre 1805 ; depuis quelques mois, son esprit était en éveil : on ne s’était pas caché pour parler devant lui des événements qui bouleversaient l’Europe ; il savait que les Français avaient envahi l’Allemagne et s’étaient avancés jusqu’à Vienne ; le village de Slibowitz, qu’il habitait, avait même été occupé, pendant bien des semaines, par un corps de soldats russes. Jean avait couru les bivouacs, admiré les cosaques barbus. Ils allaient se battre contre Bonaparte, et le lendemain, dès l’aube, on entendit en effet, au loin, du côté de Brünn, ronfler une canonnade qui ne prit fin que vers le soir.
Personne ne dormit cette nuit-là dans le bourg : on attendait des nouvelles. Vers deux heures du matin, les cosaques traversèrent le village en tourbillon, à la débandade, et ne reparurent plus. On apprit seulement quelques jours plus tard que les Français étaient victorieux et que l’empereur d’Autriche implorait grâce.
La marquise d’Argueil, persuadée que la guillotine allait reparaître, en tremblait d’émotion et d’effroi ; l’abbé préparait ses bagages. Quant à Jean, il était à la fois très inquiet de savoir l’Ogre si près de lui, et très fier pourtant à la pensée que ces robustes cosaques, à qui rien ne faisait peur, avaient été si prestement mis en déroute par les troupiers français. Quelle pouvait bien être l’allure de ces héros ? Et dans son impatience il aurait voulu voir, ne fût-ce qu’en image, ne fût-ce que sous forme de jouets, ces hommes terribles qui conquéraient ainsi l’Europe tambour battant.
La veille de Noël, tandis que la marquise s’apprêtait pour la messe de minuit, il plaça, avant de se coucher, ses souliers devant l’âtre et déposa près d’eux, bien en évidence, un feuillet blanc où, de sa plus belle main, il écrivit : Petit Jésus, apportez-moi des soldats français. Il se coucha plein d’espoir et s’endormit.
Je dois dire qu’en rentrant des offices, vers cinq heures du matin, la vieille marquise ne songea même pas à jeter un regard du côté de la cheminée : elle venait d’apprendre que l’Ogre approchait. Elle alla jusqu’au lit de Jean, dressé dans une alcôve au fond de l’unique salle dont se composait le rez-de-chaussée de la maison, murmura deux ou trois : « Pauvre petit ! », et se prépara à monter à sa chambre. Elle avait déjà gravi quelques marches de l’escalier quand un grand bruit se fit dans la rue : des piétinements de chevaux, des appels, des chocs d’armes, et, aussitôt, des coups pressés, frappés à la porte de la maison.
La marquise n’eut pas la force de s’évanouir : elle recommanda son âme à Dieu et alla ouvrir la porte. Sur le seuil, quelques hommes, qui lui parurent pour la plupart gigantesques, se tenaient couverts de grands manteaux à pèlerines et coiffés de bicornes dorés ; d’autres, en masse, restés à cheval, barraient la rue du village. Elle recula, les hommes entrèrent sans façon. L’un d’eux, le plus petit, s’avança vers elle, et d’une voix très douce, lui dit :
— Excusez-nous, bonne vieille, nous aurons fini en quelques minutes.
Déjà les autres avaient tiré la table près de la cheminée, approché la lampe et étalé de grandes cartes.
— Voyez, sire, dit l’un.
Celui qui l’avait appelée « bonne vieille » se pencha, le sourcil froncé, et elle comprit tout de suite que c’était lui… l’Ogre ! Bonaparte ! La marquise, écroulée sur les marches de l’escalier, s’apprêtait à bien mourir et se disait la prière des agonisants.
L’empereur releva la tête.
— C’est bien, fit-il.
Les officiers, docilement, replièrent les cartes ; lui s’approcha du feu mourant, s’assit sur un escabeau, saisit les pincettes et tisonna nerveusement. Puis il se prit le front dans les mains et resta songeur, les yeux fixes. Les aides de camp, derrière lui, se tenaient debout, immobiles, attendant ses ordres.
Bonaparte se pencha, l’œil fixé sur la feuille blanche posée en travers des petits souliers. Il la saisit et, à demi-voix, lut : Petit Jésus, apportez-moi des soldats français… Il releva le front.
— Qu’est-ce que cela ? dit-il.
Puis appelant :
– Berthier ?
Un des généraux de la suite s’approcha.
— À quelle date sommes-nous ? Est-ce aujourd’hui Noël ?
— Oui, sire.
— Tiens ! c’est la nuit du réveillon… Qui donc habite cette maison ? Des Français ?
Il se leva, le feuillet à la main, et vint à la marquise.
— Vous parlez français, bonne femme ?
— Oui, balbutia-t-elle. Grâce !
L’empereur allait et venait par la chambre, il arriva ainsi au lit où dormait Jean.
— C’est cet enfant qui a écrit ce souhait ? Il est Français, lui aussi ?
— Oui, répéta la marquise rassemblant ses forces. Grâce pour lui, du moins !
L’empereur n’écoutait pas, il s’était penché sur le petit lit et regardait l’enfant dormir.
— Sortez-le du lit, sans le réveiller, si c’est possible ; et enveloppez-le bien, qu’il ne sente pas le froid.
Puis, se tournant vers la marquise :
— Je le prends, dit-il, on vous le ramènera tantôt.
— Seigneur ! s’écria l’aïeule en sanglotant.
Mais déjà Berthier avait sorti Jean de son lit et le roulait dans les couvertures. L’empereur, au seuil de la maison, monta sur son cheval que tenait en main un mamelouck. Le petit jour blanchissait le ciel : la vieille marquise, paralysée par la terreur, vit, de ses yeux noyés de larmes, l’aide de camp soulevant le petit Jean, le présenter à Bonaparte, qui, d’une voix très douce, presque tendre, répétait :
— Doucement, doucement, ne le réveillons pas.
Il le posa devant lui, sur le velours pourpre de sa selle, et, appuyant la tête de l’enfant contre sa poitrine, il disparut dans l’aube grise, suivi de son escorte.
Quand Jean, plus tard, rassemblait ses impressions de ce matin-là, il se souvenait avoir ouvert les yeux, aussitôt refermés, gros de sommeil. Son visage était enfoui dans la fourrure, il avait chaud, il se sentait bien ; il lui semblait qu’on le berçait, et quelqu’un penché sur lui, répétait, d’un ton très bas :
— Dors, mon petit, dors !
Puis il entendit tout à coup comme un bruit de tonnerre, il ouvrit les yeux, ébahi. Il était emporté, au grand galop d’un cheval, serré contre un homme qui, le tenant à bras-le-corps, le regardait tout souriant et répétait :
— N’aie pas peur ! Tu as demandé au petit Jésus des soldats français. En voilà !
Et, dans la plaine, à perte de vue, s’alignaient des régiments merveilleux : lignes sombres de grenadiers, coiffés de bonnets d’ourson, auxquelles succédaient les lignes plus claires de voltigeurs ; puis les dragons rangés sur leurs chevaux qui saluaient de la tête ; puis les lanciers dont les flammes roses frissonnaient au vent du matin… Et, à mesure que le maître avançait, du fond des rangs montait le grondement rythmé des tambours battant Aux champs, les éclats des fanfares victorieuses, les cris formidables de toute l’armée acclamant son empereur. Au loin, le canon solennellement tonnait, les baïonnettes étincelaient sous le soleil levant, et lui, grisé, les narines ouvertes, les lèvres souriantes, le front radieux, serrait l’enfant dans ses bras, et, de temps en temps disait :
— Tu vois, comme c’est beau ! N’est-ce pas que c’est beau ?
Le général d’Olonne s’essuya les yeux, se tut un instant et reprit :
— Quand la revue fut terminée et que l’empereur m’eut remis aux mains…
— Comment, général, le petit Jean, c’était vous ?
— C’était moi, Majesté… Je rentrai à Slibowitz dans l’état d’un être à qui Dieu a entr’ouvert la porte du ciel ; deux jours plus tard, j’étais inscrit dans les pages et je prenais le chemin de Paris. C’est ainsi que ma carrière a commencé.
Voilà pourtant les surprises que l’Enfant Jésus apportait aux petits Français de ce temps-là !
Thématiques :
Napoléon IerPour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR
Un vert manteau de mosquées

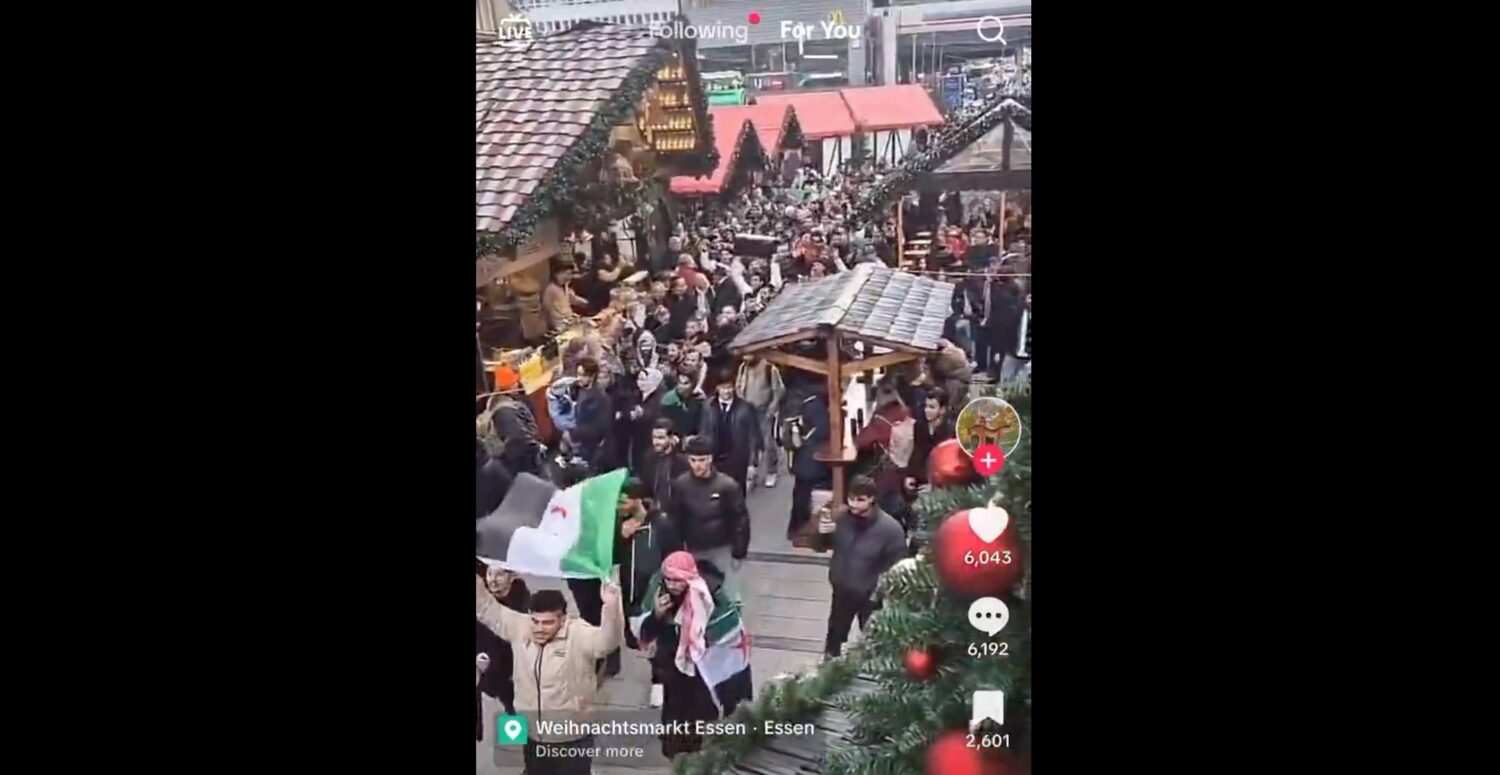




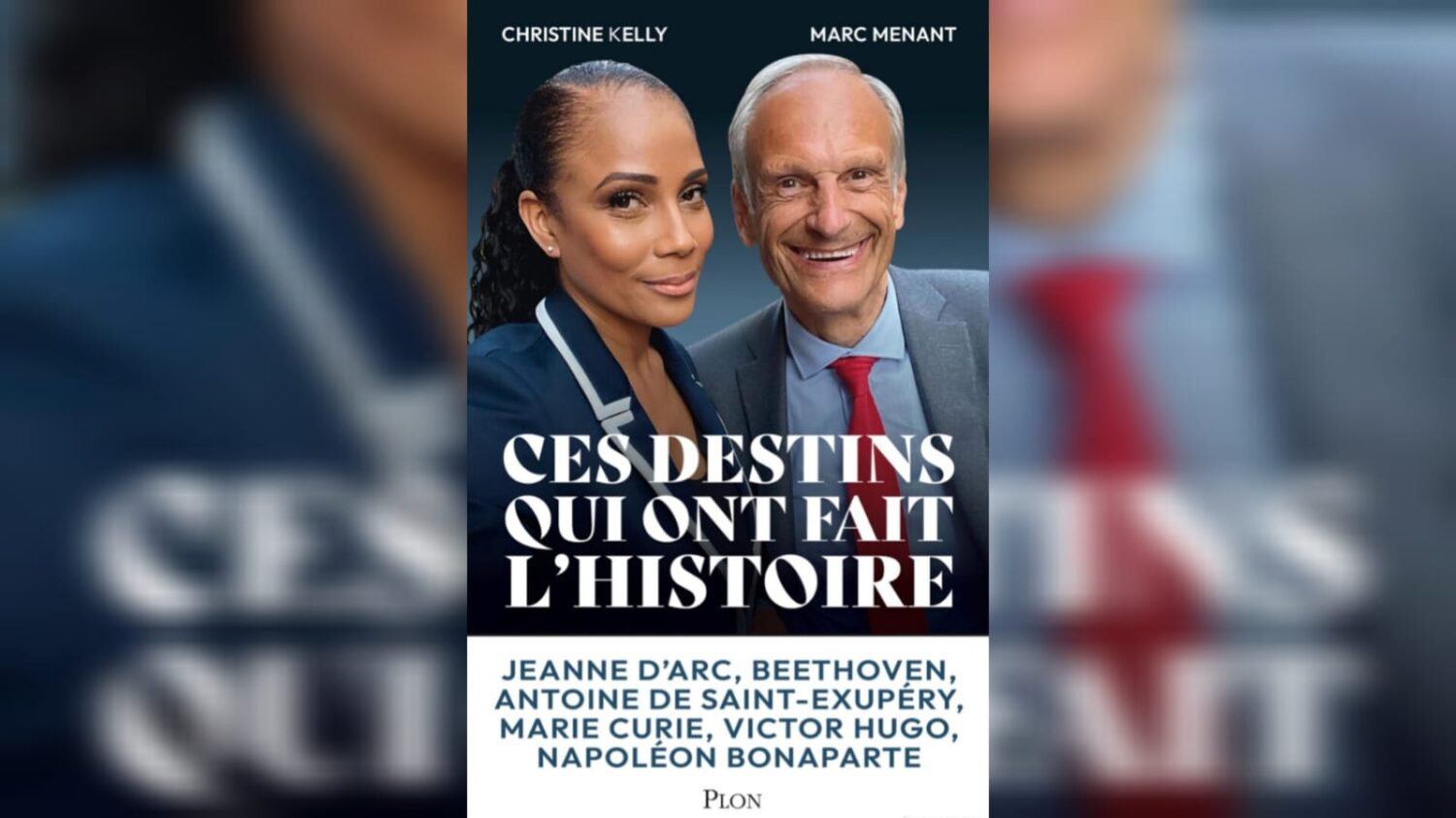


























BVoltaire.fr vous offre la possibilité de réagir à ses articles (excepté les brèves) sur une période de 5 jours. Toutefois, nous vous demandons de respecter certaines règles :