1959, la nuit de l’Observatoire : 7 – Mitterrand revient. Et attaque
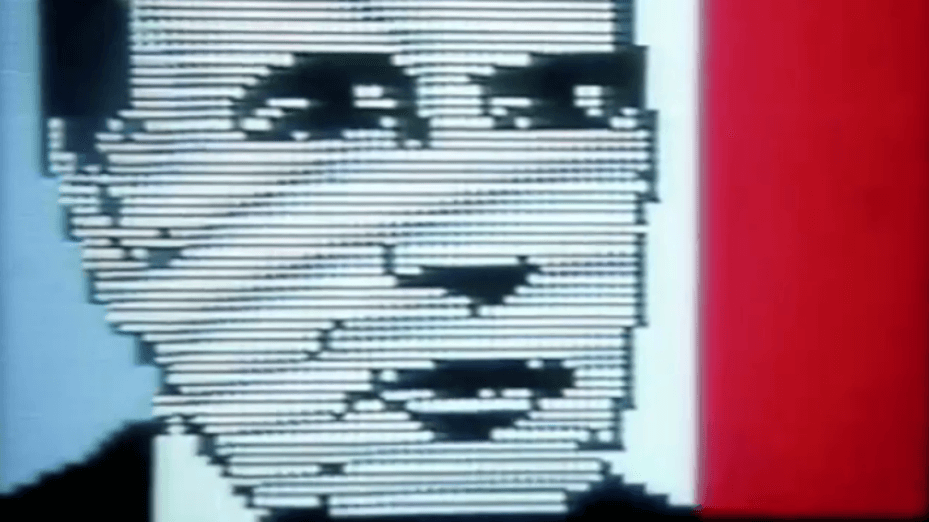
Comment les affaires ont abîmé la France. Nous vous racontons, en 13 épisodes, l'une des affaires les plus marquantes du régime et sur son traitement médiatique, l'affaire de l'Observatoire, qui faillit bien coûter la carrière d'un politicien plein d'avenir, un certain François Mitterrand. Extrait d'Une histoire trouble de la Ve République, le poison des affaires, de Marc Baudriller, paru en 2015 aux Éditions Tallandier.
(lire épisode 6) « Qu’ai-je à attendre d’un simulacre de cette nature ?, demande le sénateur acculé. À qui rapporte cette comédie ? Aurais-je été chercher pour cette besogne un député poujadiste parmi les plus excités, exclu du RPF, qui traîne son absence d’emploi, s’occupe de journaux qui ne paraissent pas et vit de subsides qui ne sont connus de personne ? Un ultra parmi les ultras ? Le général Salan n’en voulait pas ! » Mitterrand jette le trouble à pleins seaux sur celui qui l’accuse. Des sommets de la République, l’ancien ministre déverse un fleuve de mépris grossi de soupçons en tous genres. En quelques mots, Robert Pesquet change d’image.
Puis Mitterrand donne sa version des faits. Il a bien rencontré le député poujadiste mais il l’a vu pour la première fois le 7 octobre au palais, en présence de témoins, un quart d’heure à une demi-heure, pas plus. Comment Pesquet a-t-il pu, en si peu de temps, convertir le sénateur de la Nièvre à ses idées pour « le soumettre à la plus vile des besognes » ? L’avocat Mitterrand fait face au récit de son adversaire comme un sanglier blessé affronte les chiens, sans se départir de cette distance quasi métaphysique qui sera sa marque et dont il fera une seconde nature.
Son argument principal revient en boucle. Pesquet est un adversaire politique : comment l’ancien ministre l’aurait-il pris pour complice ? Mais le vrai-faux assassin a répondu d’avance : c’est précisément parce qu’il est un adversaire politique que Mitterrand l’a choisi. Sur le fil, l'ancien ministre raconte comment Pesquet s’est renseigné sur ses horaires habituels à plusieurs reprises. Il lui suffisait de se poster au bon endroit. Invérifiable et démenti par Pesquet. Et puis, la lettre écrite et postée par Robert Pesquet avant l’attentat était-elle unique ? demande Mitterrand. Il y a trois itinéraires pour aller de Lipp à la rue Guynemer. Pesquet peut fort bien n’avoir révélé que celle des trois lettres qui correspondait à la version et à l’itinéraire donnés par Mitterrand. Pesquet répondra quelques jours plus tard dans Rivarol. « Les arguments de Mitterrand me font sourire. J’aurais pu poster, dit-il, plusieurs lettres décrivant toutes des itinéraires différents. Encore eût-il fallu avoir le temps matériel de se livrer à ce jeu compliqué. Mitterrand oublie-t-il que je ne l’ai quitté qu’à 18 h 30… » le jour même de l’attentat ? Le tampon de la poste fait foi. Enfin, la lettre de Pesquet ne pourrait-elle pas avoir été antidatée par un ami postier ? Thèse abandonnée aussitôt énoncée. Pour Mitterrand, le chemin du salut politique est extraordinairement étroit.
Il répète et reprend ses explications : il a rencontré en effet plusieurs fois Robert Pesquet. Le député l’a convaincu qu’une bande de tueurs voulaient sa peau. Lui, Mitterrand, risquait à tout instant de tomber sous les balles d’un assassin. Pesquet lui-même prenait des risques inouïs, lui disait-il, pour prévenir cet ennemi politique pour lequel il éprouvait une certaine sympathie. On lui a joué la comédie.
« J’apprends aujourd’hui le nom du tueur, précise Mitterrand, c’est Monsieur Dahuron. Pesquet ne veut pas dire le propriétaire de l’auto, ni remettre l’arme. » Rejeter sur Pesquet le scepticisme général, c’est évidemment la voie du salut. Mais à ce stade, une question s’impose à tous. Pourquoi diable Mitterrand n’a-t-il rien dit ? Pourquoi n’a-t-il pas prévenu la police des risques d’attentat qui pesaient sur lui ? Pourquoi n’a-t-il pas évoqué ces menaces lors de sa première conférence de presse, au lendemain de l’attentat ? Pourquoi ? demandent ses amis. Pourquoi ? demande la presse.
Par humanité, tout simplement, répond Mitterrand. Robert Pesquet l'a supplié de ne pas le dénoncer à la police, sans quoi il serait lui-même abattu. « Je suis membre d’une organisation subversive, aurait poursuivi le Pesquet de Mitterrand. […] De votre discrétion dépend la vie de vos deux fils. » Pesquet, aux mains d’une mystérieuse et dangereuse organisation, aurait trahi ses commanditaires pour le prévenir, lui, François Mitterrand : le futur président de la République l’a cru, en toute bonne foi, assure-t-il. Le reste relève de son propre code de l’honneur et de sa conception de l’amitié. « Je ne suis pas un donneur et je répugne à dénoncer un homme qui prétendait me sauver la vie », explique Mitterrand. Dès lors, le piège se refermait sur lui. « Ou j’étais abattu, explique-t-il aux journalistes rassemblés dans la nuit, ou j’en réchappais et je tombais dans cette machination. » Mitterrand a travaillé les détails de sa version de l’histoire. La presse l’écoute et reproduit ses arguments, à défaut de le croire sur parole. (À suivre)
Pour ne rien rater
Revivez le Grand oral des candidats de droite
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR
L'intervention média
Les plus lus de la semaine
LES PLUS LUS DE LA SEMAINE
- Charles-Henri d'Elloy - 15 960 vues










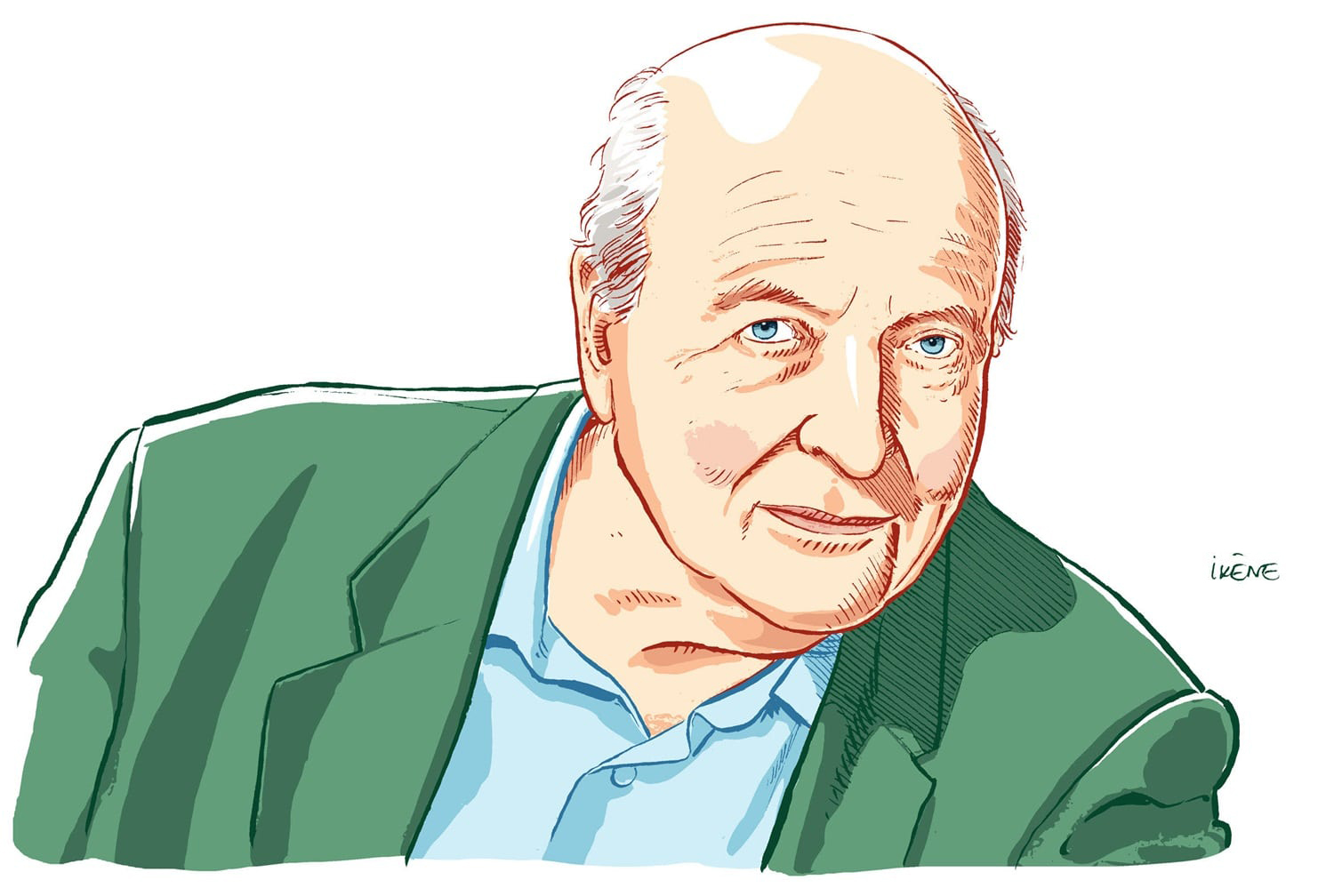









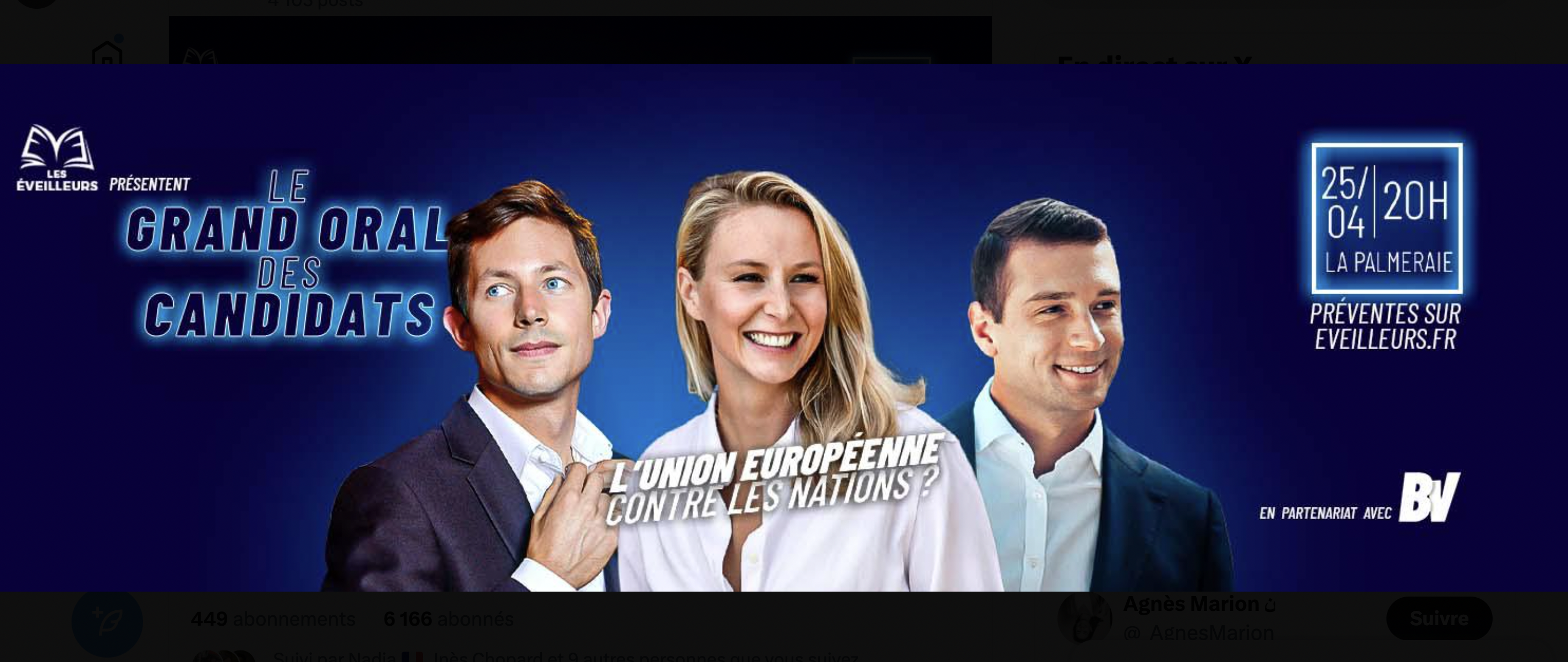







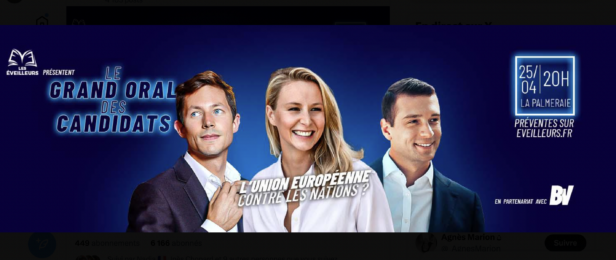





BVoltaire.fr vous offre la possibilité de réagir à ses articles (excepté les brèves) sur une période de 5 jours. Toutefois, nous vous demandons de respecter certaines règles :