À plat ventre devant le commerce
L'Institut de Milan décernait chaque année un prix du mécénat d'entreprise et je venais d'aviser le directeur de la BNP qu'il serait notre lauréat de l'année, afin qu'il nous réserve sa soirée.
Deux jours avant le dîner, l'ambassade me signifia qu'elle souhaitait plutôt distinguer l'entrepreneur François Pinault pour des raisons faciles à résumer : tout le monde en France était à plat ventre devant ce type au sourire de notaire. L'ambassadeur faisait donc comme tout le monde.
Pour ma part, assez mécontent tout de même d'avoir dû arracher cette récompense au banquier que j'avais pressenti pour la recevoir, j'annonçai que le trophée cesserait de s'appeler « Prix de l'Institut français » et je me refusai à tendre en personne la statuette de cristal à ce Pinault qu'on m'avait imposé. De toute façon, il avait fait annoncer dès le début qu'il ne viendrait pas, ce qui simplifia les choses. Il délégua la directrice de sa fondation à qui, le jour venu, en montant sur l'estrade, je précisai que l'ambassadeur me priait de remettre ce trophée, réalisé par Lalique, au nom de l'ambassade de Rome et non du centre culturel de Milan. Elle le brandit devant les photographes d'un geste bref, désinvolte, qui semblait s'excuser de mériter un honneur aussi dérisoire. Elle me le rendit aussitôt en coulisses en disant : "Vous trouverez bien une occasion de m'apporter ce machin à Venise", me prenant pour le laquais que j'étais visiblement devenu.
La France disposait encore, près du Rialto, d'un appartement consulaire où je débarquai quinze jours plus tard. Je déposai la statuette au secrétariat du palazzo Grassi, où je m'étais fait annoncer à Jean-Jacques Aillagon, qui ne me reçut même pas. Il ne reçoit que les gens utiles à sa carrière, comme peuvent l'attester ceux, innombrables, qu'il a rayés de son carnet d'adresses.
Chaque fois qu'une grossièreté de ce genre m'était infligée, je murmurais pratiquement les termes du récit que j'allais en tirer.
En quittant le palazzo Grassi, je jetai un œil consterné sur une sculpture en inox qui faisait pouffer les touristes au bord du Grand Canal, puis je croisai Philippe Sollers, l'araignée de chez Gallimard, précédé par une équipe de la télévision française et qui roulait des yeux à la Malraux dans les ruelles.
Cette rencontre m'inspira de rallumer la guerre picrocholine autour de l'affaire Camus et d'annoncer la visite à Milan de l'écrivain maudit. Dans la grande salle voûtée de l'ambassade de France à Rome, au palais Farnèse où il faisait presque froid même en été, il fallut voir les réactions gênées, apeurées, indignées des autres directeurs de centres culturels que je ne saurais appeler sans déchoir mes collègues. Leur réprobation se manifesta dans un style XXIIIe congrès du Parti communiste. Il s'agissait avant tout de montrer une allégeance hâtive à la coalition des censeurs, des vigilants, des tartuffes contre ce Renaud Camus, écrivain réactionnaire, prétendument antisémite, accusation qui permet de faire trébucher en trois semaines et en toute impunité celui dont on jalouse le talent et qui doit en baver pour payer sa postérité.
L'ambassadeur, affolé, avec sa mine de curé qui vient de rater une marche pendant l'offertoire, me dit : "Euh bon, il faut qu'on en discute."
Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR
- Jean Kast - 2 021 vues
L'intervention média
Les plus lus de la semaine
LES PLUS LUS DE LA SEMAINE
Les plus lus du mois
LES PLUS LUS DU MOIS
- Gabrielle Cluzel - 49 623 vues







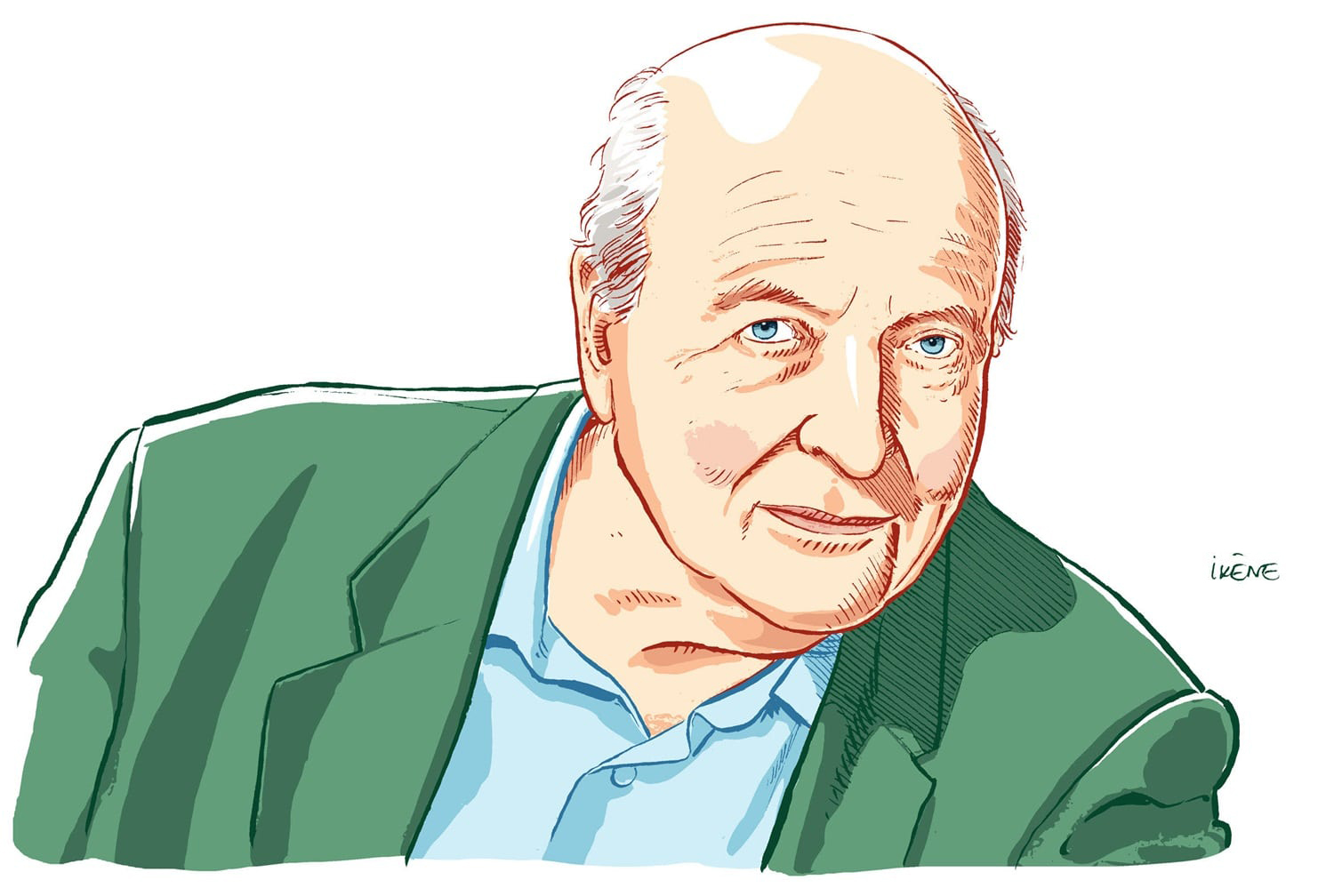





























BVoltaire.fr vous offre la possibilité de réagir à ses articles (excepté les brèves) sur une période de 5 jours. Toutefois, nous vous demandons de respecter certaines règles :