Le véganisme, cette nouvelle secte sans Dieu
Le jour de la Toussaint, tandis que cent mille omnivores criminels s’affairaient à élever leur moitié spirituelle obscurantiste, deux fois treize bobos à la douzaine — une bourriche — montraient aux caméras comment, grâce à leur vie d’air pur et d’eau fraîche, on pourrait réinventer la nature et sauver la mère de Bambi. Mais que venait donc faire RT dans cette galère ?
Le véganisme est l’une des multiples manières dont l’homme moderne fait la bête en voulant faire l’ange. La vogue de l’animal humain incréé, amas d’atomes, simple fruit d’un hasard aux statistiques improbables, a lassé : il y a, dans l’homme, un désir de perfection qui ne pouvait pas se contenter indéfiniment de cet état figé trop en dessous de la condition humaine.
Mais l’homme moderne a été fictivement amputé de son âme : aveugle sur la moitié de lui-même, il tente d’élever son autre moitié désespérément animale avec la radicalité de la purification spirituelle. Aux enfants athées de l’évolution, le véganisme offre une confession hygiéniste, sans Dieu et sans morale, à la misanthropie mal déguisée et aux prétentions universelles.
Cet avatar de l’antispécisme considère l’homme à la fois comme une bête et comme l’oppresseur de toutes les bêtes — en attendant qu’un nouveau philosophe inspiré l’accuse d’entraver la liberté des plantes et des virus. Selon la vision binaire du monde commune aux doctrines issues de la dégénérescence du marxisme, le camp des gentils animaux subit l’esclavage du camp des méchants humains, usurpateurs de leur rang supérieur au sein du règne animal. Comme d’habitude, tout cela se résout par la révolution, rebaptisée libération, qui replace toutes les bêtes à égalité, à ce détail près qu’elle doit être opérée par l’oppresseur lui-même, le prolétariat à quatre pattes y semblant peu disposé.
Sans craindre la contradiction, le véganisme enjoint l’espèce humaine à se retrancher de la vie animale en quittant sa place d’omnivore dans la chaîne alimentaire, sans en attendre autant de la poule, qui continuera à picorer les vers de terre en toute quiétude. C’est parce que l’espèce humaine est égale et rien qu’égale à toute espèce animale qu’il lui est paradoxalement proscrit de satisfaire aux exigences de la nature qui n’a pas voulu que l’homme fût herbivore.
Il serait intéressant de savoir quelle proportion des nouveaux défenseurs du bifteck outragé vit à la campagne — la profonde campagne rurale, pas la cité-dortoir blottie entre les champs par pur hasard géographique. On aimerait connaître leur sentiment sur la souffrance du mâle vaincu en combat singulier par un mâle dominant, sur celle de la proie qui subit la dure loi de la sélection naturelle en satisfaisant l’appétit du prédateur ou sur le désarroi des géniteurs dont les petits servent d’amuse-gueule au maraudeur gourmand. Va-t-on ouvrir des cellules psychologiques pour assister les oiseaux dont les serpents ont gobé les œufs ?
L’argument sentimental de la souffrance animale souffre de l’escroquerie intellectuelle qui veut faire de chaque cas particulier effroyable l’exemple de la généralité, et qui ne daigne pas même se pencher sur les conditions de la vie naturelle.
Notons que l’homme, oppresseur - et oppresseur seulement -, conserve parfaitement le droit d’offrir son corps en sacrifice au tigre et à l’alligator : l’animal humain peut souffrir, lui. À la limite, ce pourrait être une marque de la plus grande dévotion pour cette nouvelle secte que de s’enchaîner dans les montagnes pour sauver, par l’oblation de sa vie, celle d’un mouton innocent. Une vie en vaut bien une autre, n’est-ce pas tout le fond de leurs campagnes choc ?
Thématiques :
VéganismePour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR
Un vert manteau de mosquées












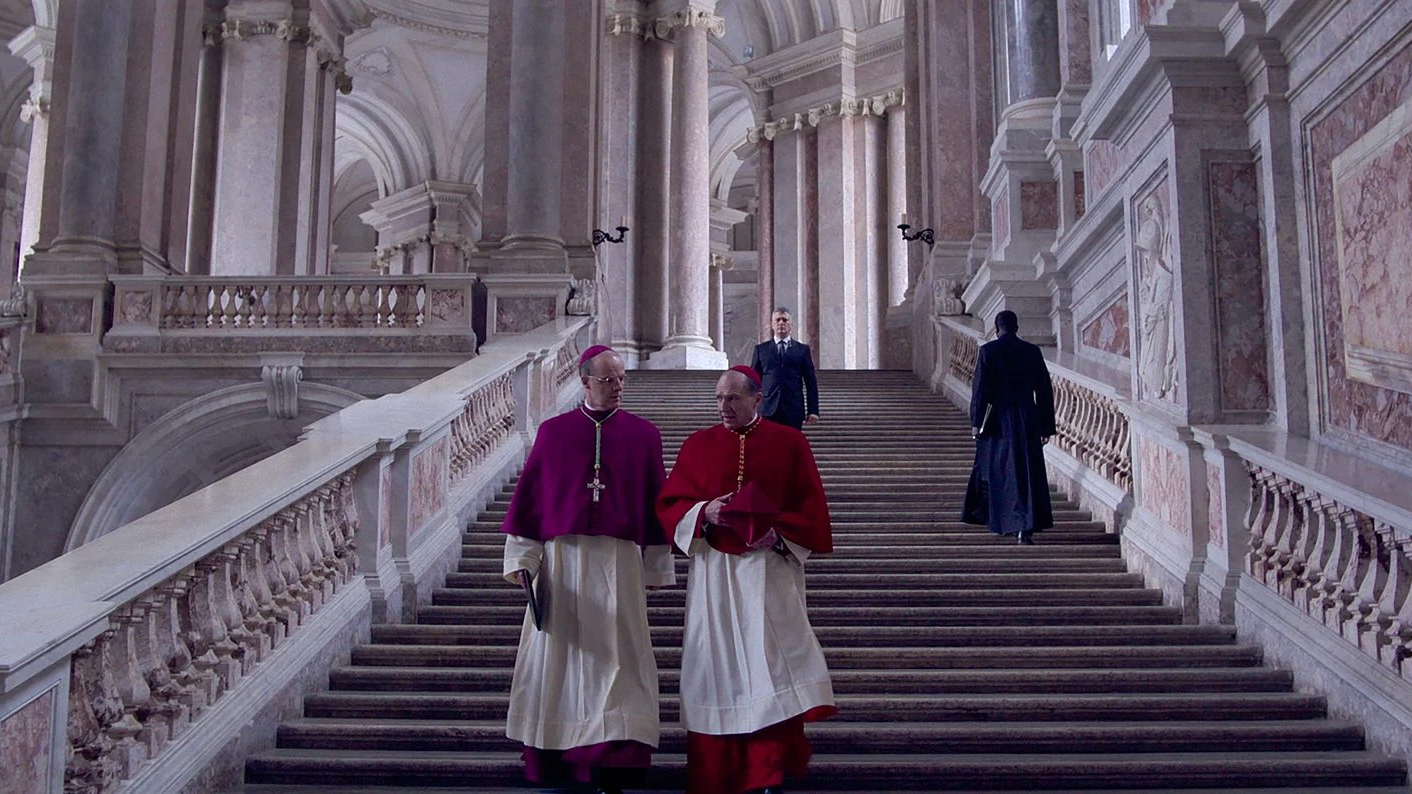























BVoltaire.fr vous offre la possibilité de réagir à ses articles (excepté les brèves) sur une période de 5 jours. Toutefois, nous vous demandons de respecter certaines règles :