François-Xavier Bellamy : « Il y a un ressentiment des élites contre le peuple »
À l'occasion la publication de son livre Demeure, le philosophe François-Xavier Bellamy revient, pour Boulevard Voltaire, sur le débat entre le mouvement et l'enracinement dans la société occidentale.
Il y explore l'idéologie du mouvement et du changement, source de déstabilisation et de perte de sens pour l'homme.
Vous sortez aux Éditions Grasset un livre intitulé Demeure.
C’est presque l’inverse, point par point, du mouvement En Marche…
Peut-on à la fois demeurer et être En marche ?
Il me semble qu’En Marche a été sans doute le symptôme d’une fascination collective qui dépassait de très loin l’apparition de ce mouvement. On ne dit d’ailleurs plus ‘’parti’’ mais ‘’mouvement’’, parce que toute notre vie collective, et en particulier notre vie politique, s’est montrée fascinée par la question du mouvement.
Au-delà de la politique, c’est aussi la technique dont le maître mot est l’innovation, c’est l’économie dont le but est la circulation, et ce sont évidemment toutes les questions qui touchent aux changements qui se jouent dans nos propres corps, dans notre propre condition humaine à travers les grandes questions de bioéthique qui se présentent à nous.
Le changement est devenu une fin et un but en soi. Le mouvement est devenu un objectif. C’est la raison pour laquelle toute notre vie politique, depuis quelques décennies, a été traversée par cette obsession du changement.
Mon propos n’est pas de dire qu’il ne faut pas changer, mais que changer pour changer ne peut pas être un but en soi. Le changement trouve son sens lorsqu’il se dirige vers quelque chose qui demeure, vers ses points fixes et ses points de repère qui sont pour nous quelque chose qui se transmet, une culture, un héritage. C’est ce que j’avais essayé d’évoquer dans Les déshérités.
Le changement trouve son sens lorsqu’il se donne des objectifs intangibles. La politique, par exemple, ne peut pas chercher à être en marche pour être en marche. Ce serait faire perdre son sens à la marche. Mais, elle doit marcher et nous permettre d’avancer vers ce qui est bon et juste. C’est l’objet de notre recherche et c’est un objet de toujours.
Ces problématiques ne sont pas propres à notre époque. Vous partez dans votre livre du débat entre Parmenide et Héraclite pour arriver à notre époque.
Ce débat entre le mouvement et le fait de demeurer et de s’enraciner a-t-il toujours existé ?
C’est un débat de toujours dans la civilisation occidentale. On pourrait dire que le monde occidental est né avec la question du changement. En revanche, elle constitue à notre époque l’aboutissement de ce qu’on appelle en Histoire la modernité. Et c’est cela qui est tout à fait singulier.
La modernité est cette période qui commence avec la Révolution Copérnicienne et la Révolution scientifique. Elle est d’abord une fascination pour le mouvement. La modernité est la fascination pour le modo, le maintenant. C’est également la certitude que la mode doit être ce qui dicte nos comportements. Ce qui est à la mode est bon, parce que c’est récent. La mode en tant que phénomène vestimentaire n’est pas d’une grande importance. En revanche, quand toute notre vie collective est régie par la mode, quand notre vie intellectuelle, philosophique, politique et quand toutes nos existences sont gouvernées par le fait qu’il faille être dans le vent et changer, alors c’est peut-être le sens même de notre action collective qui se perd.
La modernité a mis du temps avant de s’accomplir et à se déployer jusque dans ses dernières conséquences. Mais il me semble qu’aujourd’hui, depuis la fin des grandes idéologies et de la chute du mur de Berlin, nous voulons toujours tout changer sans avoir du tout d’idée de ce vers quoi nous voulons nous diriger. Quand on était marxistes, on voulait tout changer et faire la Révolution, mais on voulait que la lutte finale nous fasse entrer dans le grand soir, dans la société sans classe. C’était alors la fin de l’Histoire et des péripéties de l’aventure humaine.
Depuis que les grandes idéologies se sont effondrées, nous sommes d’une certaine manière dépourvus de but. Notre agitation est devenue visible dans cette espèce de vide intérieur qu’elle provoque par le fait qu’elle ne nous dirige plus vers quelque chose qui vaille la peine, en soi, d’être atteint et qui puisse constituer le lieu où nous pourrons habiter, où nous pourrons demeurer.
On ne croit plus aux lendemains qui chantent, donc on a cru en quelqu’un qui nous a proposé de penser printemps...
Dans tous ces mots, il y a quelque chose de très frappant. Ils témoignent de ce vide, de cette vacuité. Toutes ses injonctions à la ‘’disruption’’ et à ‘’l’innovation’’. L’idée de la start-up nation qui est, au fond, le contraire de l’idéal de l’État. Le propre de l’État, stat, est d’être celui qui demeure.
Comme le dit Louis XIV au moment de mourir : « je m’en vais, mais l’État demeurera toujours ». L’État demeure et la continuité de l’État fait sa force.
Au contraire, la start-up est celle qui revendique qu’elle vient tout juste de commencer.
Entre le monde du start et le monde du stat, entre le monde qui veut toujours changer et le monde qui sait ce qui mérite d’être préservé, il faut que nous soyons capables de faire un choix.
Il y a une nécessité à retrouver les points fixes qui nous lient les uns aux autres. C’est cela qui pourra redonner son sens à l’activité politique.
Cela fait un mois que le mouvement des gilets jaunes a commencé. On les présente comme ceux de la France périphérique, comme les grands perdants de la mondialisation ou comme ceux qui n’ont pas voulu être ‘’en marche’’ et ont préféré l’enracinement. Ils demandent d’exister là où ils sont et ne pas être qu’une variable d’ajustement.
Est-ce que ce mouvement des gilets jaunes est une réponse à cette vague en marche ?
C’est en tout cas le mouvement auquel notre vie politique doit pouvoir apporter une réponse. Cette réaction éruptive peut paraître parfois incohérente ou inarticulée. En réalité, elle exprime comme une forme de symptôme, cet épuisement que nous vivons collectivement.
Ce sont précisément ces Français à qui on a demandé de tout changer, d’être agile et de s’adapter. Ce sont les ‘’somewhere’’, selon l’expression de l’essayiste et politologue anglais David Goodhart, ceux qui sont de quelque part. Ils ont le sentiment que ce ''quelque part'' dans lequel ils veulent habiter est en train d’être progressivement dévitalisé par une mondialisation faite de flux aveugles à laquelle ils sont sommés de s’adapter en permanence.
On leur a d’une certaine manière retiré tous ces attachements singuliers qui leur permettaient de se rapporter au monde qui les entourait. C’est l’une des clés de cette crise de la démocratie représentative que nous sommes en train de vivre.
Je suis frappé, du fait de mes racines familiales, par la forme de violence qui existe dans les fusions de communes. D’un seul coup, vous découvrez que vous êtes habitant d’une ville dont vous ne connaissez même pas le nom et dont le maire est loin de vous. On a mis en mouvement leur monde familier et on a tout transformé autour d’eux. Ils se sentent donc désormais dépossédés de leur propre existence et de leurs propres conditions d’existence.
À l’inverse de la figure du manant dont parle Olivier Rey, manere, celui qui reste, celui qu’on méprise parce qu’il demeure et considéré par nos élites un peu comme un demeuré, il y a la figure de la circulation universelle. Ce que nous avons vu dans le débat récent autour de la question des migrations. Une autre violence s’opère envers ceux qu’on appelle des ‘’migrants’’. Comme si les êtres humains pouvaient être des migrants. J’essaie de dire dans Demeure qu’il n’y a pas de migrants, il n’y a que des immigrants ou des émigrants, c’est-à-dire des gens arrachés à leur univers familier et qui arrivent vers un ailleurs. Aucun être humain n’a pour condition d’être en déplacement. Aucun être humain n’est, par définition ou par constitution, un migrant.
On nous avait vendu dans les années 80 la consommation heureuse, puis, dans les années 90, la mondialisation heureuse. Et aujourd’hui, on nous vend la migration heureuse comme si devenir un migrant deviendrait presque une sorte de norme…
On a voulu faire comme si on pouvait définir l’Homme comme étant ontologiquement un migrant, un être de circulation.
Je ne crois pas que nous sommes des êtres de circulation. Nos voyages dans l’espace sont toujours polarisés par des lieux qui ne nous sont pas du tout indifférents. On part de chez soi pour arriver ailleurs. On repart de cet ailleurs pour revenir chez soi. C’est ce qui fait notre rapport au monde. Nous ne sommes pas des atomes qui circulent dans un espace géométrique neutre et indifférencié. De ce point de vue là, il y a évidemment une forme de violence singulière dans le fait de croire que ‘’les migrations sont une chance’’. Je cite le titre d’une grande manchette du Monde d’il y a quelques mois. C’est assez incroyable. Derrière une migration, il y a toujours une forme d’arrachement à cet univers familier. On peut connaître l’expatriation temporaire, le voyage d’études ou le séjour touristique. En revanche, ce qu’on appelle la migration, c’est toujours l’arrachement. Ça ne peut être rien d’autre que cette manière de retirer quelqu’un au monde dans lequel il demeurait, soit parce qu’il en est chassé par la guerre ou par la violence, soit parce qu’il est attiré par l’intensité du mirage que nos pays peuvent leur tendre.
On l’a vu récemment, à l’occasion d’enquêtes sur les filières de passeurs. Il y a évidemment un processus d’arrachement et de la violence, y compris par le mensonge dont nous sommes souvent complices hélas, à travers ce que nous appelons l’accueil.
Je regrette profondément que le pacte de Marrakech ait été signé et, de surcroît, sans aucun débat ou discussion, comme si c’était une évidence. Ce pacte défend lui aussi cette vision totalement irénique et parfaitement inexacte d’une migration qui serait sûre, tranquille et régulière. En réalité, derrière cette expérience d’une migration, lorsqu’elle est forcée, il y a toujours une violence faite à ce premier besoin de l’Homme qu’est ce besoin d’enracinement dont on parlait.
On parle souvent de la défiance, voire de la haine du peuple vis-à-vis des élites. En revanche, on parle peu de la vision que les élites ont du peuple.
S’agit-il d’incompréhension ou du ressentiment ?
Comment les élites politiques, philosophiques et intellectuelles considèrent-elles cette France périphérique qui se sent aujourd’hui à l’abandon ?
On parle souvent du populisme comme d’un ressentiment du peuple à l’égard de ceux qui le dirigent. Il me semble qu’il y a souvent aussi une sorte de ressentiment de ceux qui nous gouvernent et aussi de ceux qu’on appelle les élites à l’égard du peuple.
Raphaël Glucksmann disait récemment sur le plateau d’ARTE, « moi qui suis un intellectuel parisien, je me sens plus proche d’un membre de l’élite intellectuelle, politique et économique berlinoise ou new-yorkaise que d’un habitant français et d’un concitoyen qui vivrait au bout d’une ligne de RER ».
Cette déclaration lui a été ouvertement reprochée. Pour ma part, je la trouve très touchante dans sa sincérité. Je pense qu’elle fait partie du malheur français. Nous ne sommes plus proches les uns des autres. À l’occasion des dernières élections présidentielles, on l’a déjà vu. Nous n’avons jamais autant voté de manière déterminée selon notre appartenance à tel ou tel milieu social.
Or, la politique ne consiste pas à défendre ses intérêts, mais plutôt à chercher ensemble ce qui est bon et juste. Elle devrait être l’occasion de confronter des visions du monde qui sont peut-être légitimes, mais aussi de réunir des gens qui viennent de milieux très différents et qui ont des intuitions variées sur ce qu’il faudrait faire pour l’avenir.
Cette confrontation qui est en train de se jouer n’est pas seulement la révolte du peuple, mais c’est aussi une forme de révolte des élites contre le peuple.
On a déconstruit et critiqué vertement l’idée même de frontière, mais on n’a jamais autant construit de frontières et de barrières. On n’a jamais rendu à ce point difficile la mobilité à l’intérieur d’un espace qui pourtant nous appartient tous.
La France périphérique est une réalité très concrète. C’est l’éloignement très matériel, la fermeture des petites lignes de train, la disparition progressive de réseaux qui permettaient justement cette circulation. C’est aussi l’idée qui avait été très sérieusement évoquée, heureusement abandonnée maintenant grâce à la révolte des gilets jaunes, des péages urbains qui étaient défendue par madame Hidalgo pour financer les transports gratuits à l’intérieur de Paris.
On a là une expression magnifique de ce que Christopher Lasch appelle ‘’la sécession des élites’’.
Il faut vraiment que nous parvenions à réussir une véritable réconciliation qui ne soit évidemment pas l’occasion de taire les divergences, au contraire. Derrière le macronisme, il y avait sans doute l’idée que c’était la fin des clivages. Je n’ai jamais cru à cette illusion. La politique suppose le pluralisme et la confrontation d’idées. Mais cette confrontation d’idées n’est pas et ne devrait jamais être une confrontation ni de catégories sociales ni de classes sociales. Au contraire, ce devrait être l’occasion d’échanger sur ce que nous voulons pour l’avenir et sur ce qui nous semble juste. C’est dans cette reconstruction du débat démocratique que nous pourrons certainement trouver l’occasion de dépasser cette confrontation sociale et cette opposition des élites avec les classes populaires.
Emmanuel Macron avait incarné cet espoir-là en cassant la dynamique des élites contre le peuple, en ouvrant la République En Marche à des gens issus de la société civile et à de nouvelles têtes. Un grand remplacement de politiques a été fait. C’est ce que les citoyens français voulaient. Pourtant, on s’aperçoit aujourd’hui que la République En Marche est tombée dans les travers qu’elle reprochait il y a quelques années et que rien n’a changé malgré le renouvellement des cadres. Le vieux monde reste le vieux monde…
Il y a une forme d’illusion dans l’idée d’opposer un Ancien Monde et un Nouveau Monde. Il faut faire avec la réalité de l’expérience humaine. Il n’y a qu’un seul monde.
La politique ne consiste pas, pour reprendre votre expression, à remplacer un Ancien Monde par un nouveau. Elle consiste plutôt à prendre humblement soin de ce monde qui est le seul monde réel et faire en sorte que demeure en lui ce qui le rend vivable et que s’améliore en lui ce qui mérite de progresser. C’est la seule chose qui compte.
Ce qui me frappe profondément concernant cette vie parlementaire, c’est qu’il y a eu une gigantesque illusion. La violence de la réaction est à la hauteur de la réalité de la duperie. Les gens croyaient qu’Emmanuel Macron allait être celui qui incarnerait une démocratie participative, rendrait la parole aux Français et remettrait la décision sur le terrain. Mais en réalité, nous n’avons jamais eu un président aussi jacobin, aussi centralisateur et technocrate dans sa manière de se comporter. En tant qu’élus locaux, nous voyons à quel point la subsidiarité a disparu de toute perspective dans la politique du gouvernement. Les élus locaux ont été méprisés et oubliés. Il ne faut évidemment pas s’en indigner pour eux, mais pour leurs électeurs.
Il y a donc évidemment une forme de déception considérable devant cette fausse promesse du Nouveau Monde qui se voulait un moment démocratique, singulièrement rénové et qui, en fait, n’a été que l’occasion d’une caricature de plus en plus avancée des pires travers de notre système politique.
Cette espèce de centralisation fait que tout est à disposition d’un homme qui peut retenir sa décision pendant des mois, et ensuite lâcher un milliard par minute au cours d’une allocution télévisée, alors que tout va dans le désordre et sans que le Parlement ait la moindre existence réelle.
Nous sommes à une période de la Ve République qui voit la disparition totale de la vie parlementaire, à l’exception du Sénat qui constitue encore un pôle d’indépendance. L’Assemblée nationale a, elle, littéralement disparu des écrans radars dans son efficacité. Malgré les efforts de toutes les oppositions, en réalité, elle est animée par une forme de discipline plus caricaturale que jamais. On parle du referendum d’initiative citoyenne, mais on a aussi devant nous le sujet des institutions qui est tout aussi majeur.
Il nous faut savoir comment nos institutions peuvent redevenir l’occasion d’une vraie représentation. Sans représentation, aucune démocratie n’est possible. Nous en avons besoin. C’est sans doute ce qu’il faut travailler à repenser pour la démocratie qui vient.
Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR
Un vert manteau de mosquées




















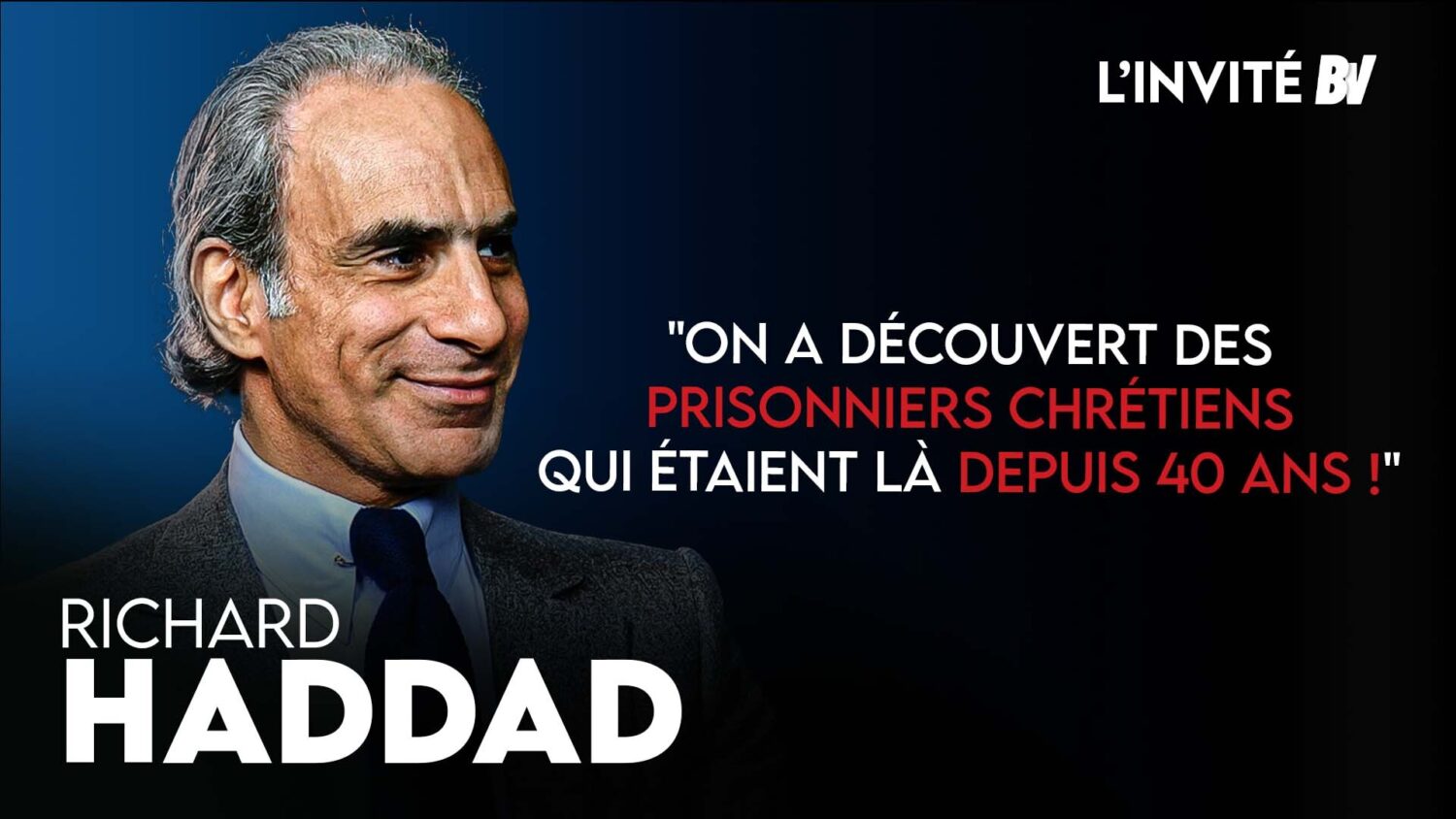


















BVoltaire.fr vous offre la possibilité de réagir à ses articles (excepté les brèves) sur une période de 5 jours. Toutefois, nous vous demandons de respecter certaines règles :