Le 1er mai : de l’amour courtois à la lutte des classes

Chaque printemps, le 1er mai voit refleurir une tradition bien française : les rues se garnissent de brins de muguet, les cortèges syndicaux s’ébranlent et les discours politiques se succèdent dans une ambiance revendicative. Officiellement, c’est la fête du Travail, mais lorsque l’on gratte un peu sous les slogans, on découvre que cette date ne fut pas toujours consacrée aux luttes sociales. Jadis, en effet, le 1er mai était une fête presque religieuse célébrant l’amour, le renouveau et la nature sous le regard bienveillant de Dieu. L'Église célèbre, ce jour, saint Joseph, rappelant ainsi la mémoire de cet humble charpentier. Sa transformation en fête purement laïque et politisée est le fruit d’une histoire longue et révélatrice du combat idéologique dont seule la gauche a le secret : prompte à vouloir effacer les jours fériés d’inspiration chrétienne, elle se montre beaucoup plus indulgente à l’égard de ses propres commémorations, qu’elle juge pourtant tout aussi sacrées que les festivités religieuses.
Le mai amoureux
Avant d’être le jour des banderoles, le 1er mai fut celui des bouquets. En effet, dans l’Europe médiévale et moderne, cette date marquait la célébration du printemps renaissant. La tradition des « mais » consistait alors à planter de jeunes arbres devant les maisons, notamment celles des jeunes filles courtisées, en gage d’amour. Ce jour était aussi l’occasion de festivités populaires dédiées à la fécondité et à la nature. Le 1er mai était également une fête de l’amour, que louaient notamment Jean Ier de Berry de façon courtoises dans ses Très Riches Heures ou encore Charles Ier d’Orléans dans ses ballades :
« Le Dieu d'Amour est coutumier,
À ce jour, de fête tenir,
Pour amoureux cœurs fêter
Qui désirent de le servir ;
Pour ce fait, les arbres couvrir
De fleurs et les champs de vert gai,
Pour la fête plus embellir,
Ce premier jour du mois de mai »
En 1561, le roi Charles IX popularisa l’usage du muguet comme porte-bonheur : après avoir reçu un brin de cette fleur, il en offrit à son tour aux dames de la cour, lançant une tradition qui, étonnamment, survit encore aujourd’hui malgré les orages révolutionnaires du passé.
Une commémoration de la lutte ouvrière
Tout change avec la modernité. Le XIXe siècle, celui de la machine et de l’ouvrier, remodèle et bouleverse le calendrier. Aux réjouissances champêtres succèdent ainsi les manifestations revendicatives. Ainsi, l’origine directe de la fête du Travail remonte aux États-Unis. Le 1er mai 1886, à Chicago, une grève générale est lancée pour obtenir la journée de huit heures, mais doit subir une répression sanglante qui transforme cette date en symbole international de la lutte ouvrière.
En France, ce sont les socialistes de la IIe Internationale qui, en 1889, décident de faire du 1er mai une journée d’action mondiale. Deux ans plus tard, en 1891, la mort de plusieurs militants lors de manifestations à Fourmies, dans le Nord, donne à cette journée une portée dramatique et politique. Dès lors, le 1er mai devient une fête syndicale, marquée par la lutte des classes, l’opposition au capitalisme, à la hiérarchie et même à l’ordre traditionnel.
1er-Mai: des tensions entre forces de l'ordre et manifestants éclatent à Nantes pic.twitter.com/7QZqbzD2uA
— BFMTV (@BFMTV) May 1, 2025
Une fête républicaine sous influence
Fait surprenant, il faut attendre 1941 pour que le régime de Vichy donne au 1er mai un statut officiel de jour férié. Il est alors renommé « fête du Travail et de la Concorde sociale », une ironie pour une célébration née dans la contestation, mais révélatrice du souci du régime de récupérer aux communistes la cause ouvrière et de l’intégrer à une rhétorique d’unité nationale.
Après la Libération, la IVe République conserve cette date et, en 1947, elle devient définitivement un jour férié et payé. Depuis, la fête du Travail est solidement ancrée dans le calendrier républicain. Pourtant, sa teinte militante subsiste. Elle est le théâtre de rassemblements syndicaux, de tribunes politiques marquées à gauche et d’un certain folklore révolutionnaire. Le muguet y survit, vestige anachronique d’une époque oubliée où l’on célébrait l’amour de l’autre plutôt que la lutte contre l’autre. Ce glissement progressif d’une fête poétique à une journée de revendications traduit ainsi une volonté idéologique d’effacer certaines racines culturelles de la France tout en érigeant d’autres références de gauche en dogmes intouchables voire sacrés.

Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR



















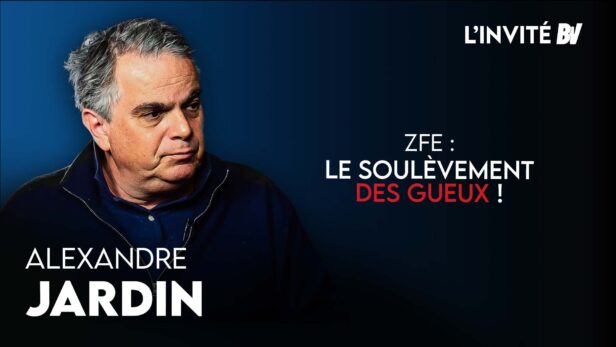





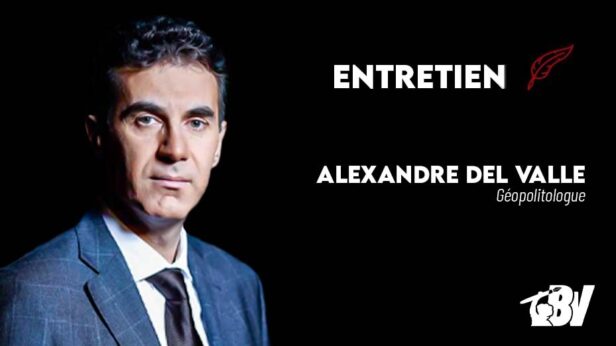

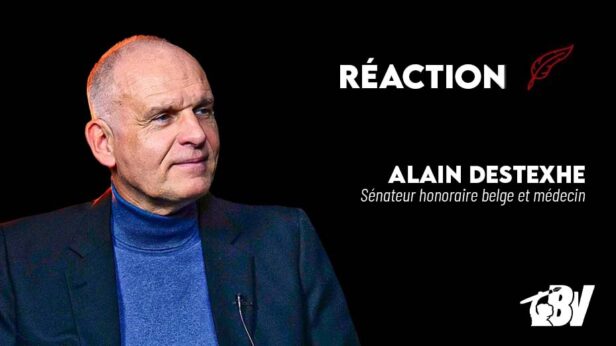
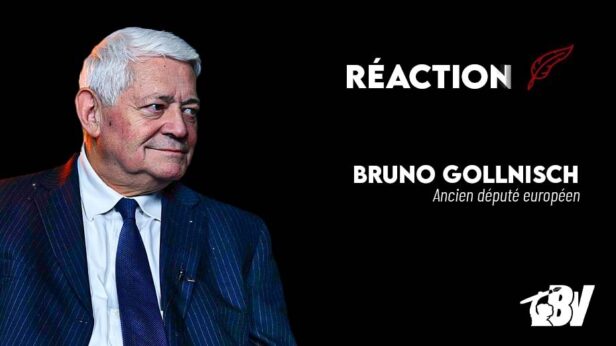






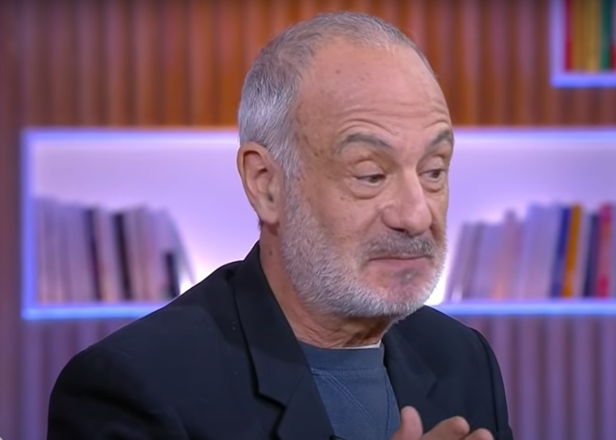

16 commentaires
Aujourd’hui la lutte n’est plus contre le capitalisme. Si vous observez le cortège parisien, vous verrez des drapeaux de tous les groupuscules d’extrême gauche, des syndicats et une multitude de drapeaux étrangers : turques, algeriens, palestinuens, etc. Il y a un énorme changement.
» Le XIXe siècle, celui de la machine et de l’ouvrier, remodèle et bouleverse le calendrier. » Le XIXe siècle est surtout celui du marxisme triomphant et indifférent à toute leçon de l’Histoire.
Et en 2025, on pratique un antisémitisme « décomplexé » contre Jérôme Guedj…bientôt une tradition de plus ?
J’ai entendu le discours de ce brave Melenchon hier, qui crachait tant qu’il pouvait sur les patrons… (ces salauds de patrons). Le problème, c’est que pour que les travailleurs trouvent un emploi il faut qu’il y ait des entreprise qui leur en offrent. Et pour qu’il y ait de ces entreprises, il faut qu’un jour un de ces salauds (qui n’était pas encore patron) ait été assez courageux et intelligent (ce qui n’est pas donné à tout le monde) pour prendre des risques et poser les bases afin de créer ce qui deviendra une entreprise. Il faut ensuite qu’il la gère et qu’il sache prendre les bonnes décisions qui vont la faire se développer et ainsi créer les emplois qui vont permettre aux travailleurs de travailler et de gagner leur vie. S’il n’y avait pas de patrons pour créer des entreprises, il n’y aurait pas de travailleurs. Par contre, un patron « qui en veut » peut toujours aller créer une boîte ailleurs où les gens veulent bien bosser… Si Pinault, Arnaud, Michelin, et même Bolloré, décidaient de transférer leurs affaires ailleurs, ils feraient quoi, les travailleurs Français ? Bien sûr qu’il y a parfois des abus contre lesquels les syndicats doivent lutter. Mais en suivant ceux qui leur disent de tirer à vue sur tous les « patrons », ils se tirent une balle dans le pied.
Merci à ceux qui offrent l’emploi. Mais s’il faut travailler plus, il faut plus de travail: 3 millions de chômeurs de catégorie A, 5 millions si l’on ajoute les catégories BetC. Sont ils réellement responsables du chômage comme certains osent insinuer?
Demandez aux patrons combien ils payent de charges sociales. Injustifiées pour la plupart.
Les Gaulois avaient une grande fête le 1er mai, Beltaine. C’était la fête du Printemps.
Le petit problème, c’est qu’au temps des Gaulois, le mois de mai n’existait pas et et le premier mai encore moins. Beltaine, sans doute mais, ça pouvait aussi bien se situer fin, mars (équinoxe vernal) courant avril et, pourquoi pas, début mai. Mais peut-etre que les Gaulois fêtaient aussi la Toussaint le 1er novembre…
Quoi sa plus naturel : les colons nous submergent avec la complicité du Président et ses troupes. Il faut stopper la colonisation de la France voulue par le couple Melenchon-Macron.
Merci pour ces rappels historiques dont j’avoue que j’ignorais certains ….Belle démonstration.
Intéressant
Le phénomène de décalque anthropologique dont vous vous étonnez est universel et transhistorique. C’est la marche, naturellement politique, d’une civilisation qui troque ses vieux oripeaux pour des neufs. Pour que tout change, il faut que rien ne change mais nous faisons tous chorus ensemble. Babylone. Athènes. Jérusalem. Rome. Paris.
Les constitutions républlicaines sont filles du décalogue, lui-même ayant emprunté à Akkad et Summer. La République laïque a puisé plus qu’abondamment dans la Bible, en plagiaire substitutif. C’est en somme un déguisement phénoménologique si vous voulez. Otez le masque de la République et vous verrez pointer le nez de l’Eternel. La trilogie maçonnique n’est rien d’autre que le triangle de la Trinité. Ne déplorez pas que le muguet du roi soit brandi par des mains rouges en place publique, il reste le muguet et l’Espérance. C’est un athée qui vous parle. Et comme le confiait si bien François Mitterrand au peuple de France, Mitterrand, qui priait chaque soir à genoux au pied de son lit ( rapporté par Marie de Hennezel) : « Je crois aux forces de l’Esprit. »
Pouvons nous disposer d’une traduction ?
Non, vous n’en avez pas besoin, j’en suis certain
» L’idée que l’ordre et la précision de l’univers, dans ses aspects innombrables, seraient le résultat d’un hasard aveugle est aussi peu crédible que si, après l’explosion d’une imprimerie, tous les caractères retombaient par terre dans l’ordre d’un dictionnaire. »… Albert Einstein.
Les scientifiques nous disent aujourd’hui que le monde n’a pas « été CRÉÉ en 6 jours », mais qu’il est le résultat d’une gigantesque explosion qui s’est produite il y a 13 ou 15 milliards d’années : le Big Bang.
D’accord ! MAIS QUI A ALLUMÉ LA MECHE ?
» Dieu a CRÉÉ l’homme et, pour le remercier, l’Homme à INVENTÉ Dieu… ». (Deluc, je crois)
Ne vendez pas la mèche, vous qui êtes dans les secrets des dieux. Et comme un Bing bang en appelle toujours d’autres, prévenez-moi et que Dieu vous protège.