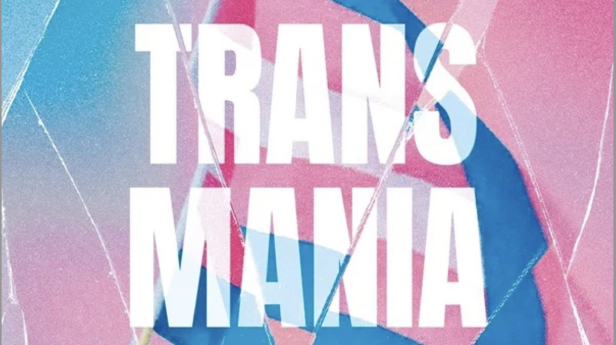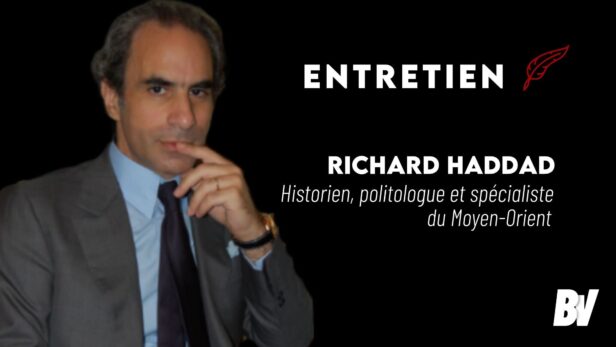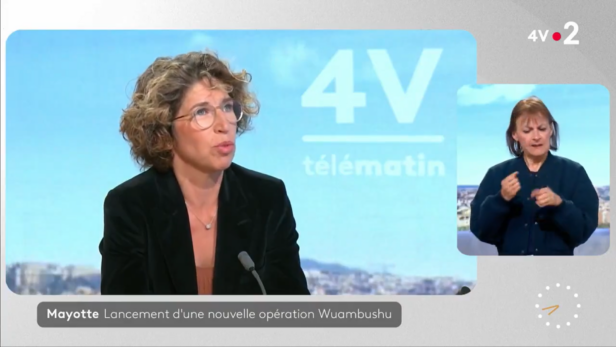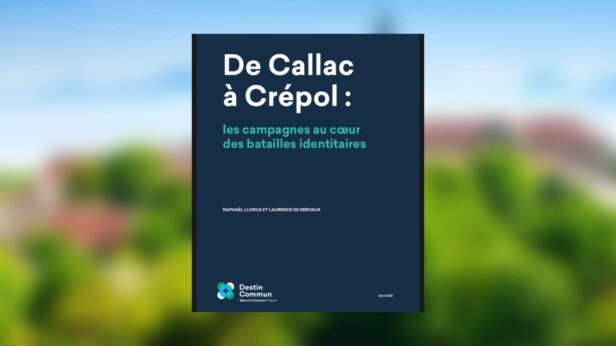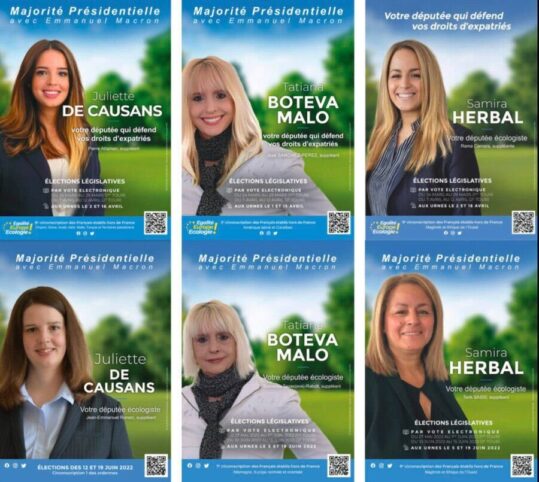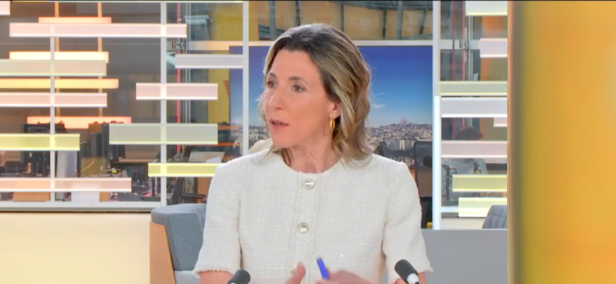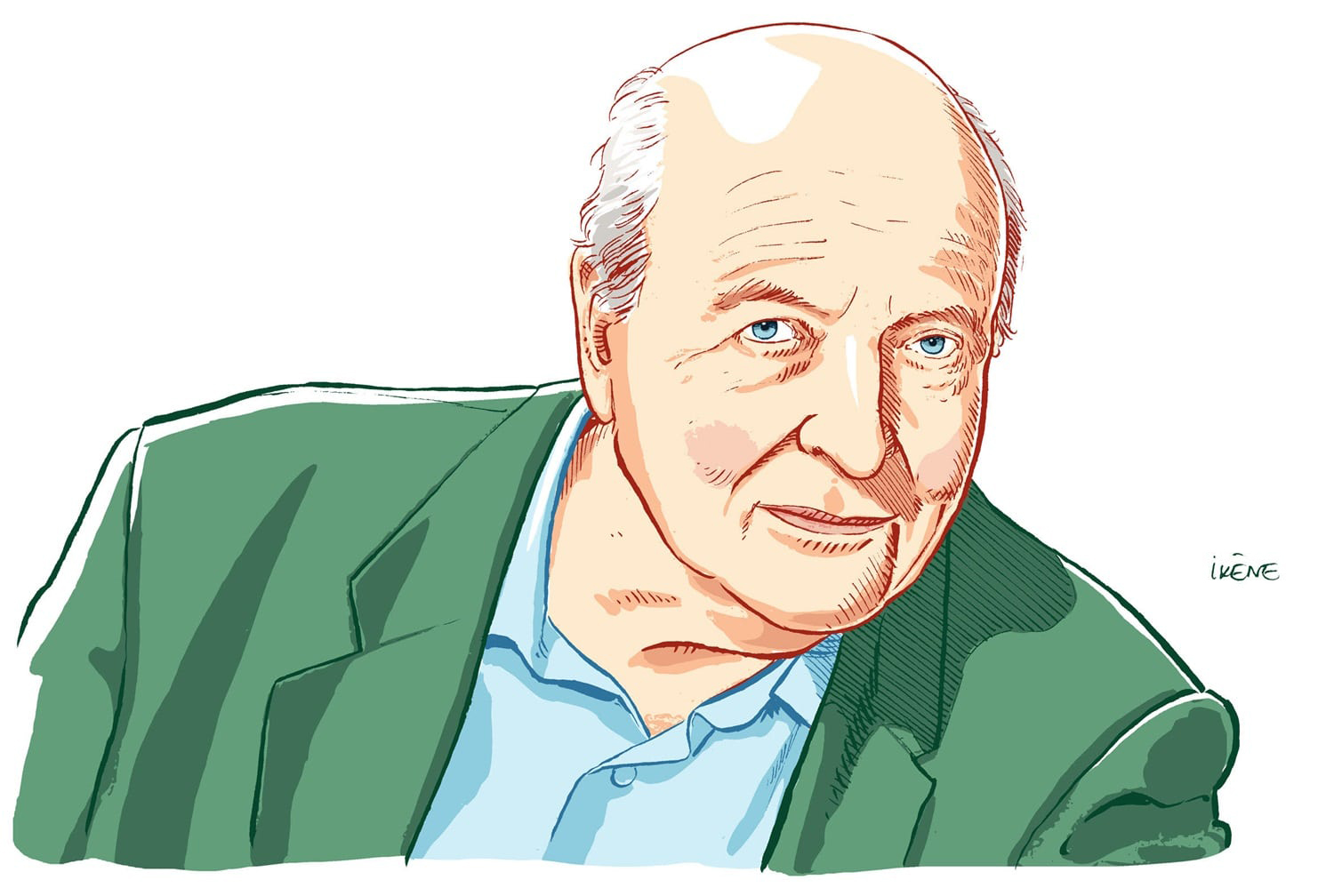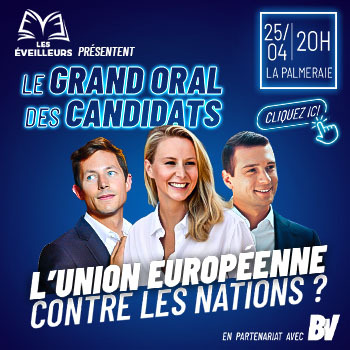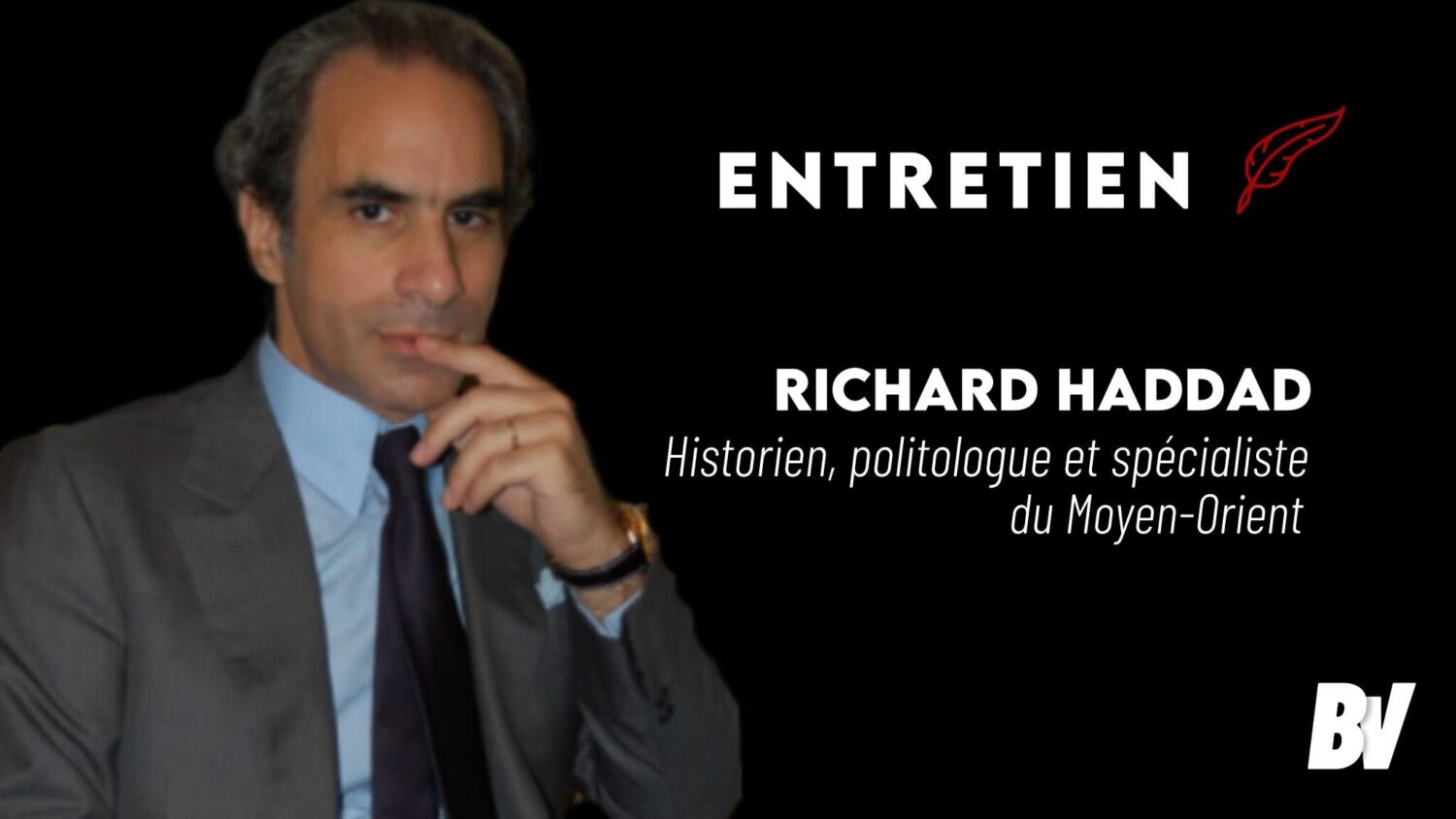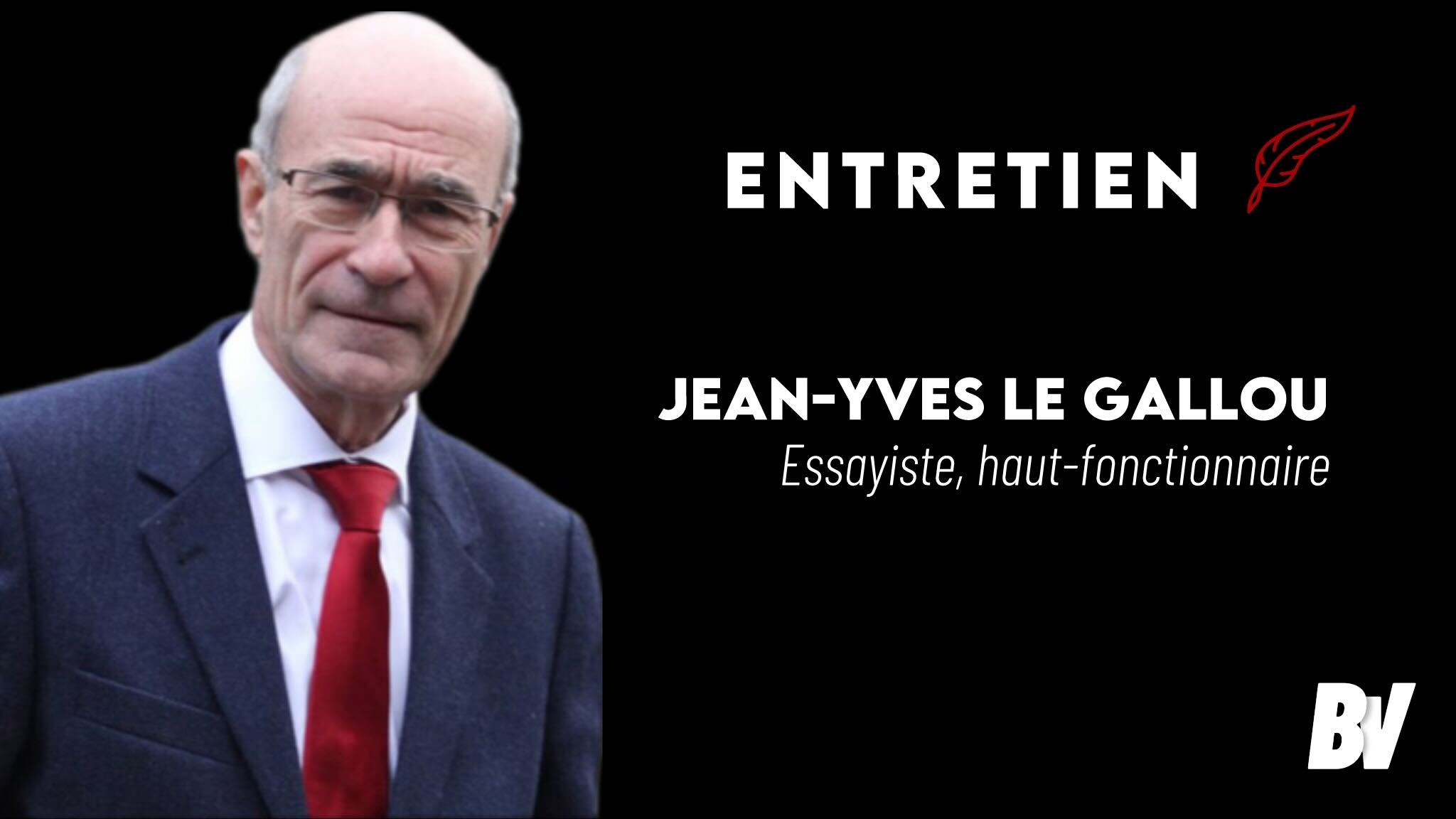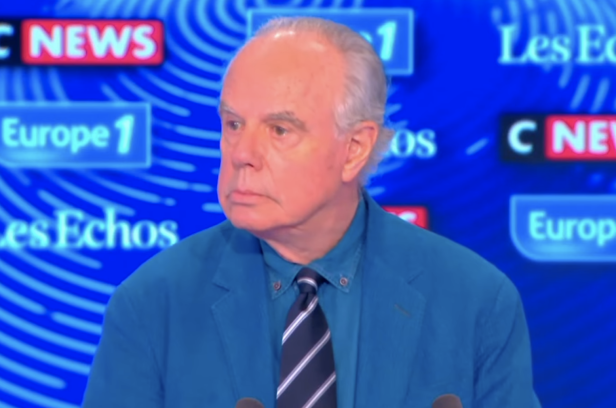Le procès en amateurisme, perpétuellement instruit vis-à-vis du RN, n’en finit plus de prendre du plomb dans l'aile
LES TOUT DERNIERS ARTICLES
L'ACTUALITÉ
Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR
L'intervention média
Les plus lus de la semaine
LES PLUS LUS DE LA SEMAINE
Les plus lus du mois
LES PLUS LUS DU MOIS
- Gabrielle Cluzel - 49 477 vues