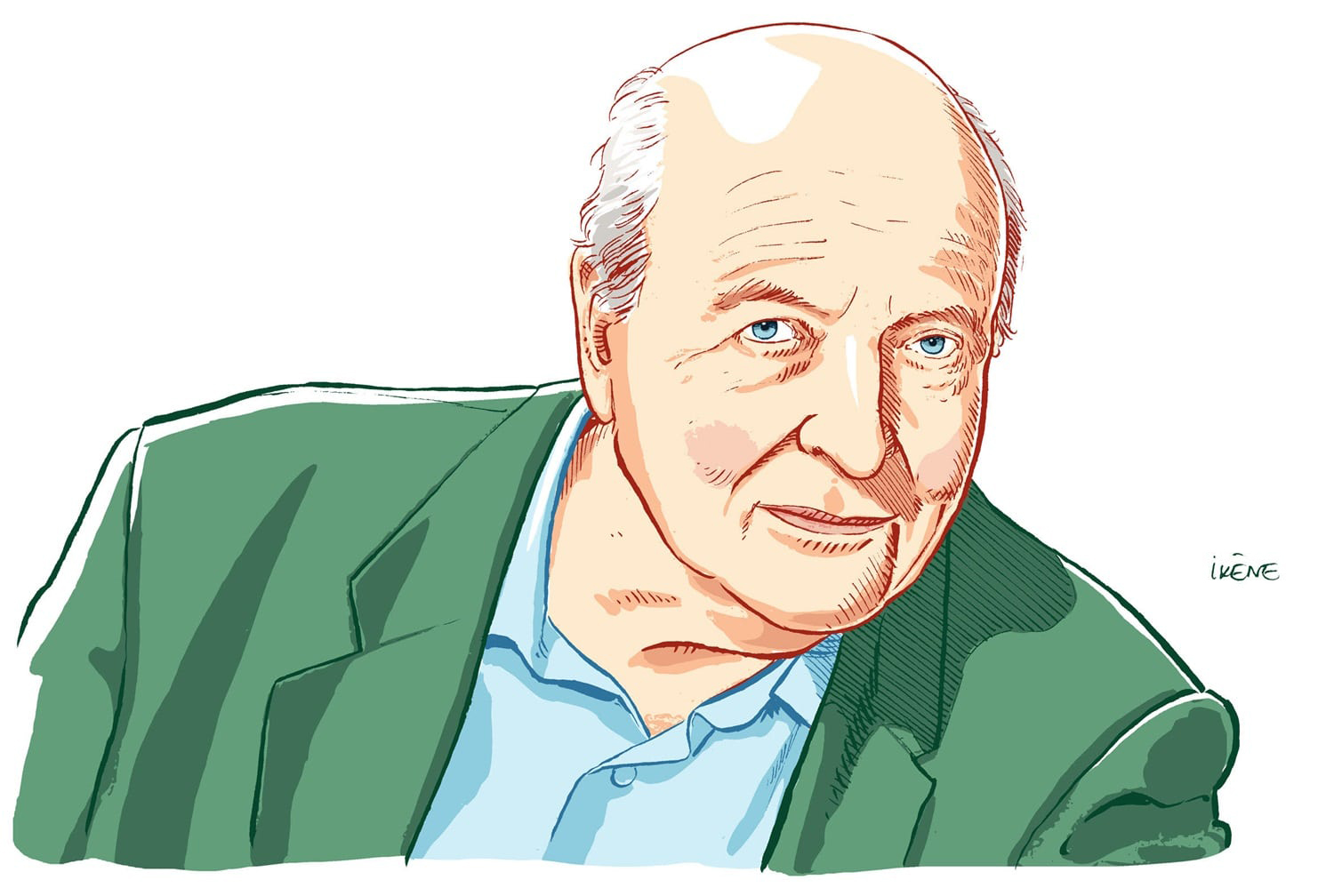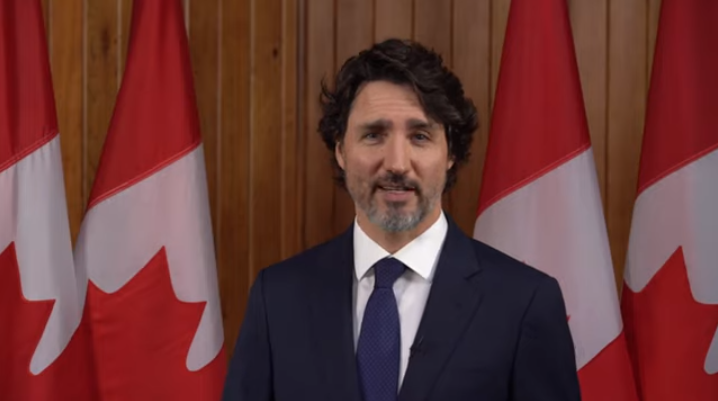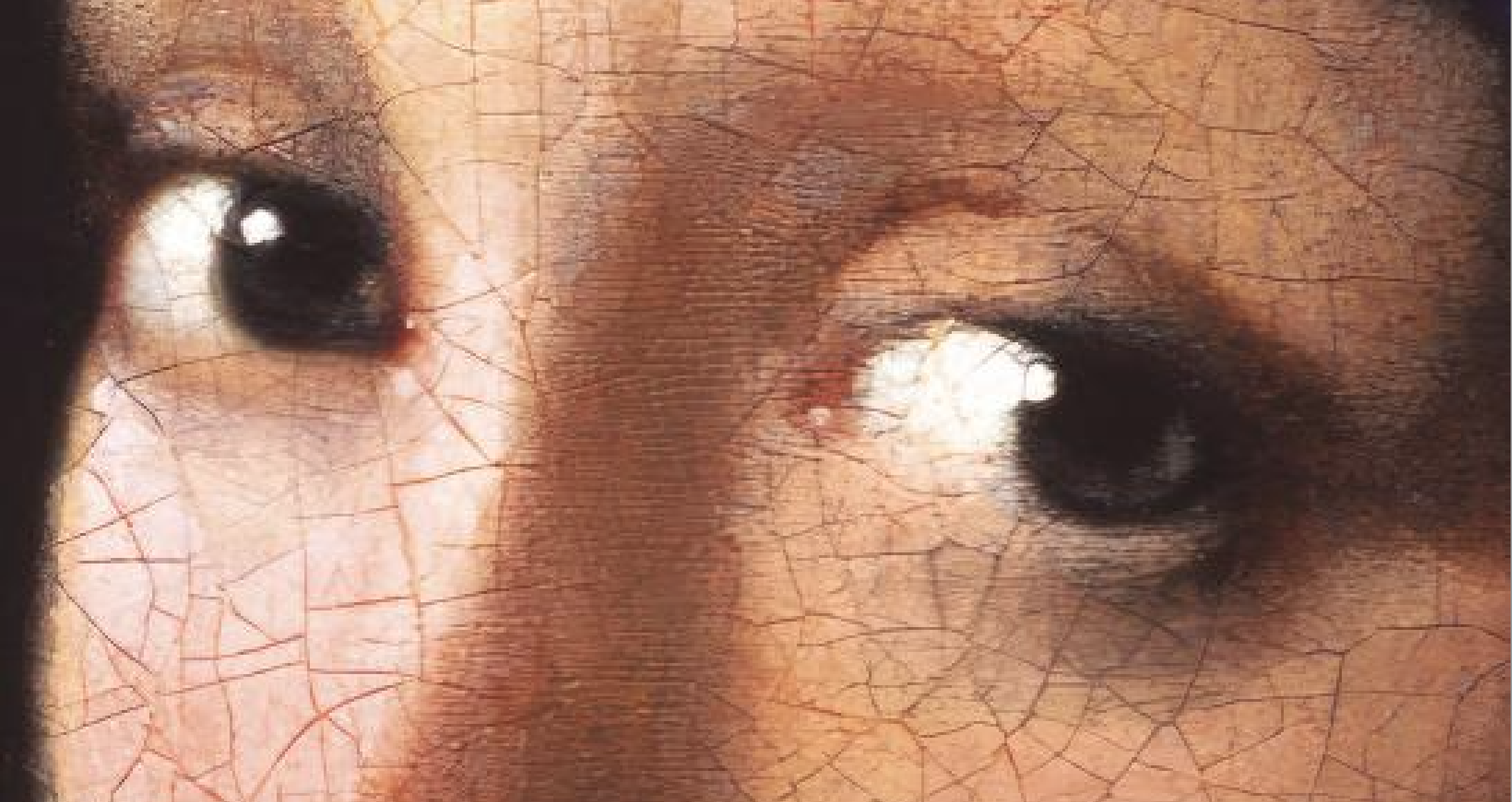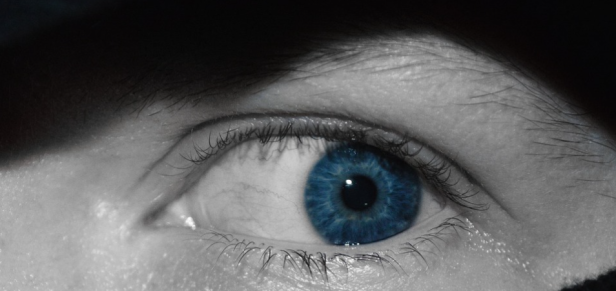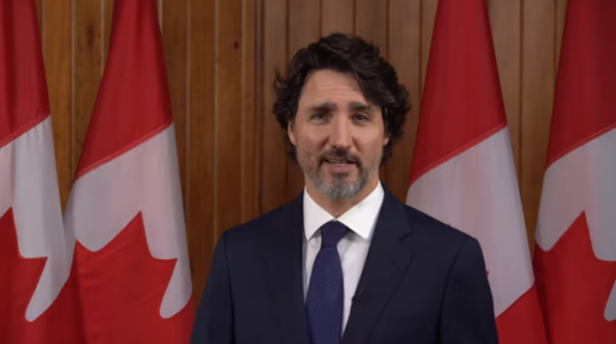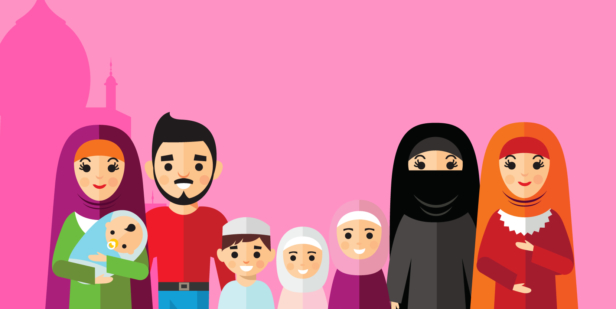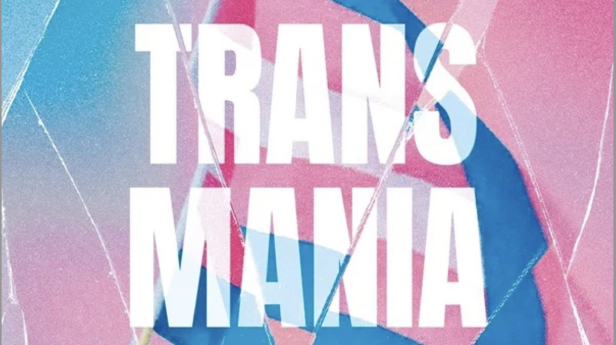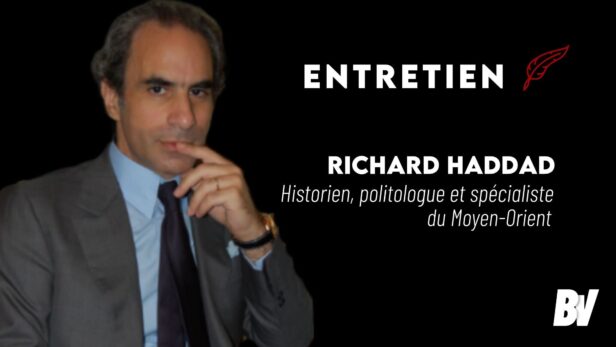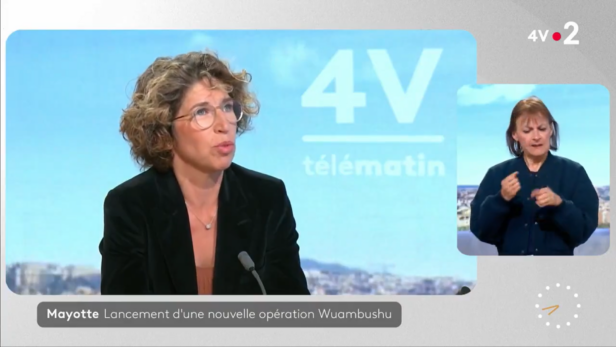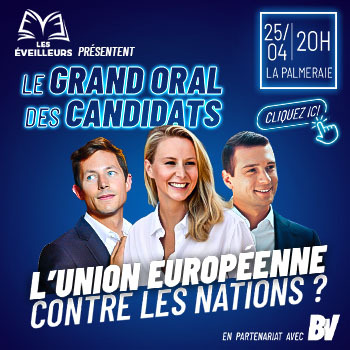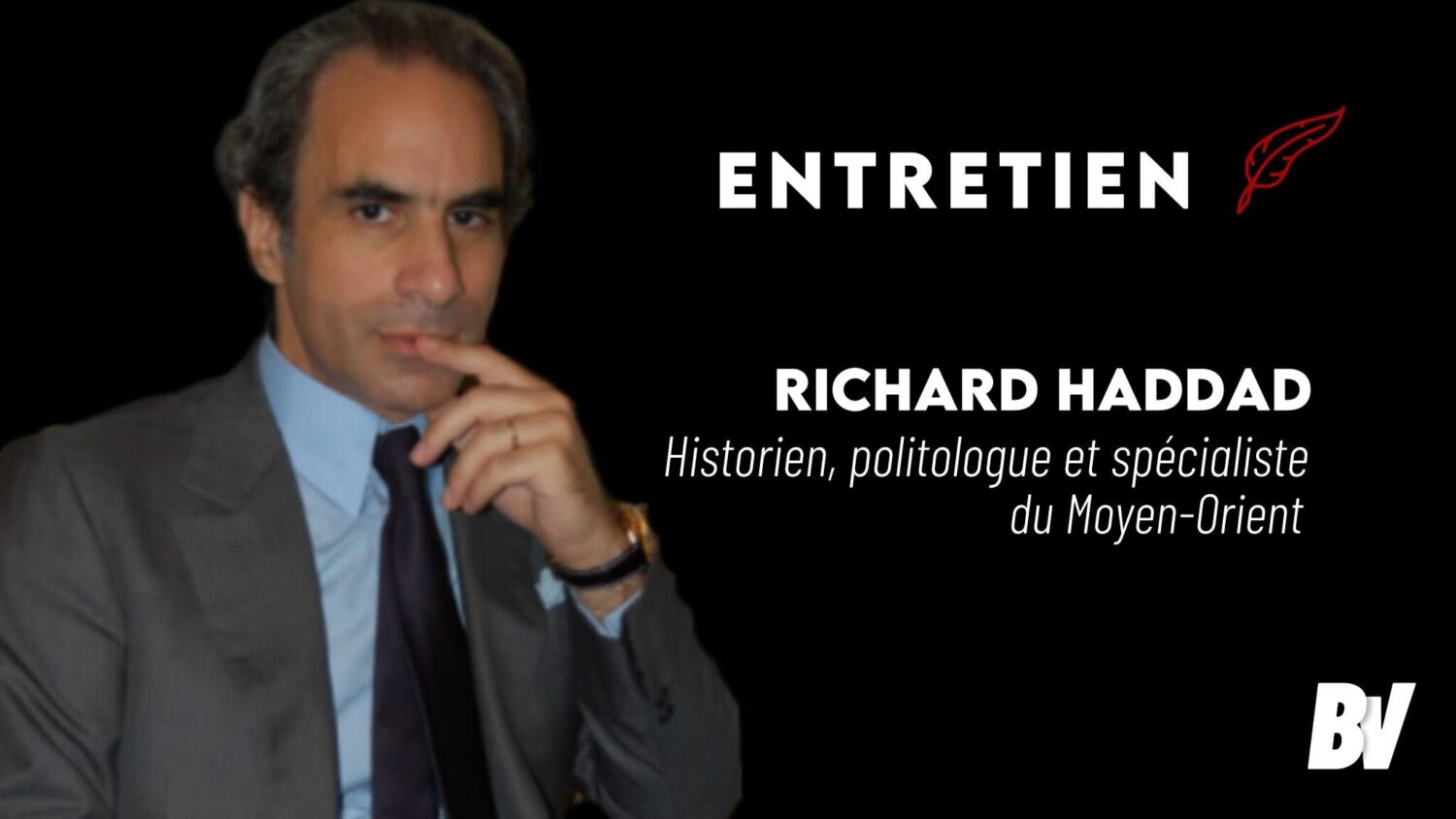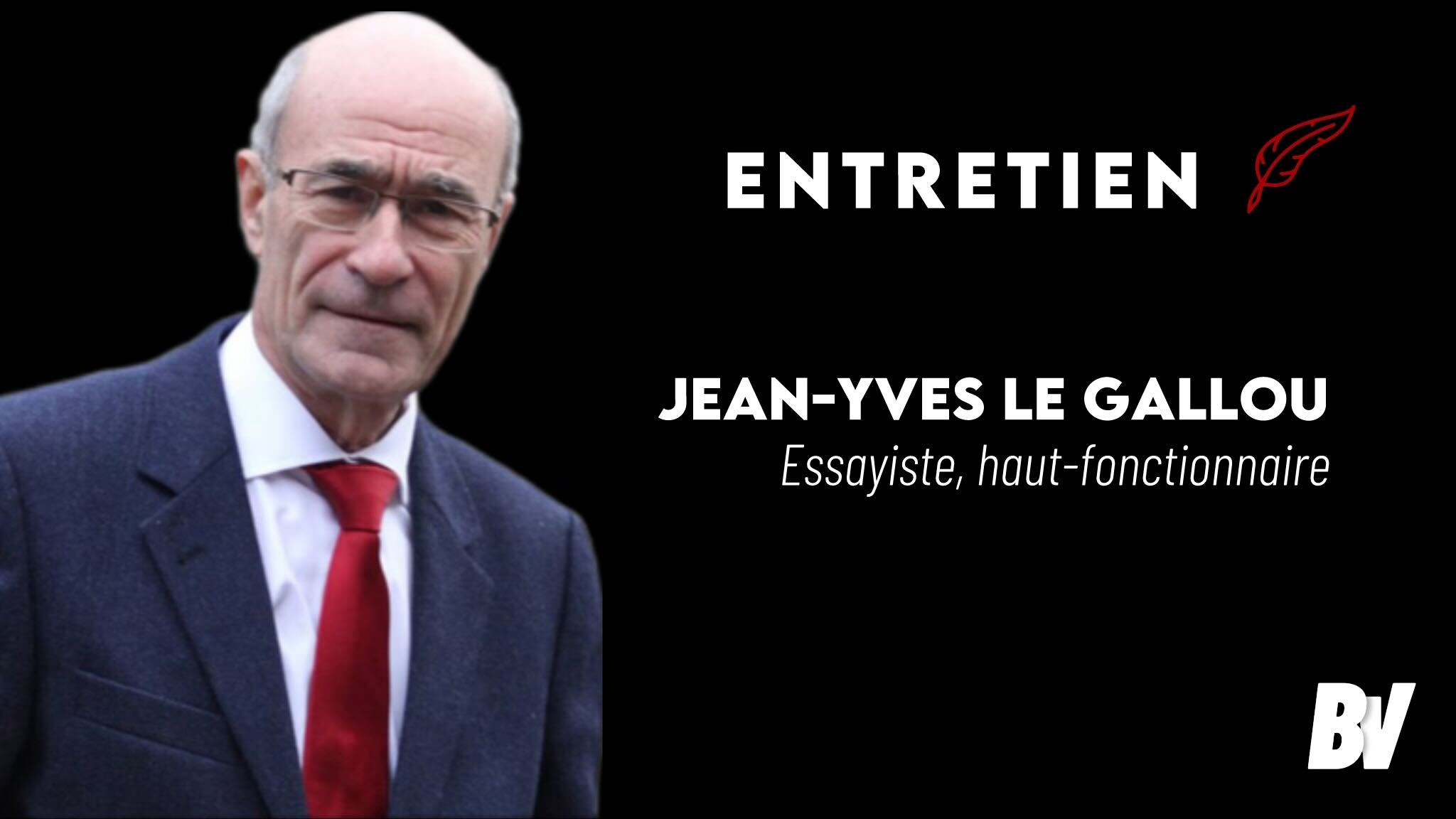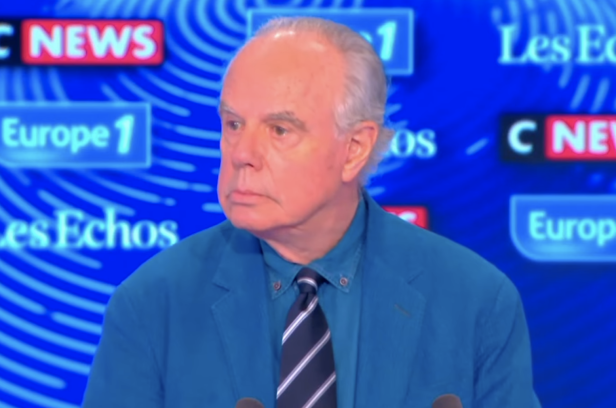De façon inattendue, les cagnottes sont devenues un nouvel outil dans le combat militant.
LES TOUT DERNIERS ARTICLES
L'ACTUALITÉ
Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR
- Jean Kast - 1 928 vues
L'intervention média
Les plus lus de la semaine
LES PLUS LUS DE LA SEMAINE
Les plus lus du mois
LES PLUS LUS DU MOIS
- Gabrielle Cluzel - 49 619 vues