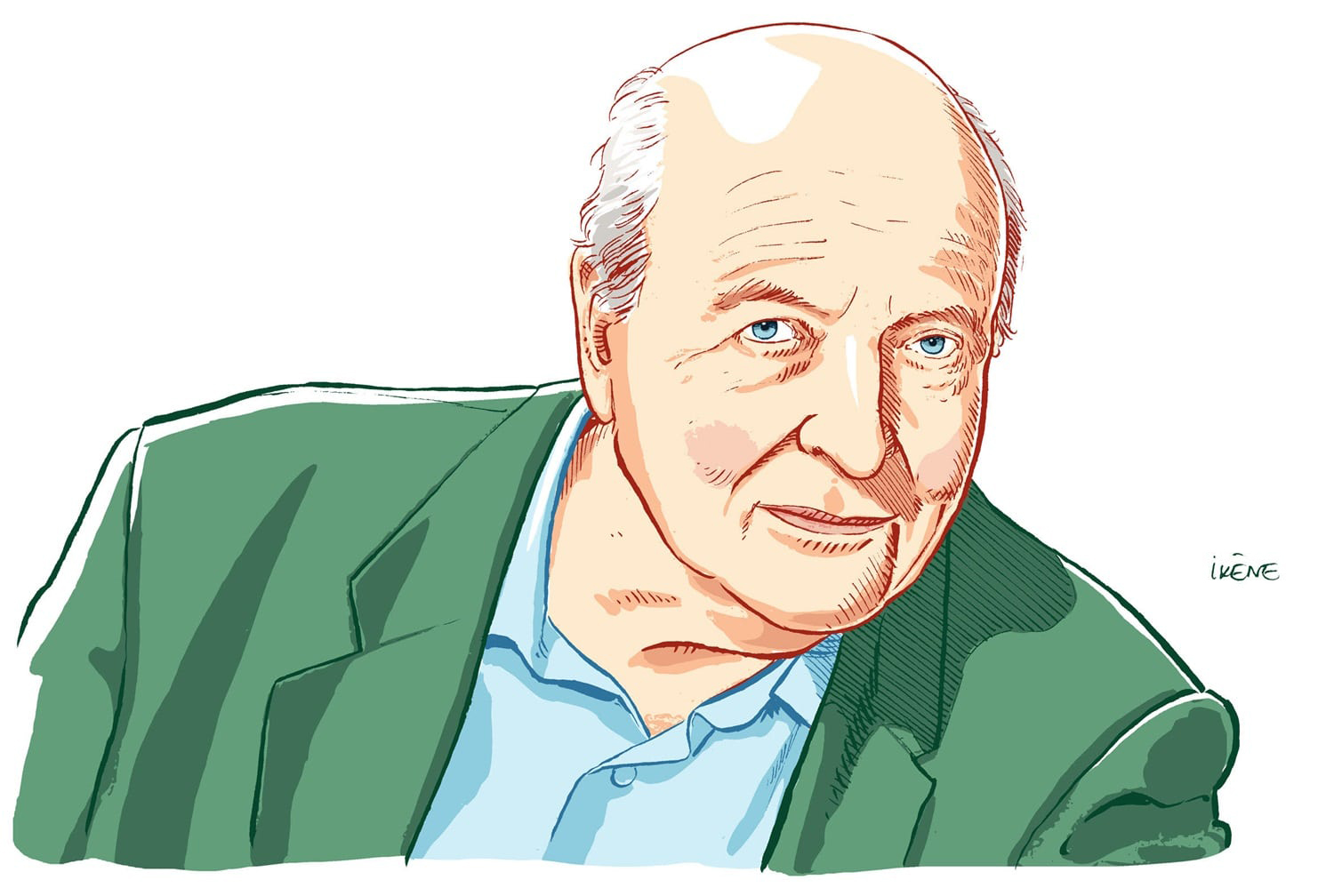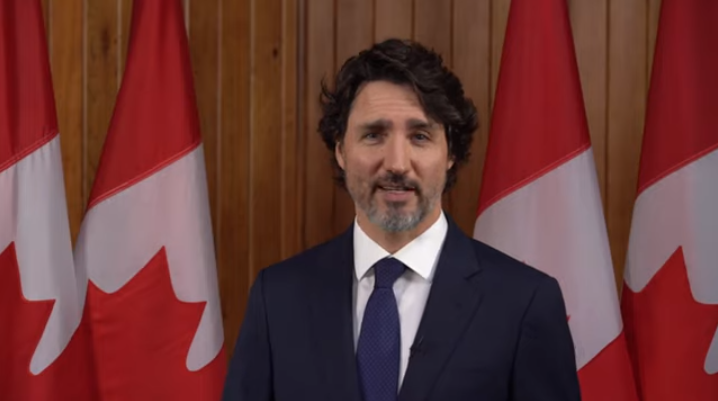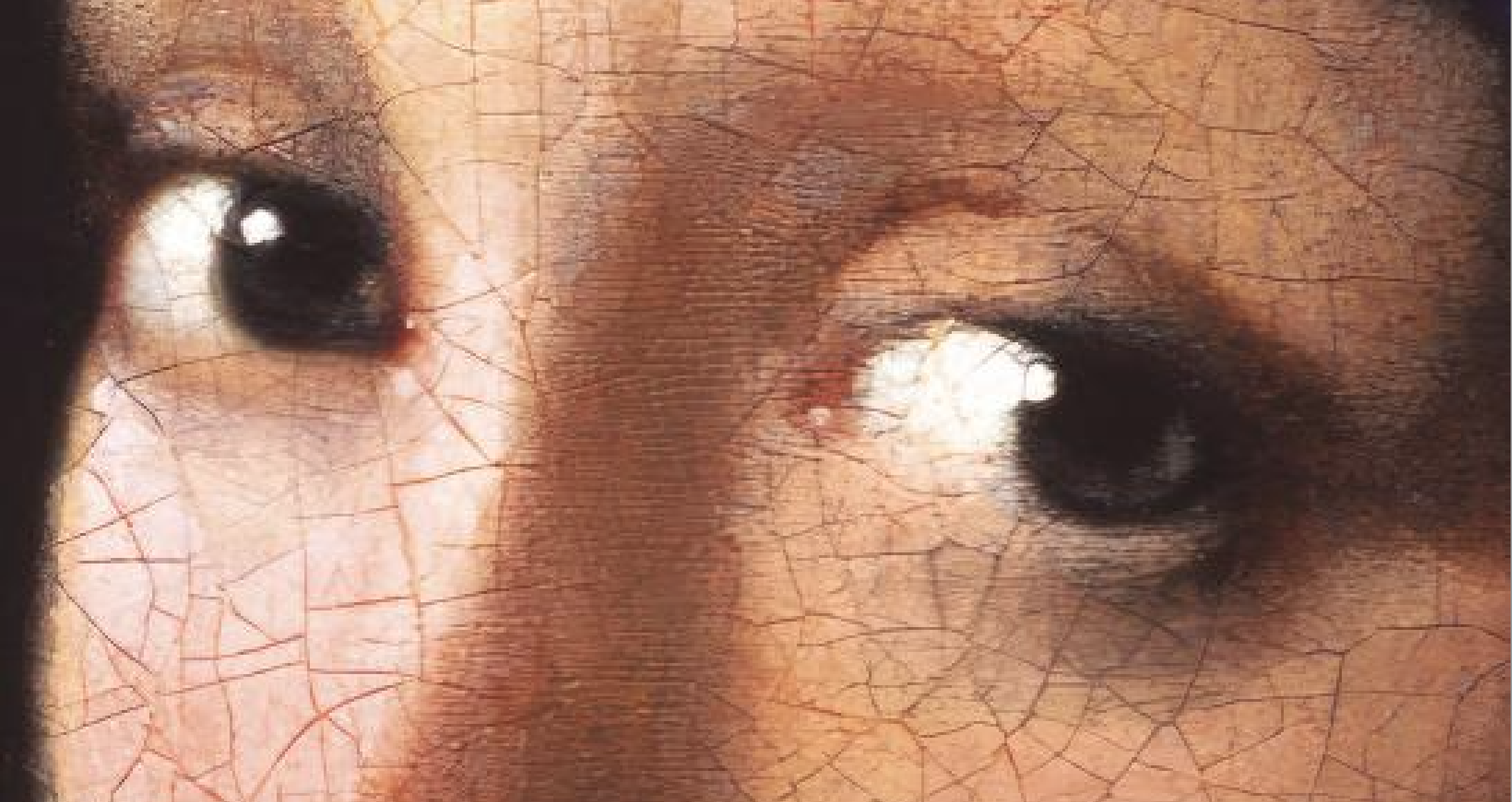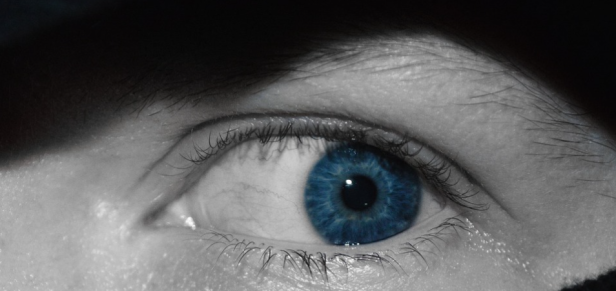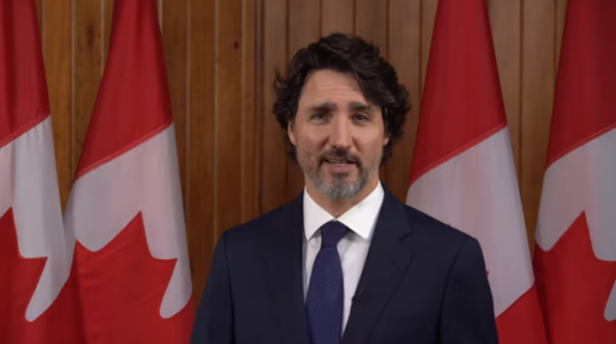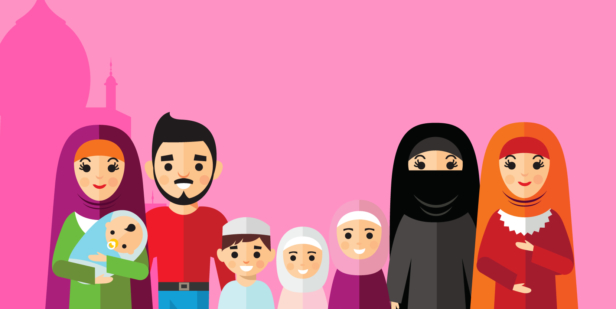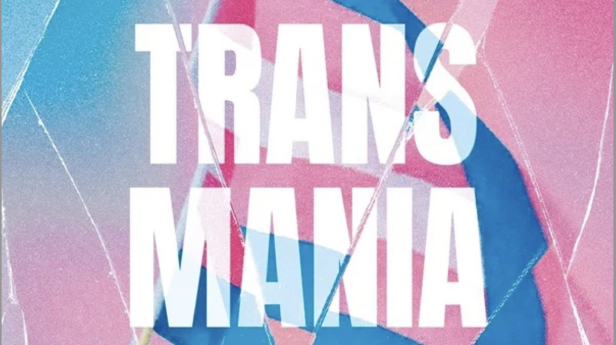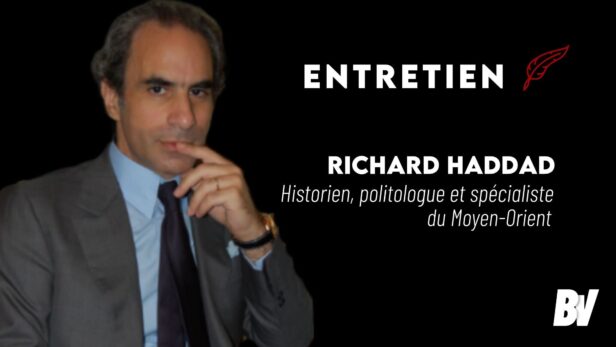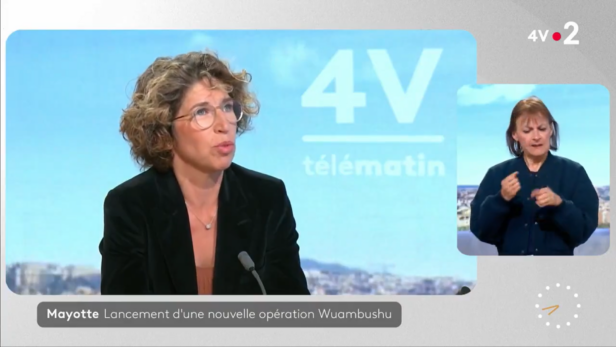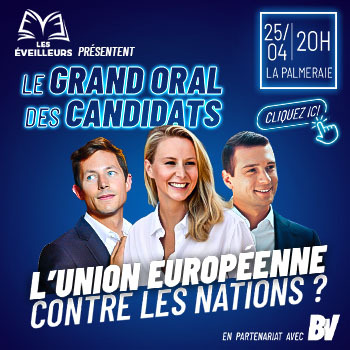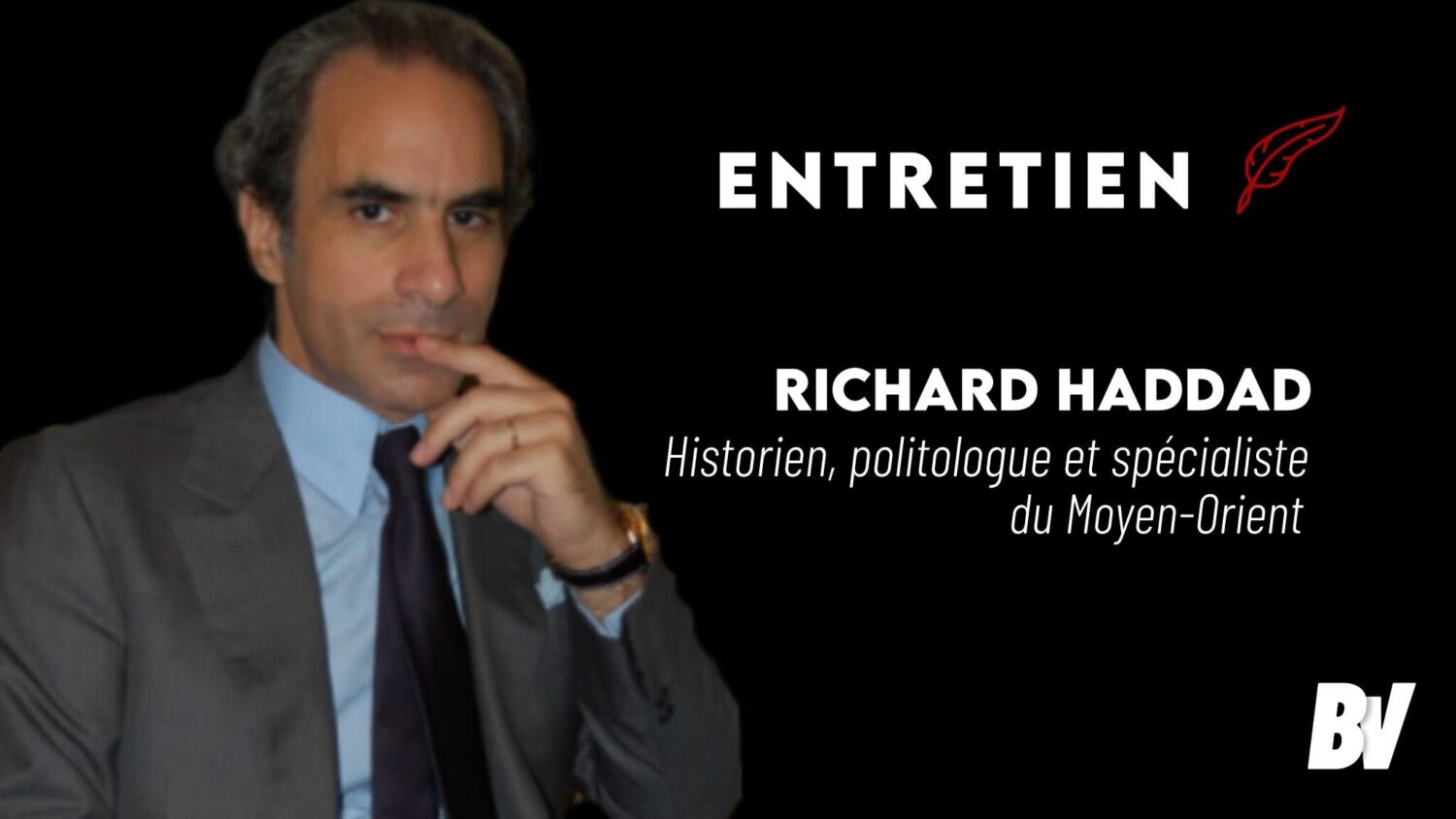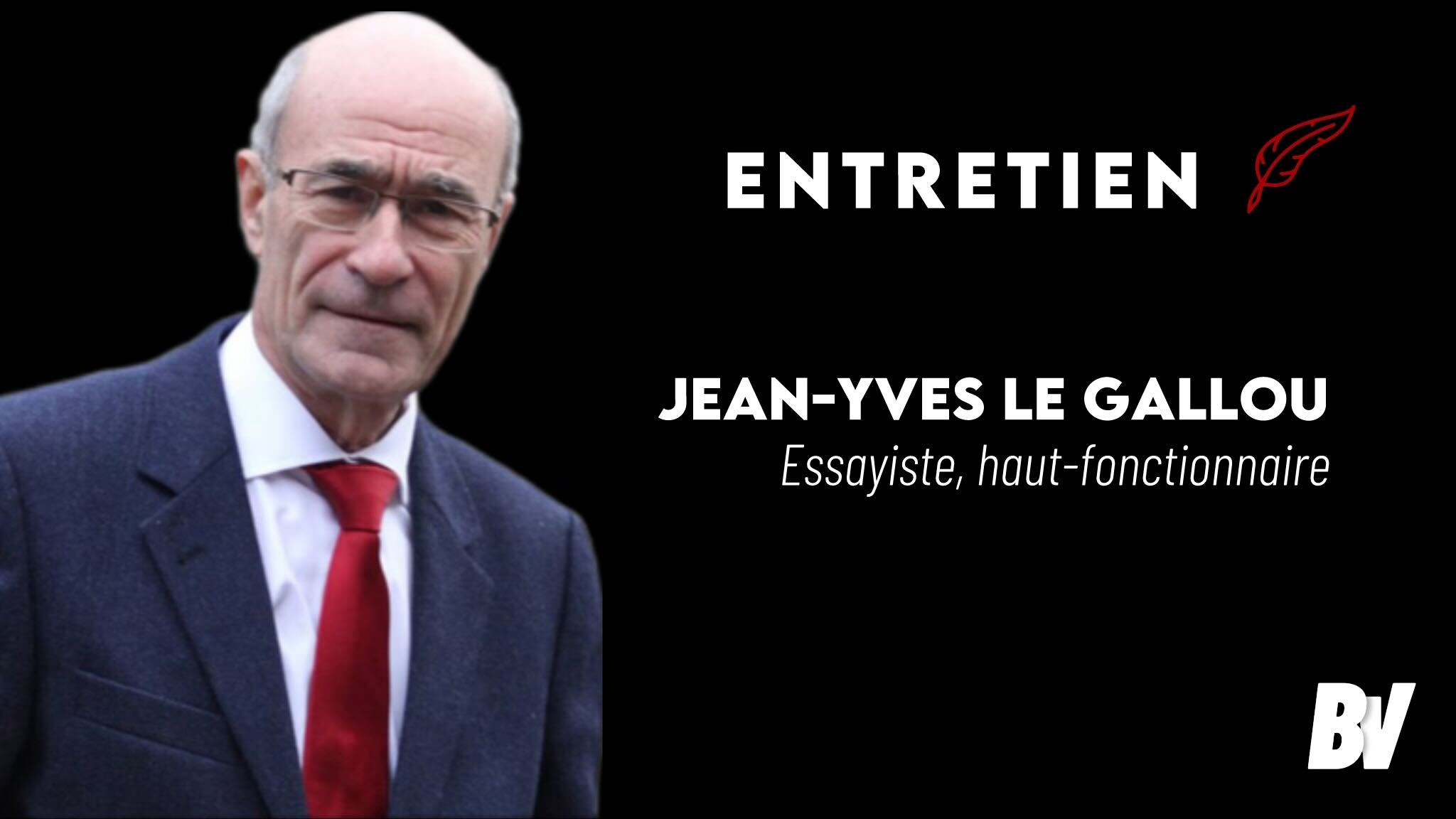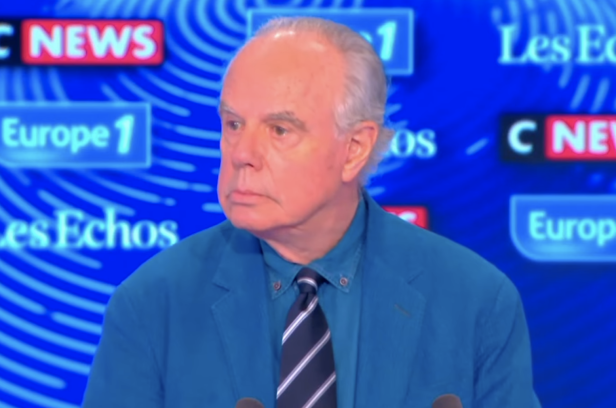Philippe rentrait chez lui lorsqu’un petit groupe l’aurait abordé pour lui réclamer son téléphone, avant de l'agresser.
LES TOUT DERNIERS ARTICLES
L'ACTUALITÉ
Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR
- Jean Kast - 1 275 vues
L'intervention média
Les plus lus de la semaine
LES PLUS LUS DE LA SEMAINE
Les plus lus du mois
LES PLUS LUS DU MOIS
- Gabrielle Cluzel - 49 610 vues