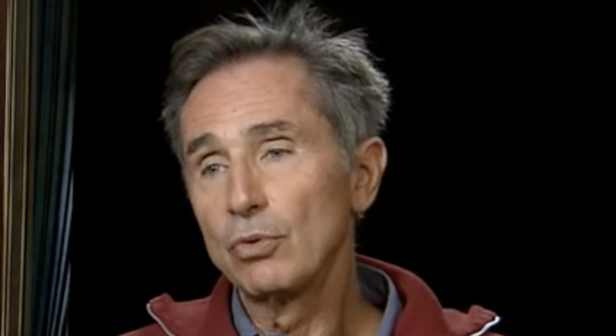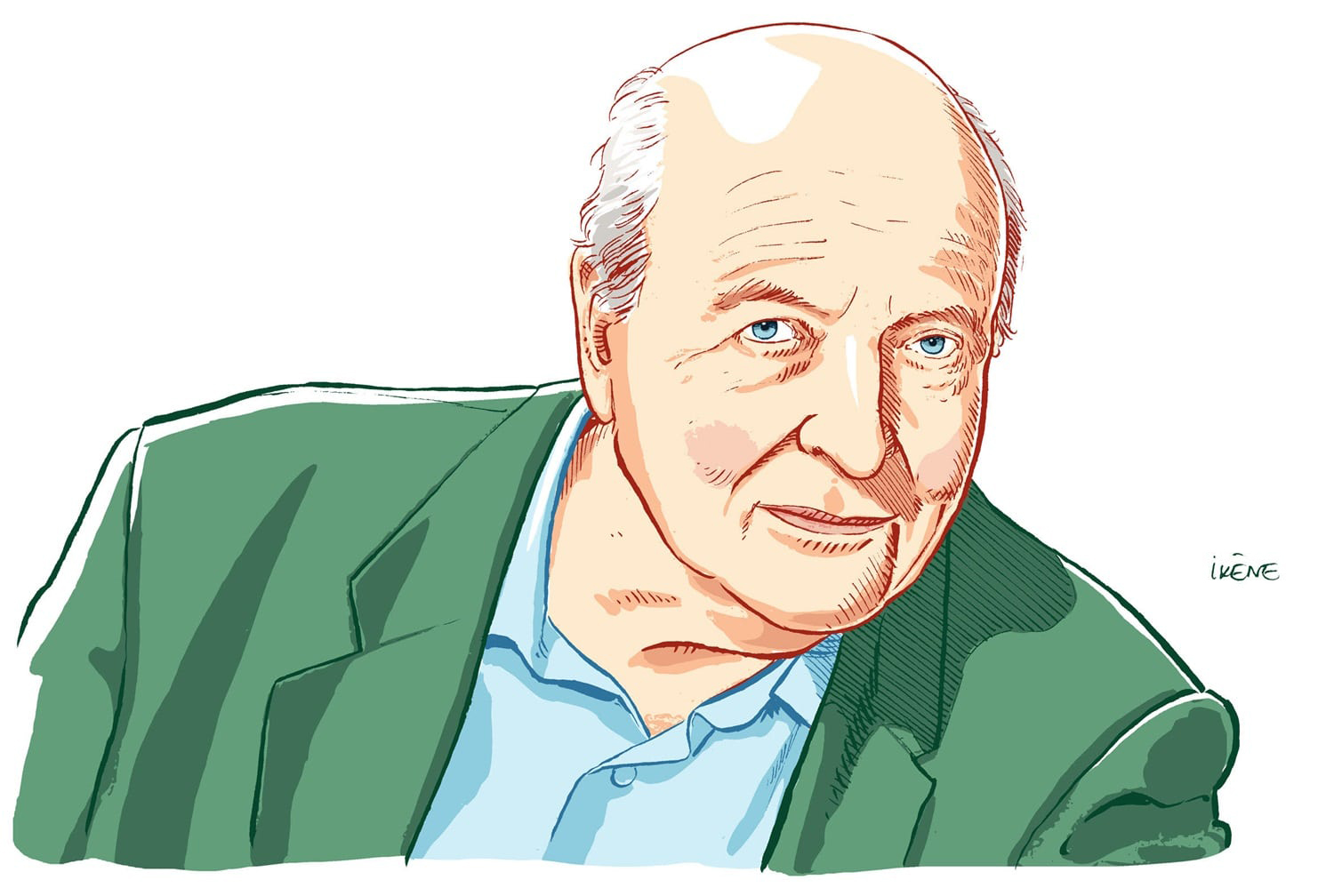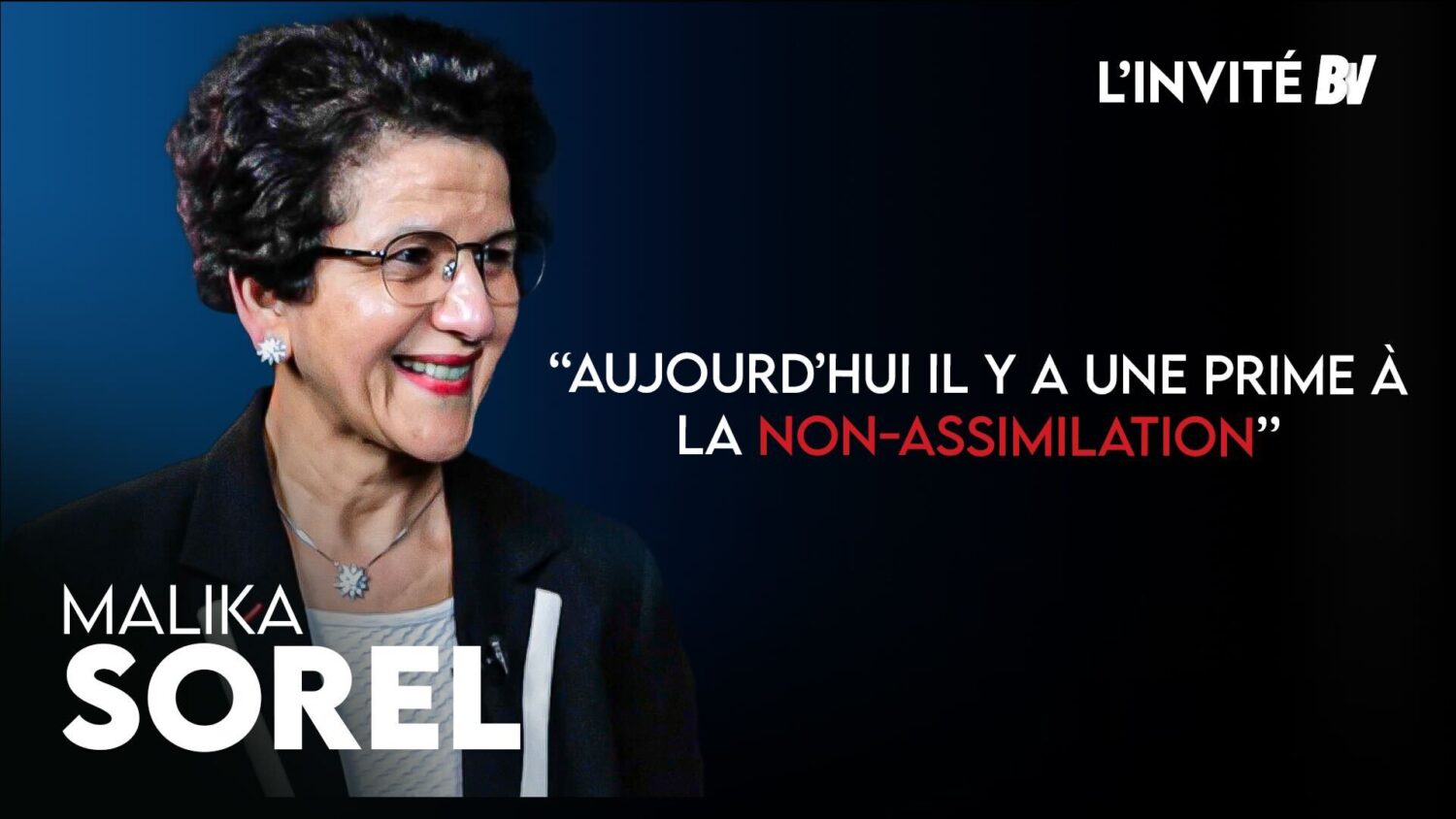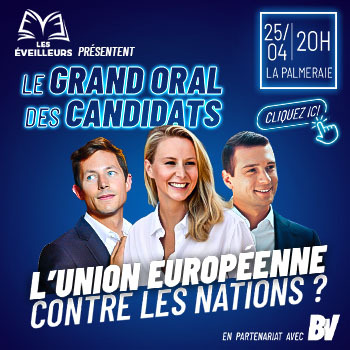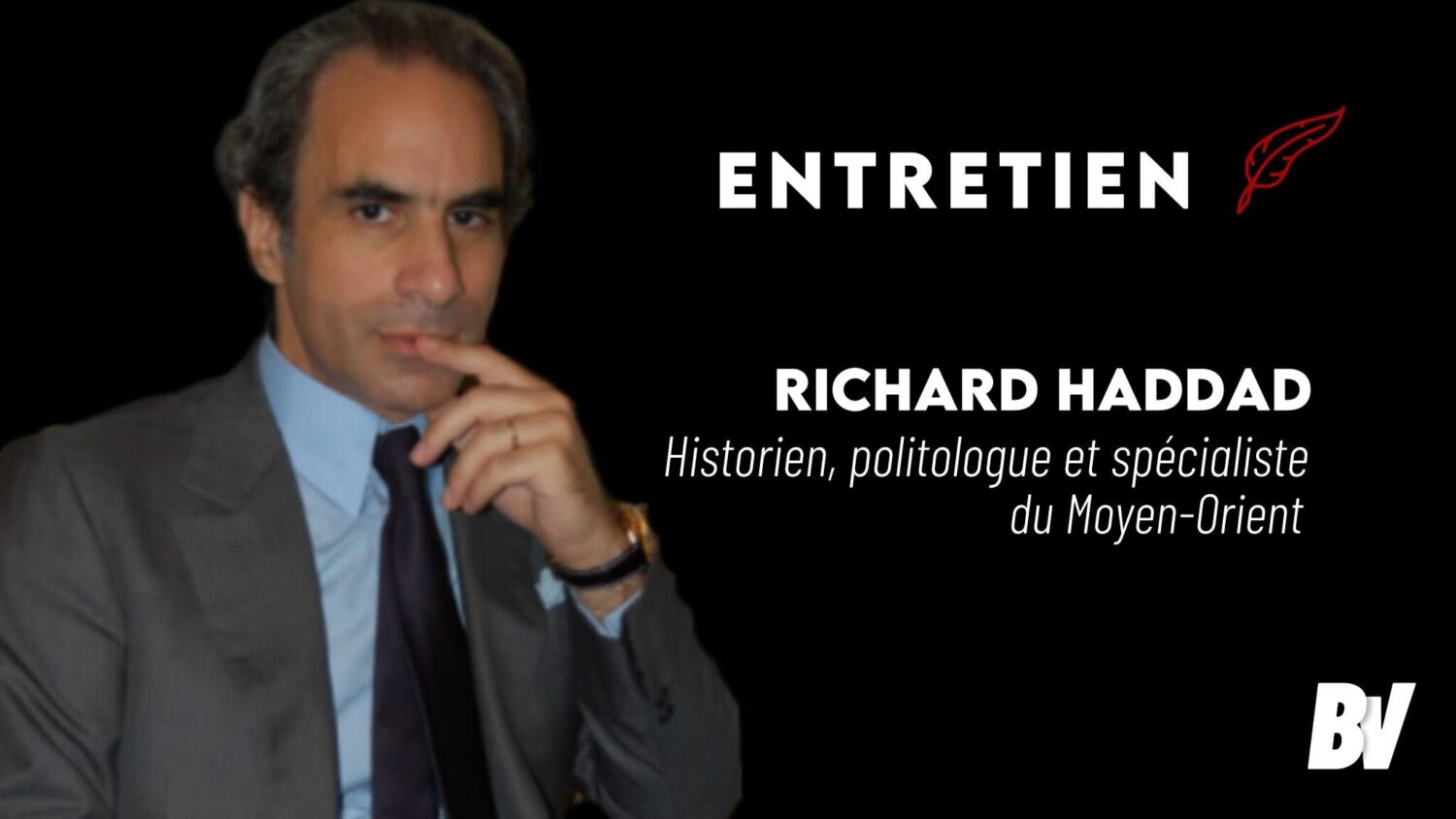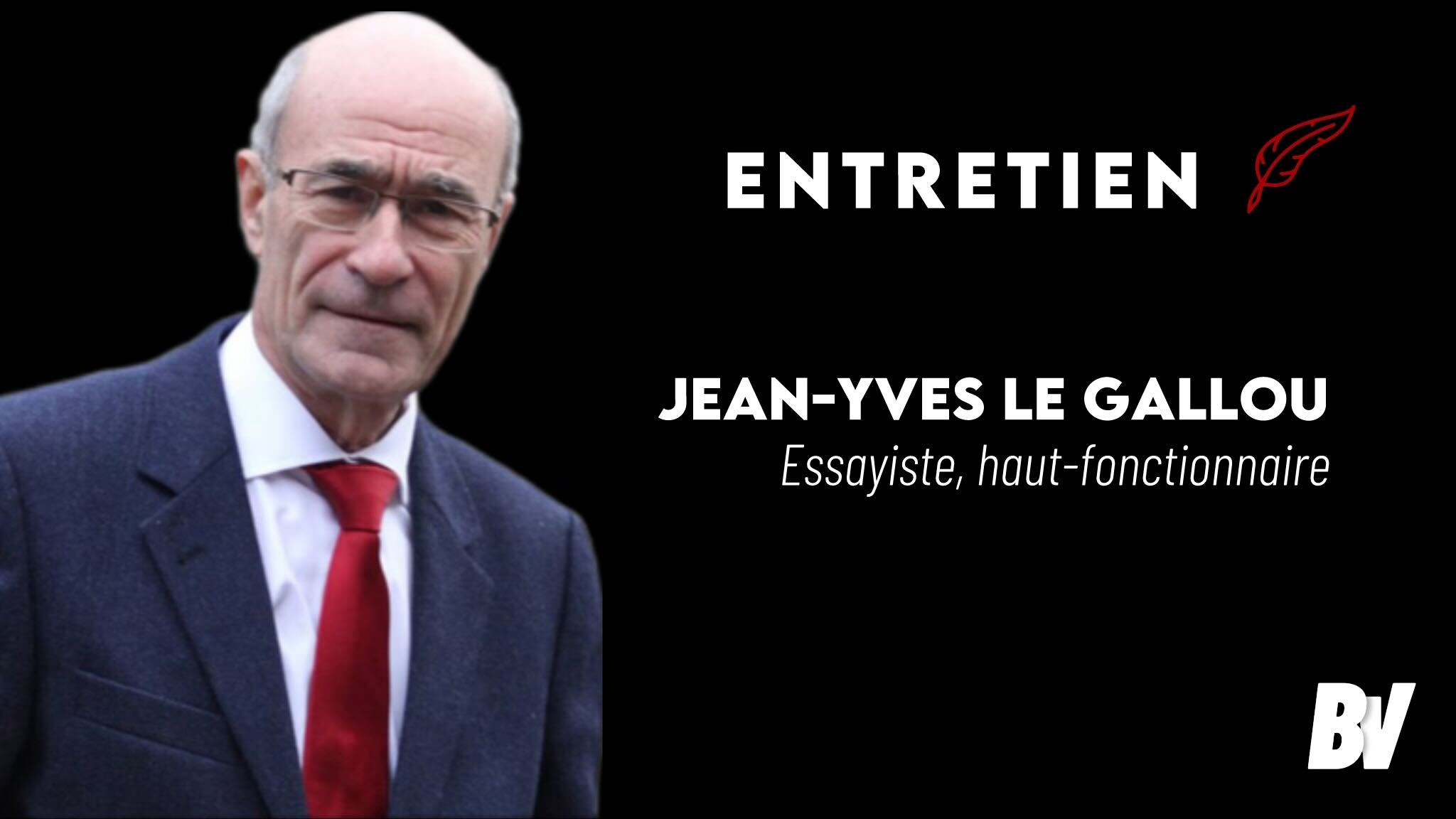Les deux plaignants ne sont pas tout à fait des parangons de neutralité...
Le saviez-vous :
- Face aux accusations folles d’Utopia 56 et de la LDH, le RN Fabrice Leggeri contre-attaque
- [EDITO] « Un événement sans précédent » ? L’insondable mauvaise foi de Jean-Luc Mélenchon
- Après Macron boxeur, Macron footballeur !
- Suivez en direct le grand oral des candidats : avec F.-X. Bellamy, M. Maréchal et J. Bardella
- Vente de Biogaran : de l’importance de la souveraineté
- « Où est la maman ? » : par un simple tweet, Marion Maréchal relance le débat sur la GPA
- Le bide de Quelques jours pas plus, film pro-migrants : la faute de l’extrême droite ?
- Quand les migrants menacent de perturber les JO de Paris