Cyril Cros : « Les forces de l’ordre sont confrontées à ce qu’il y a de plus bas dans la société »

Le fondateur d'Assopol, association venant en aide aux policiers, réagit aux nombreux suicides dans sa profession qui ont marqué récemment l'actualité. On ne mesure pas toujours suffisamment combien les forces de l'ordre doivent « prendre sur eux toute cette part de souffrance des victimes ».
Il y a eu neuf suicides chez les policiers, depuis le début de l’année 2022. Y a-t-il un mal-être dans l’institution policière ?
Il n’y a pas un mal-être plus grand que d’habitude. C’est peut-être la période, avant ou après les fêtes, qui est compliquée. Les soucis personnels et professionnels peuvent s’entrechoquer et on peut perdre pied à ce moment-là.
Comment faites-vous pour venir en aide à des policiers en détresse qui peuvent avoir des envies suicidaires ?
Nous ne sommes pas des médecins, nous ne sommes que des membres des forces de l’ordre qui parlons à d’autres membres des forces de l’ordre. Nous n’avons pas de baguette magique, le principal objectif est de renouer le dialogue, instaurer un climat de confiance entre collègues et de faire comprendre qu’il n’y a pas de honte à se faire aider par un psychologue ou un médecin psychiatre. Il ne faut pas hésiter à saisir les mains qui nous sont tendues pour aller bien.
Dans les suicides récents, y a-t-il des raisons communes ?
Quand on balaye les quinze ou vingt dernières années, on s’aperçoit malheureusement que le nombre de suicides ne diminue pas forcément. On constate une certaine souffrance au niveau professionnel et il ne faut pas oublier qu’un membre des forces de l’ordre a systématiquement affaire à ce qu’il y a de plus bas dans la société et il doit prendre en compte les victimes. On intervient souvent avant les premiers secours, les médecins ou les pompiers, et nous devons être dans la bienveillance. Dans notre métier, on a une part d’aide à la personne mais également le volet judiciaire que l’on doit traiter.
Les interventions sont éprouvantes…
Par exemple, en intervenant sur une agression, vous êtes le premier intervenant, vous avez la victime qui s’est pris un coup de couteau. Vous devez déjà faire redescendre la peur de la victime et la recentrer sur le volet judiciaire, hormis les premiers soins psychologiques ou physiques. On doit judiciariser l’événement et marquer noir sur blanc ce qu’il s’est passé de façon la plus neutre possible. En étant dans la bienveillance et dans la prise en charge de cette personne, on doit automatiquement prendre une part de cette souffrance. Lors d’une plainte dans un commissariat ou sur un dossier d’investigation, vous avez également affaire à la victime. Pour que tout soit marqué noir sur blanc et que les éléments judiciaires soient bien stipulés, vous prenez également la part de souffrance et vous la gardez en vous. Si vous avez dix interventions par jour, dix personnes reçues dans votre bureau, on multiplie cela par le nombre de semaines et d’années, au bout de quinze ou vingt ans, ça fait un lourd bagage. Et cela peut avoir des répercussions sur votre vie privée car vous ramenez toute cette souffrance à la maison et vous devenez irritable. C’est source de conflit à la maison. Si le plafond de verre que vous avez au-dessus de la tête - votre famille - se brise, tout se casse la figure et vous êtes au fond du gouffre. C’est valable pour le privé et le professionnel, ça va dans les deux sens.
Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR
- Jean Kast - 1 781 vues
L'intervention média
Les plus lus de la semaine
LES PLUS LUS DE LA SEMAINE
Les plus lus du mois
LES PLUS LUS DU MOIS
- Gabrielle Cluzel - 49 618 vues







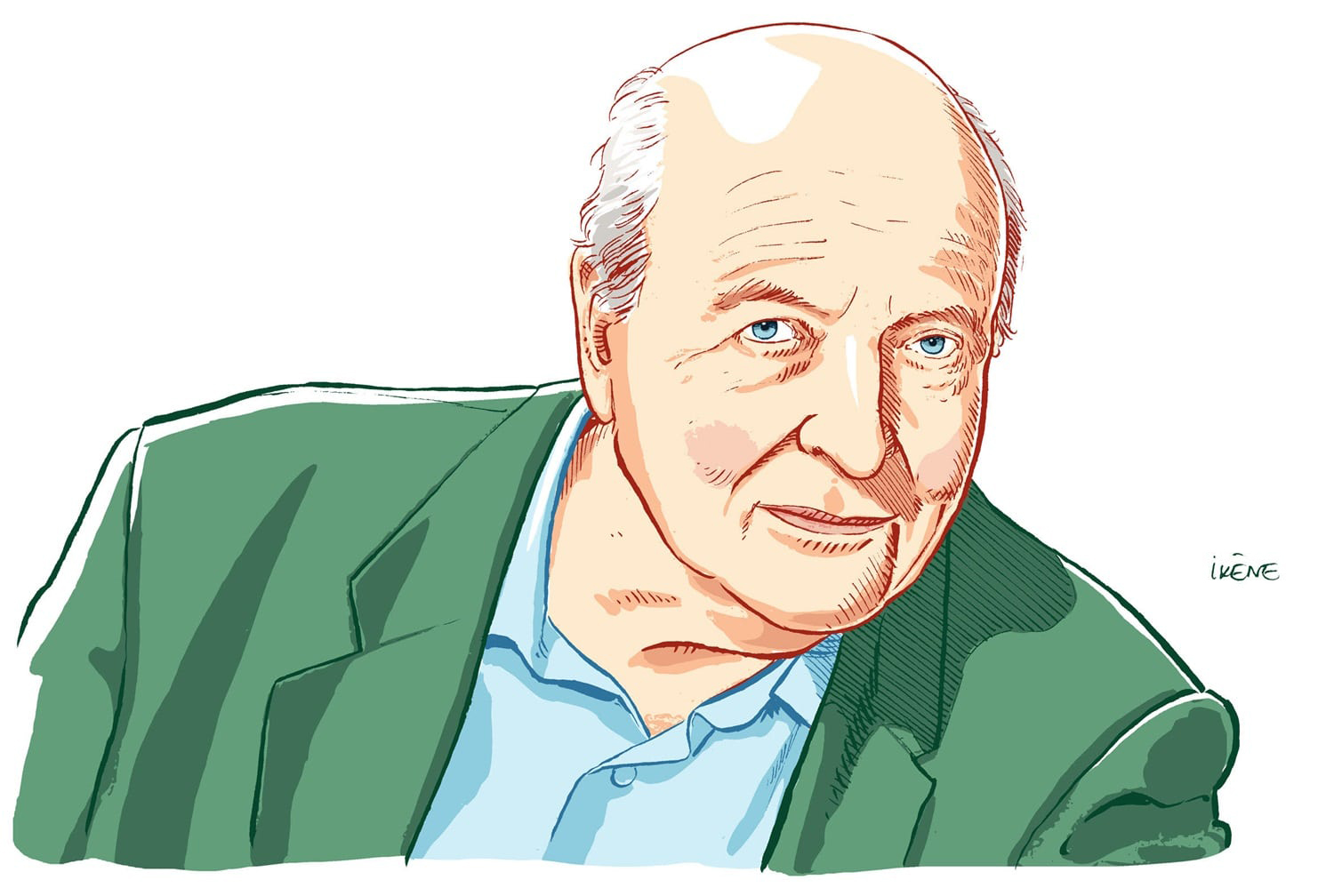




























BVoltaire.fr vous offre la possibilité de réagir à ses articles (excepté les brèves) sur une période de 5 jours. Toutefois, nous vous demandons de respecter certaines règles :