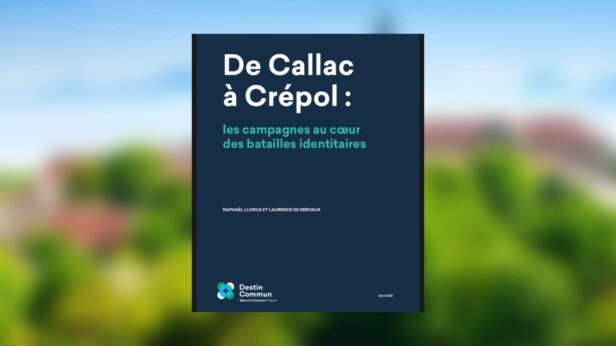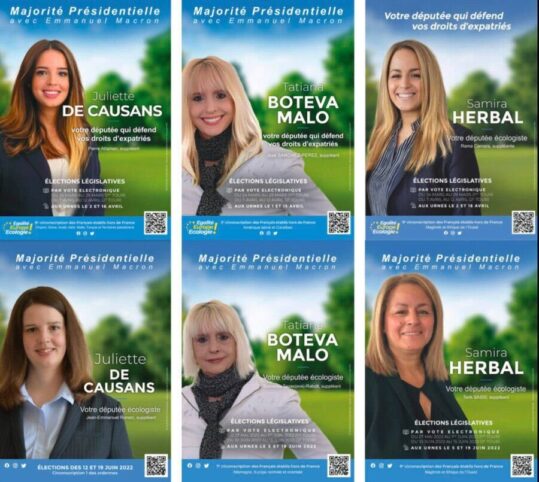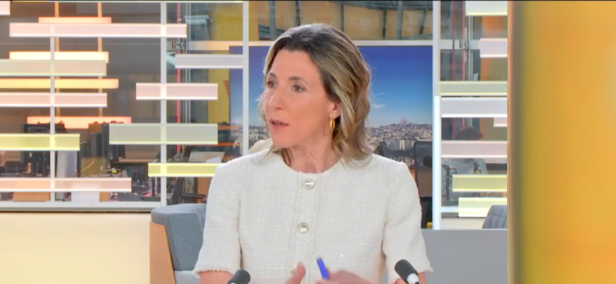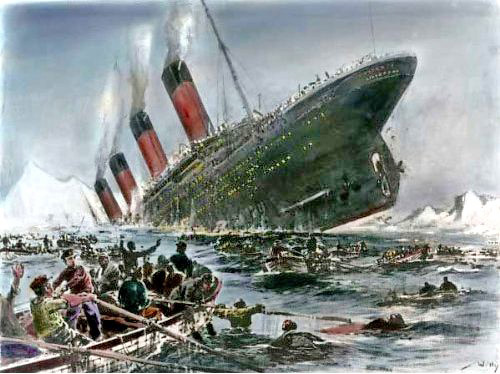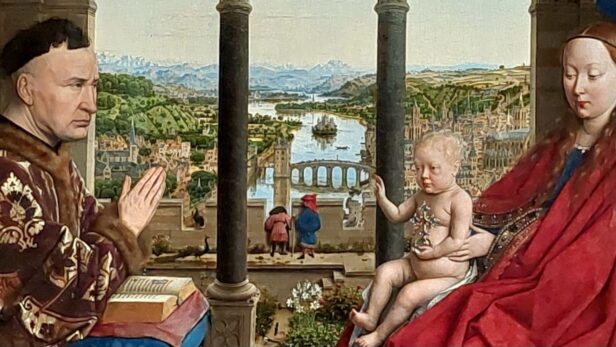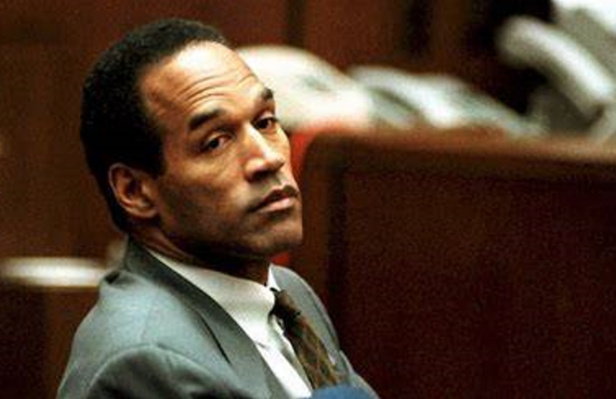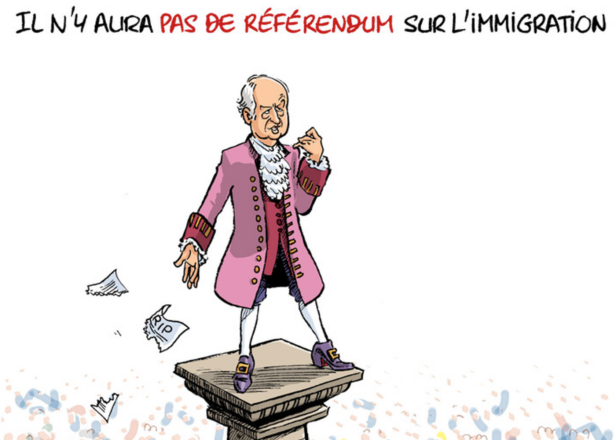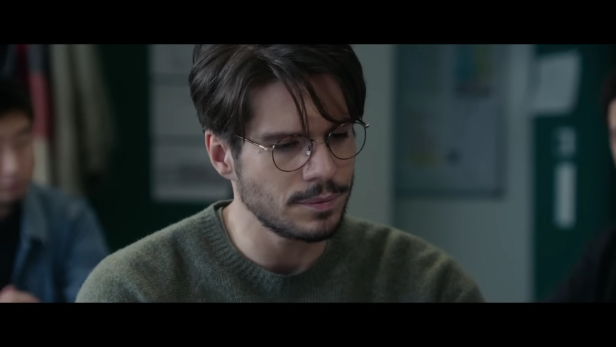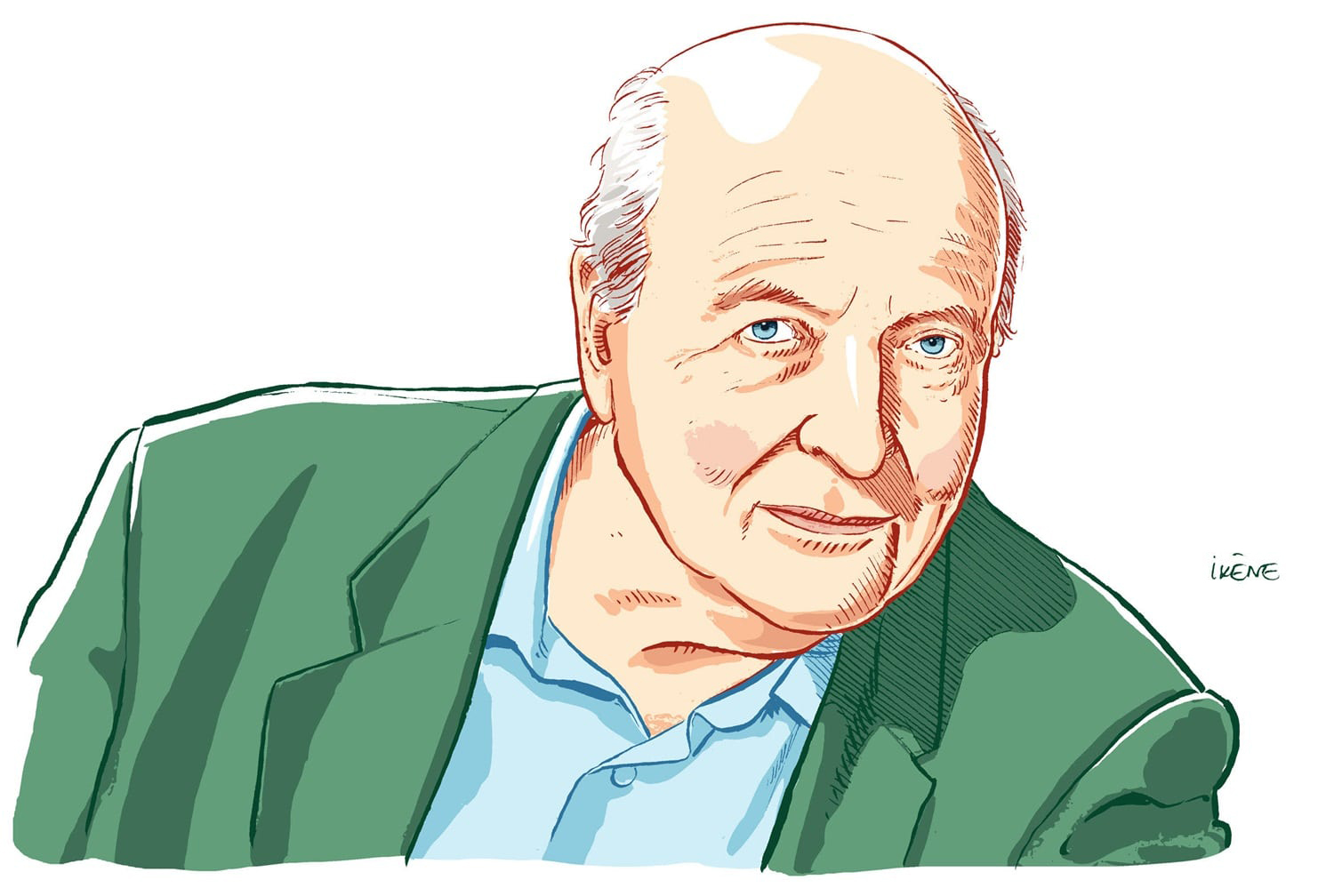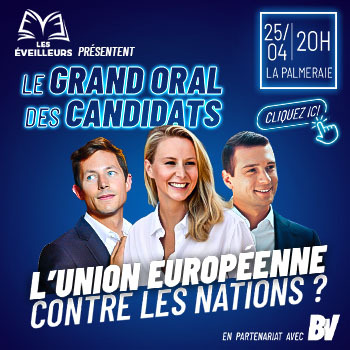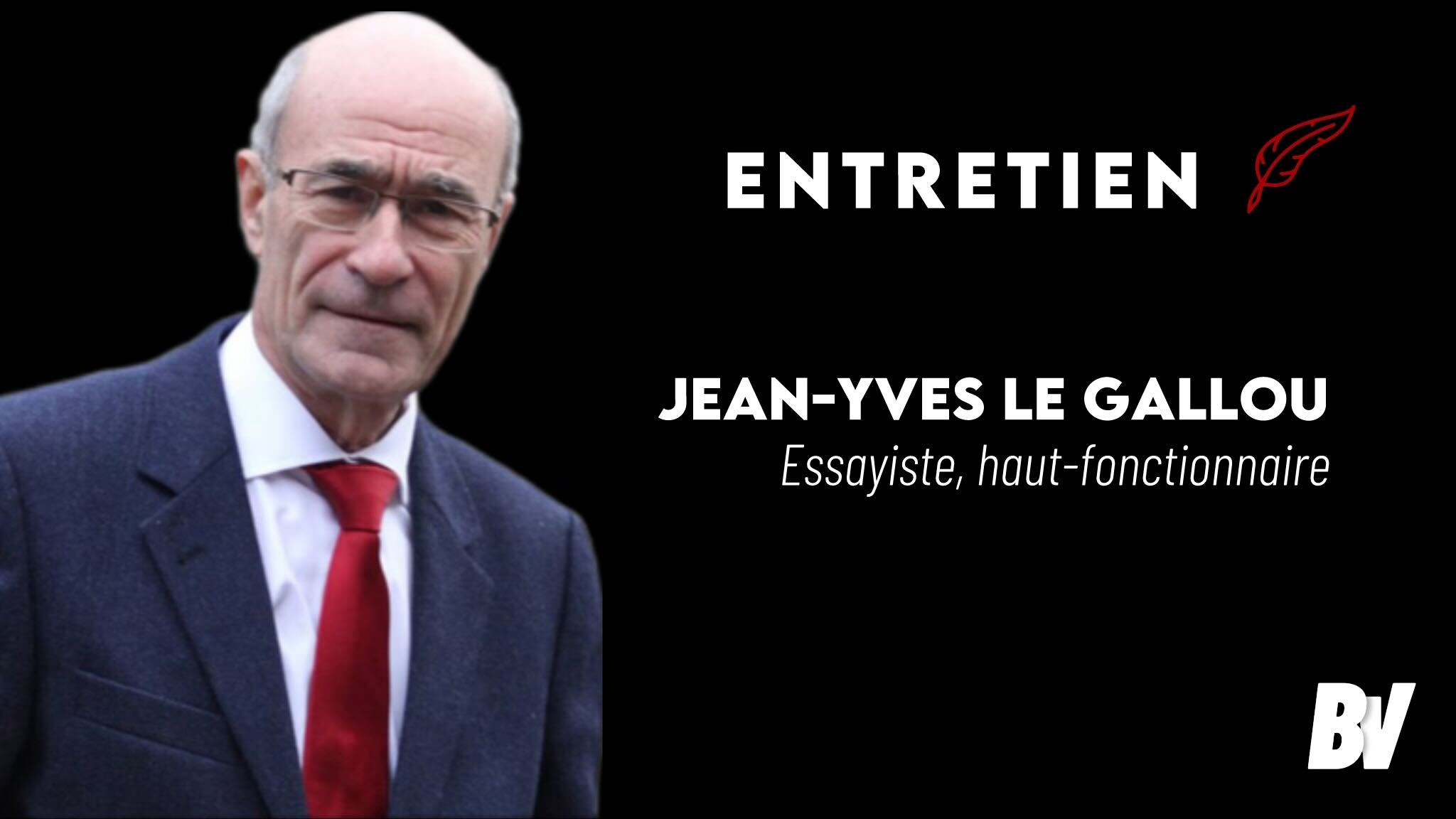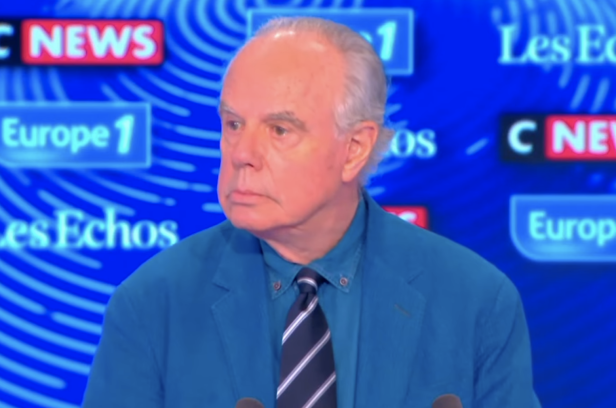La piste de l'incendie volontaire a été écartée, mais les pistes accidentelles n’aboutissent à rien ni personne.
LES TOUT DERNIERS ARTICLES
L'ACTUALITÉ
Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR
L'intervention média
Les plus lus de la semaine
LES PLUS LUS DE LA SEMAINE
Les plus lus du mois
LES PLUS LUS DU MOIS
- Gabrielle Cluzel - 49 114 vues