Se souvient-on de la Grande Guerre ou de sa réécriture pacifiste ?

Les guerres, pour la plupart, ne sont plus enseignées en cours d’histoire. Faute de temps, surtout : le programme autrefois étalé sur sept ans a été réduit à quatre années de course contre la montre. On fait semblant de croire que quelques rares développements au cours des trois ans de lycée compensent la perte d’une étude continuellement approfondie.
Faute de temps, mais peut-être aussi faute d’intérêt. Il y a des professeurs qui racontent, en les vivant avec passion, les combats de Marathon, de Salamine, de Crécy, mais il y en a d’autres, pacifistes de conviction, qui trouvent toutes les guerres superflues et leur étude plus encore, sauf éventuellement pour en détailler les horreurs. S’ils sont anticléricaux, on pourra tout de même apprendre des croisades et de la Saint-Barthélemy que le catholicisme est source d’un obscurantisme meurtrier.
Mais ce qui fait les guerres ? Leurs causes ? Se bat-on pour un territoire, pour une couronne, pour venger une offense, par représailles, pour le pillage, pour mettre fin aux exactions continuelles d’un oppresseur, pour repousser l’envahisseur au-delà de la frontière ? Qui se bat ? Des aristocrates nés soldats, des volontaires, des conscrits, tous les hommes valides de la tribu, des bandes spontanément organisées ? Comment ? En dentelles et en devisant aimablement pour définir le prochain champ de bataille, dans une grande mêlée de combats singuliers, en unités articulées, en combat asymétrique ? Quelles sont les règles du combat, et sont-elles seulement les mêmes pour les deux ou trois ou quatre adversaires ? Et les civils, participent-ils à la guerre ?
Si rien ou presque n’est évoqué de tout cela, il s’ensuit naturellement que l’on ignore ce que c’est que la guerre et, en premier lieu, qu’il y a de très nombreuses sortes de guerres, justes ou injustes, de forte ou de basse intensité, touchant toutes les catégories des populations concernées de façon extrêmement variable selon les lieux, les époques, les coutumes et les circonstances.
Après plus de deux mille ans assez paisiblement écoulés — sans doute, si on ne parle pas de ces guerres tellement répétées que chaque génération a eu les siennes — éclate soudain le terrible cataclysme de la Première Guerre mondiale comme un coup de tonnerre dans un ciel passablement bleu. Une guerre totale, une boucherie déclenchée pour des raisons obscures, puisqu’on ne peut pas traiter la période précédente qui a valu la conclusion des alliances, un gouffre absurde dans lequel s’engloutissent les millions de vies de soldats victimes de la folie des politiciens. Voici des hommes appelés au devoir et qui l’ont courageusement embrassé, dépouillés de leur bravoure et réduits à l’état de pantins. On en est à réhabiliter les fusillés pour l’exemple parce qu’ils ont eu peur. Et les autres, alors ? Autant dire tout net qu’il est absurde de devoir donner sa vie, et que l’intérêt particulier prime sur l’intérêt général.
La Deuxième Guerre mondiale, qui subit une réécriture dont les media nous rebattent les oreilles toutes les semaines, a maintenant davantage l’apparence d’une guerre contre le nazisme que contre les Allemands, centrée sur les massacres plutôt que sur les combats, mais totale, là encore : les deux exceptions font figure de généralité par la magie de l’omission.
Alors, dans ces conditions, les cérémonies du centenaire raniment-elles le souvenir du courage et de la patrie charnelle, ou le pacifisme béat qui s’attendrit sur les « victimes » et trouve « fasciste » de défendre une frontière, alors qu’il eût été si simple de se résoudre à « parler allemand » ? Si ce second sentiment l’emporte, peut-être vaudrait-il mieux se dire qu’un siècle suffit et s’en tenir là des cérémonies.
Thématiques :
Commémoration de la guerre de 14-18Pour ne rien rater
Les plus lus du jour
LES PLUS LUS DU JOUR
L'intervention média
Les plus lus de la semaine
LES PLUS LUS DE LA SEMAINE
Les plus lus du mois
LES PLUS LUS DU MOIS
- Gabrielle Cluzel - 49 125 vues


















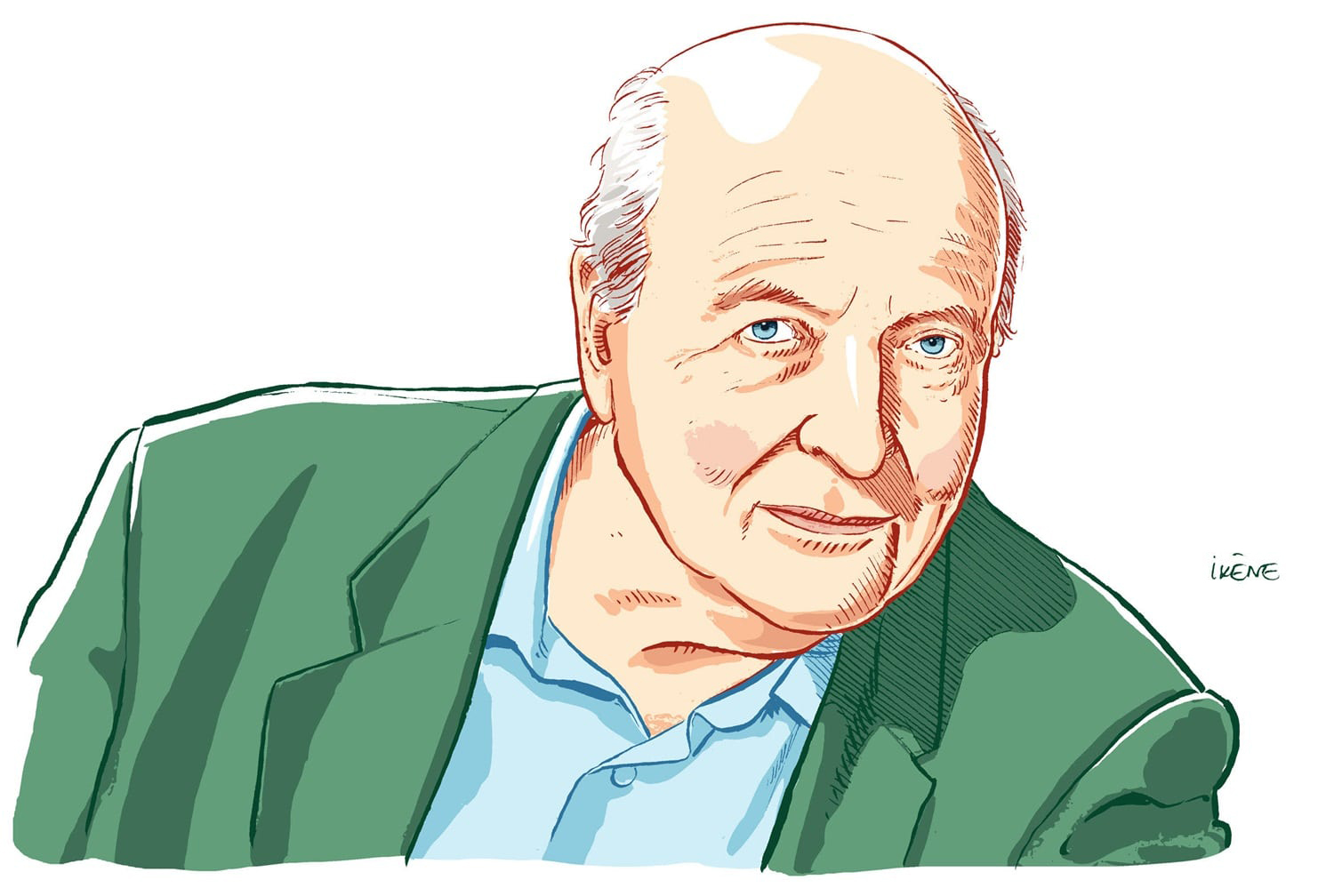


















BVoltaire.fr vous offre la possibilité de réagir à ses articles (excepté les brèves) sur une période de 5 jours. Toutefois, nous vous demandons de respecter certaines règles :