Le promeneur du parc Monceau
[…] Dans le cas de Ségolène Royal et de François Hollande, les Bonnie and Clyde du socialisme institutionnel, on peut dire que la perversion au sens psychiatrique, le mépris des préceptes antérieurs sont une spécialité : non seulement ils font quatre enfants hors mariage, mais ils participent de cette entreprise générale, nationale, d'aplatissement des valeurs au point de camper sous le réacteur nucléaire de la déconstruction : le palais de l'Élysée lui-même.
Littéralement irradiés par la sottise ambiante, à l'exemple de leur classe d'âge et de leur catégorie sociale, ils entrent dans un schéma psychologique assez connu, celui de l'autojustification permanente liée à un défaut de reconnaissance personnelle subi dans l'enfance. Pour commencer, on peut observer que cette génération a connu un tel traumatisme dans ses rapports au père que la figure présidentielle hautaine et paternelle de François Mitterrand (hauteur largement due au fait qu'il se savait mourant) a été en quelque sorte dénaturée, rendue plus acceptable par le sobriquet de Tonton. Le tonton, l'oncle dans les familles, celui qui a l'apparence d'un père tout en ne voulant pas exercer ses prérogatives et notamment l'autorité, la discipline. Le tonton est celui qui interfère auprès du père pour atténuer sa rigueur.
La plupart des gens qui ont exercé le pouvoir ou qui y ont prétendu, dans les années où la dette de la France a été multipliée par vingt ou trente, auront été victimes d'un rapport au père de cette nature. Le fait de dilapider l'héritage est déjà la forme de vengeance la plus commune contre l'image du père. Dieu sait qu'ils l'auront tous fait, droite et gauche, dans tous les domaines.
Ensuite, on est stupéfait de voir à quel point les pères des gouvernants après Giscard d'Estaing se ressemblent. Celui de Ségolène Royal était militaire et brutal, imprévisible puis divorcé et absent ; celui de Hollande d'extrême droite, puis imprévisible, divorcé puis absent ; celui de Nicolas Sarkozy fantasque, artiste, imprévisible, divorcé, absent ; celui de Manuel Valls, idem.
En 1987, Ségolène Royal gravit le perron de l'Élysée tous les matins, ses dossiers dans les bras pour assouvir sa soif d'avoir raison contre ceux qui croient détenir la vérité. Elle pense évidemment à son père, mais c'est un mauvais calcul. Car la vérité, ceux de la génération précédente savent souvent où elle campe, non pour l'avoir inventée mais pour l'avoir entendue de leurs propres pères. Du coup, la pauvre Mme Royal, comme ses contemporains, est souvent obligée d'aller planter sa tente du côté du mensonge. Elle s'installe hors mariage, mais avec enfants, dans la vie d'un auditeur à la Cour des comptes. Ce François Hollande qui se trouve dans une position voisine vis-à-vis de son propre père est une sorte de Paul Deschanel (Président français qui a démissionné après être tombé d'un train en 1929, et qui avait fait comme lui de bonnes études pour en remontrer à son père tout en jouissant d'une réputation de plaisantin sur les bancs de l'Assemblée).
Pour s'épargner le soupçon d'accabler le seul camp socialiste, il est permis d'aller faire un tour en face. Mais en face, c'est à côté. Droite ou gauche, la plupart des politiques de cette génération n'incarnent plus l'autorité puisqu'ils l'ont défiée par la dérision, puisqu'ils s'excusent d'en endosser les oripeaux. La loi de transmission de l'autorité chez les mâles, c'est la rivalité, c'est l'affrontement, c'est la force. Mais la France du lycée Pasteur de Neuilly, celle des Bronzés, celle des bons plans entre copains, ne connaît plus qu'une seule façon de faire mordre la poussière à son rival, c'est le ricanement, c'est le croche-pied. Il n'y a donc plus qu'une seule droite acceptable, celle qui sait rire d'elle-même quand on la fait trébucher en public – en somme, celle qui est de gauche. Sur un plateau de télévision, une fille de 25 ans demande à Jean d'Ormesson, éditorialiste du Figaro, de lui donner l'une de ses chaussettes. Le bonhomme s'exécute, sous les yeux de la France stupéfaite, avec un sourire du genre "Ça fait même pas mal". Jacques Chirac, pour accéder au pouvoir un peu plus tard, a été rhabillé au sens propre, notamment par sa fille ; et au figuré, il a été repeint aux couleurs de l'adversaire. C'est à ce seul prix qu'il est devenu légitime. Il incarne la droite sympa, celle qui a l'esprit faible, celle qui feint de croire que la France est restée un village à la Don Camillo, et il se voit assez dans le rôle du curé vitupérant qui a le cœur sur la main, qui n'en veut à personne et qui croit qu'en partageant un verre de rouge avec les communistes, il va sauver l'unité de la nation.



















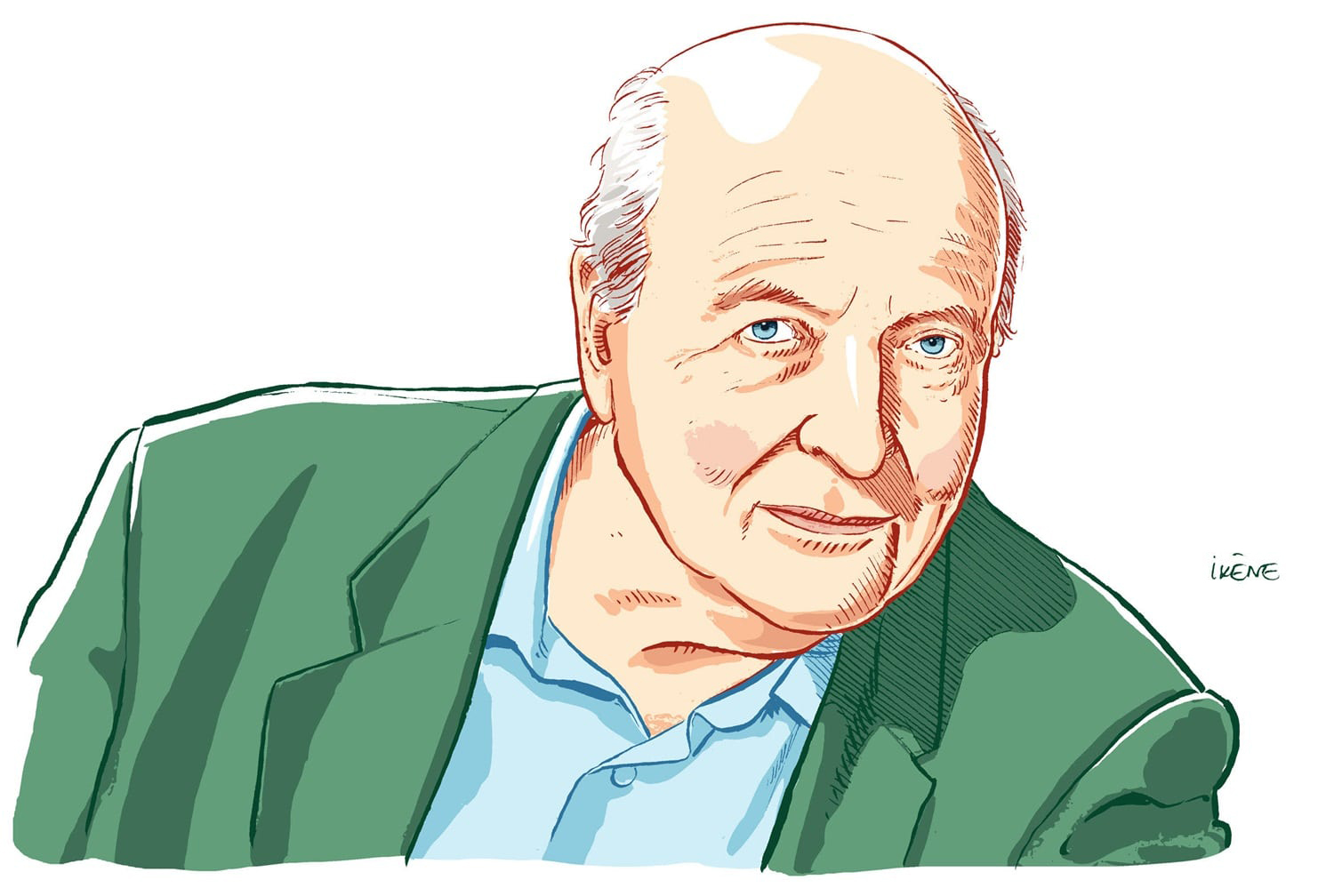



















BVoltaire.fr vous offre la possibilité de réagir à ses articles (excepté les brèves) sur une période de 5 jours. Toutefois, nous vous demandons de respecter certaines règles :