Entre étatisme et libéralisme, il faut trouver le juste milieu
Selon un article de l’IREF (institut européen de recherche militant pour la liberté économique et la concurrence fiscale), intitulé "Un an après : l’étatisme “new look” d’Emmanuel Macron" – titre qui n’échappe pas à la mode du franglais –, notre Président voudrait réformer le pays en essayant de sauver le système et compterait sur l’État pour le faire.
Bref, Macron serait un trop tiède libéral. Jugement paradoxal ! Sa toute relative modération, à supposer qu’elle soit réelle, ne proviendrait-elle pas plutôt d’un souci tactique ? Son livre de campagne, Révolution, traduit bien la détermination du disciple de Jacques Attali à transformer la France en profondeur.
Mais faut-il nécessairement choisir entre étatisme et libéralisme ? Méfions-nous des mots en "-isme", qui portent trop souvent en eux un potentiel idéologique : ils expriment une vision totalisante, qui ne laisse pas place à la nuance. L’étatisme comme le libéralisme conduisent à des abus inquiétants.
L’IREF se prononce pour un « État minimum ». Il propose, pour baisser les dépenses publiques, de « supprimer le statut des fonctionnaires (hors fonctions strictement régaliennes), réduire leur nombre pour arriver au même nombre que l’Allemagne, privatiser et ouvrir à la concurrence les services publics en donnant aux Français la liberté de choisir ». Des termes qui peuvent plaire dans une société où les fonctionnaires et assimilés (on pense aux cheminots) n’ont pas toujours bonne presse.
Certes, il y a des abus dans le recrutement des fonctionnaires, notamment dans la fonction publique territoriale. Mais quels seraient les secteurs « strictement » régaliens qui devraient être conservés ? La diplomatie, la défense du pays, le maintien de l’ordre ? Cela semble aller de soi. Encore que l’on voie, même dans les ministères, des entreprises privées assurer la sécurité.
Et en matière d’Éducation nationale, le plus grand recruteur de fonctionnaires ?
Des économies pourraient sans doute être faites sur les personnels administratifs en simplifiant le fonctionnement de cette immense machine. Faut-il aller jusqu’à instaurer, pour les écoles, une autonomie budgétaire ainsi que la liberté d’embaucher et de licencier leur personnel enseignant ?
Un tel système, calqué sur le privé, ne revient-il pas à considérer l’école comme une entreprise ? L’école n’est pas une entreprise et sa réussite se mesure, non à son chiffre d’affaires, mais à sa capacité de transmettre des connaissances et des savoir-faire. Si la concurrence – qu’il serait préférable d’appeler émulation – peut être un facteur de progrès, l’État ne doit-il pas fixer des objectifs exigeants et trouver les moyens, sans les pousser à la servilité, de reconnaître le mérite des établissements et des professeurs qui y répondent le mieux ?
Plutôt que de libéraliser le monde de l’éducation – ce qui reviendrait à trouver normal qu’il y ait des écoles qui fonctionnent bien et d’autres qui périclitent ou fassent faillite (et tant pis pour les élèves qui les fréquentent !) –, l’État stratège ne devrait-il pas favoriser et contrôler les initiatives, assurer une certaine équité territoriale, permettre aux parents de choisir librement l’école de leurs enfants ?
Ces objectifs ne peuvent être atteints ni par le seul libéralisme ni par le seul étatisme, mais par un subtil équilibre entre les deux conceptions. Dans ce domaine, aussi, la vérité se situe dans un juste milieu : "In medio stat virtus", comme disaient les Anciens. Encore faut-il que les partisans du libéralisme ne considèrent pas qu’ils détiennent la panacée et que les dirigeants de l’État aient toujours le sens de l’intérêt général. Mais ceci est une autre histoire !


















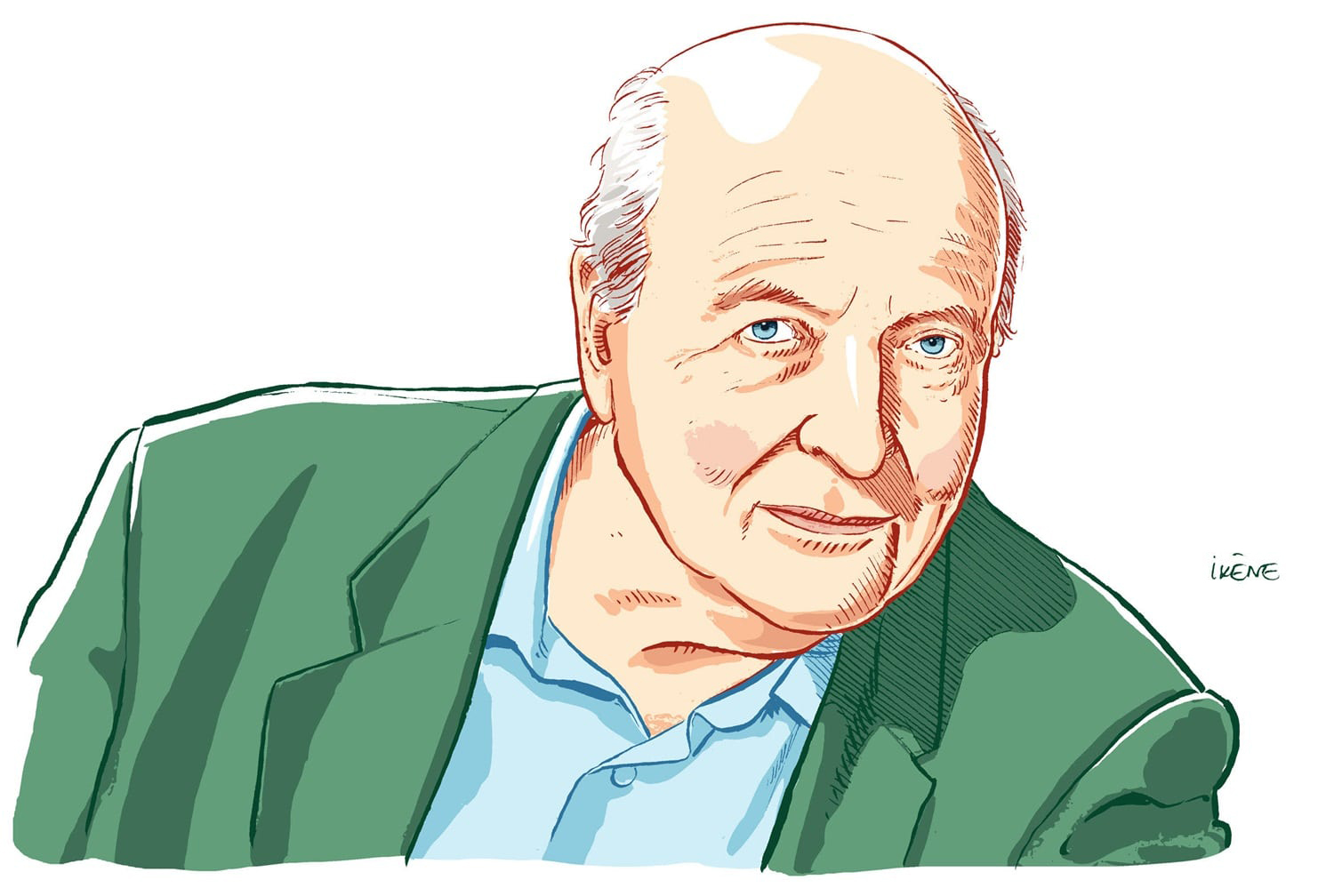



















BVoltaire.fr vous offre la possibilité de réagir à ses articles (excepté les brèves) sur une période de 5 jours. Toutefois, nous vous demandons de respecter certaines règles :